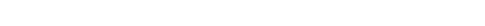Vladimir Jankelevitch
Je suis saisi par la beauté des images d’Alain Kleinmann. J’ai conscience de me trouver devant un talent exceptionnel, absolument original et qui renouvelle de fond en comble la plastique et la force expressive des images. J’admire profondément le peintre lui-même, au-delà de sa peinture.
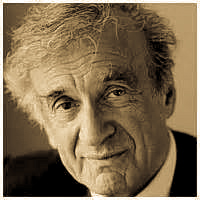
Elie Wiesel
Je trouve les images d’Alain Kleinmann émouvantes et même bouleversantes…
J’ai regardé, bien regardé… Les portraits, surtout, me touchent…

Amos Oz
Cher Alain Kleinmann, vos œuvres sont une puissante commémoration d’un monde qui a été assassiné.
Votre travail est calme, murmuré, mais accablé de nostalgie, de compassion et de chaleur. Merci
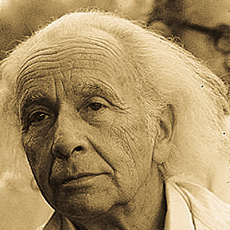
Louis Aragon
Les regards que je vois dans les toiles d’Alain Kleinmann, je les reconnais, ils sont comme surpris de notre mémoire vraie : les écritures qui les barrent, les espaces qui les enveloppent, les mouvements dans lesquels ils frissonnent semblent des morceaux arrachés à la réalité. Souvenirs d’instants de vie, art puissant qui ancre ses racines dans le quotidien même et qui par pudeur s’autoparaphe à l’infini comme après un long chemin dans le temps.
La peinture d’Alain Kleinmann appartient à ce qui fonde l’art : un sentier pétri d’humanité chaude et douloureuse qui bouleverse par sa vérité plastique et poétique.
Ses thèmes sont notre vie : gares, lieux publics, mouvements de foules, rapports entre les regards, scènes théâtrales, espaces de murmures inquiétants, de mascarades secrètes, d’espoirs et de lueurs nichés dans les ombres. En contemplant les œuvres d’Alain Kleinmann, c’est devant notre profondeur que nous nous trouvons, c’est un des chemins par lesquels nous regagnons notre lumière intérieure.

Alain Finkielkraut
Il y a ce que l’on appelle l’art contemporain, l’art qui a le label d’art contemporain, mais il y a aussi l’extrême solitude d’un certain nombre d’artistes qui se refusent aux diktats de cet art contemporain titularisé. Moi, je voudrais en citer un, qui a été en son temps célébré par Aragon : c’est Alain Kleinmann. C’est un peintre de la transmission, un peintre de la mémoire, un peintre de la catastrophe, même de la Shoah, qui est très moderne par l’usage qu’il fait d’un certain nombre de matériaux des plus nobles aux plus humbles à l’intérieur de sa peinture, mais c’est une peinture extrêmement émouvante puisqu’elle nous dit la catastrophe ; simplement cela reste de la peinture et cela reste de la beauté.

Ivry Gitlis
Trente-cinq ans de “paix” en Europe, et cela se passe… ailleurs. Mémoires, portraits oubliés, kaddish et gares. Des transparences de l’âme sur toile et la plaie reste ouverte, le sang ne coule plus, il est parti avec le train qui ne reviendra pas. Visions fugitives comme disant adieu. Pourquoi, jeune homme qui n’a pas vécu tout cela ? Mais tant mieux n’oublie pas, et nous aussi, avec toi.

Marcel Marceau
Le temps intemporel qui se déchire, la vie fugitive sortie de l’immobilité qui soudain devient mouvante, les corps impassibles qui semblent de granit et soudain se décomposent comme le sable mouvant de notre vie, voilà un fragment des visions que nous offre Alain Kleinmann, et cela nous frappe d’autant plus que ces images font partie intégrante des déchirements de notre existence cosmique ancrée au cœur même de notre mémoire et qui témoignent de notre vie déchirée par la lumière et l’ombre, où les trains se figent pour l’éternité. Voilà masques et visages qui surgissent sculpturalement, se dédoublent et triplent comme pour témoigner de notre conscience dans un siècle qui glisse et meurt pour renaître de ses cendres. Ces peintures fragmentées entre la lumière et l’ombre font éclater les soleils de notre cœur. Alain Kleinmann est un grand peintre dont la révélation nous fait toucher du doigt l’essence même de notre vie éphémère qui prend soudain les dimensions d’un songe rempli de visions dantesques, mais où le cœur de l’homme bat fragilement pour l’éternité.
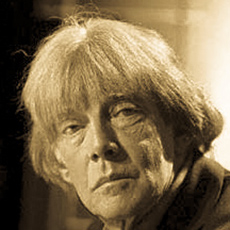
André Glucksmann
Depuis quelques siècles, un peintre est un être qui peint des tableaux. Là s’arrêtent nos certitudes. Sous prétexte qu’un tableau prenne de la place, il est supposé contenir un morceau d’espace et retenir des ombres, images, idées, absences ou fantômes de choses. Expressionnisme, impressionnisme, idéalisme, formalisme, sur – et hyper – réalisme définissent les manœuvres par lesquelles on s’imagine le peupler de présents. Tant de présence n’a pas lieu. Car le tableau ne coagule que la durée. Dût-elle poursuivre la chose même, hollandaise donc, la peinture saisit seulement une éternité de perles chronocongelées.
Quand un être temporel s’ausculte, il échappe et allonge par les deux bouts, il se découvre sans cesse plus vieux que soi, donc procède simultanément à l’autopsie d’un soi plus jeune que lui, comme un homme rétrospectif “qui aurait la longueur non de son corps, mais des années” (Proust).
Épiant des miroirs qui alors dégèlent, un temps parfois se regarde dans les yeux, celui, retrouvé par Alain Kleinmann, apparaît impérativement périssable, définitivement fini, dûment perdu. Inflexible.

Georges Moustaki
Kleinmann est un de ces démiurges qui recréent le cosmos dans une dimension que l’œil peut embrasser. Comme ces jardins japonais qui contiennent dans un faible espace tous les éléments de la nature, ses œuvres offrent à notre regard les couleurs, les personnages, le graphisme de la mémoire – parfois imaginaire – d’un homme, d’un peuple, d’une Histoire… Images sacrées, visions prophétiques, visages familiers, matériaux improbables, paysages inachevés, son monde ouvre un album de souvenirs qui échappent au temps.

Bernard Cazeneuve
PREMIER MINISTRE
DISCOURS PRONONCE LORS DE LA REMISE DES INSIGNES DE CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D’HONNEUR A ALAIN KLEINMANN A L’HOTEL DE MATIGNON LE 15 FEVRIER 2017
Madame la Ministre, chère Audrey Azoulay,
Messieurs les parlementaires,
Monsieur le secrétaire général,
Messieurs les ambassadeurs,
Messieurs les préfets,
Amiral,
Monsieur le grand rabbin de France, cher Haïm Korsia,
Monsieur le président du Consistoire, cher Joël Mergui,
Monseigneur, cher Stanislas Lalanne,
Mesdames, Messieurs,
cher Alain Kleinmann,
vous êtes issu d’une famille qui a dû fuir plusieurs pays d’Europe centrale en raison de ses origines juives.
Lorsque vous étiez enfant, vos parents n’évoquaient que rarement votre judéité. Dans cet après-guerre, les craintes des persécutions n’étaient pas éteintes ; on comprend qu’elles aient inspiré à bien des parents des précautions dictées par la tendresse et par le poids du destin.
Vous avez commencé à manier les pinceaux dès l’âge de huit ans. Peindre était pour vous plus qu’une vocation : c’était votre aspiration la plus profonde. Elle ne s’est jamais éteinte, même lors de votre passage en classes préparatoires, que vous avez préféré abandonner plutôt que de renoncer au bonheur de votre art.
Vous intégrez les Beaux-arts, mais l’Ecole vous paraît bien trop académique et contraignante pour la fantaisie qui semble constituer un élément déterminant de votre personnalité. Vous décidez alors de poursuivre à l’université l’étude des mathématiques, ainsi que celle de la sémiologie auprès de Julia Kristeva. En dehors de vos cours, vous redécouvrez la culture juive et la mémoire du « Yiddischland » disparu.
C’est par ce cheminement que vous devenez le peintre de la mémoire que nous connaissons tous aujourd’hui.
Le romancier israélien Amos Oz dit de vos œuvres qu’elles sont « une puissante commémoration d’un monde qui a été assassiné ». Là aussi, phrase d’une grande beauté qui dit toute la profondeur d’un être et toute l’intensité d’un art. Cette mémoire, habitée par l’ombre des victimes de l’Holocauste vous l’explorez seul, mais aussi au sein d’un collectif : le groupe Mémoires, que vous avez fondé avec le peintre Hastaire, ainsi qu’avec des artistes tels que Kuper ou Zaborov.
Par votre art, vous arrachez des âmes à l’oubli, vous faites revivre des « traces de présence ». Une œuvre intitulée « Le portail du souvenir » symbolise votre entreprise : vous tentez de surmonter les silences pour faire revivre la mémoire à travers « un sentier pétri d’humanité chaude et douloureuse qui bouleverse par sa vérité plastique et poétique », pour reprendre les termes de Louis Aragon.
Vous le faites à partir de photographies, comme dans « La pose », ou encore par un ensemble de symboles picturaux, le motif de la valise, par exemple, renvoyant au thème de l’errance ; les clefs et les serrures, aux non-dits.
La peinture, la sculpture, le dessin, la gravure sont pour vous autant de « mots pour peindre ». Vous employez des matériaux très divers : photographies, tissus, tickets de métro, papiers… Vous créez votre propre langage, composé de numéros, d’alphabets, de signes typographiques ou musicaux. C’est-à-dire que vous créez au fil du développement de votre œuvre un univers très à vous dans lequel nous pénétrons avec vous en le découvrant avec sensibilité et bonheur.
Vous avez votre propre poétique, votre propre livre de Mallarmé – un livre sans commencement ni fin car pour vous, une œuvre n’est jamais tout à fait achevée si elle est une oeuvre.
Vous renvoyez souvent à l’univers du livre, comme dans « La bibliothèque de Mondrian ». Les livres emplissent jusqu’à votre atelier, qui est aussi me dit-on votre jardin secret. J’espère que je pourrais un jour vous-y retrouver car j’aime les jardins, j’aime les jardins secrets, j’aime les livres, la peinture et les peintres. Il n’y a donc aucune raison pour que vous n’accédiez pas à cette proposition.
La lecture, c’est aussi quelque chose que vous partagez avec votre épouse, Emmanuelle, et vos quatre enfants, à qui vous lisez volontiers de la poésie me dit-on.
Après la lecture vient l’écriture. Vous avez notamment rédigé La peinture et autres lieux, qui a été adapté au théâtre par la compagnie Aldaba lors de la XIe biennale de La Havane, à Cuba.
Votre œuvre tout entière est le produit d’un art qui convoque, dans l’ombre de l’intime, des rapports fraternels entre l’Histoire et la mémoire.
C’est ce qui fait de vous un grand artiste français. Votre renommée est internationale, et contribue au rayonnement de la France dans le monde entier. Car vous avez été exposé partout, aussi bien au Centre Georges-Pompidou qu’au musée de l’Académie des Beaux-Arts de Pékin – une ville où je me trouvais encore la semaine dernière – ou au musée Tretiakov d’Art contemporain de Moscou. Mais aussi Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la Kunsthalle de Berlin, au Science Museum de Londres, au New York Coliseum ou au musée Leonardo Da Vinci de Milan…
La Fondation du Judaïsme français vous a en outre décerné en 2007 le prix Jacob Buchmann.
Il était temps que la République, à son tour, vous témoigne sa gratitude et son admiration pour une œuvre aussi riche, aussi singulière, aussi belle.
C’est la raison pour laquelle, Alain Kleinmann, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’honneur.

Elisabeth de Fontenay
DISCOURS PRONONCÉ À L’OCCASION DE LA REMISE DU PRIX JACOB BUCHMANN (FONDATION DU JUDAISME FRANCAIS) À ALAIN KLEINMANN
Permettez qu’à l’adresse de ceux qui ne connaîtraient pas encore Alain Kleinmann, je procède à un rapide inventaire des motifs les plus fréquents de son œuvre. C’est d’abord des couleurs ou plutôt des tons qu’il faut parler. Ils sont bruns et sépia, bruns gris, bistre, comme des tonalités du passé qu’un certain rouge tantôt fait vibrer, tantôt assourdit encore un peu plus. Dans ces tonalités s’inscrivent, je le cite, “la persistance d’un regard” et, je le cite encore, les “choses abandonnées” qui “conservent la persistance des présences antérieures comme un silence musical garde la présence des dernières notes jouées”.
Voici donc, telles que le peintre à la fois les recueille et les invente, quelques-unes de ces choses abandonnées. Le monumental escalier baroque d’une demeure patricienne qu’on imagine juive et pragoise ; le portail du parc d’un château où l’on se dit qu’ont été abrités, pendant et après, des enfants cachés, puis des enfants sauvés ; des cartons à dessins sur lesquels ont germé et éclos des livres ; des empilements de vieux ouvrages secrets, rangés en tous sens, comme c’est le cas dans les bibliothèques de ceux qui lisent ; des accumulations de clés sans serrures et de vieilles boîtes à lettres inouvrables dans lesquelles s’encastrent des médaillons, et que Kleinmann tamponne parfois d’un “annulé” ou encore N.P.A.I., n’habite plus à l’adresse indiquée. Est-ce du peintre lui-même qu’il s’agit comme lui-même nous le confie ? Ou alors des Juifs ? Mais n’est-ce pas plutôt Dieu qui, pendant quelques années, n’a plus habité à l’adresse indiquée. à moins qu’il ne faille, plus paisiblement, entendre dans les quatre lettres fatidiques, N.P.A.I. quelque chose comme cette Énigme éternelle, la Mélodie hébraïque de Maurice Ravel, dont les paroles se réduisent à la répétition enfantine et profonde de deux syllabes tralala lala lala ?
Je reprends mon énumération : des cartes géographiques, des réseaux ferroviaires, des valises d’avant-guerre entassées, belles et tristes, mais sans aucun pathos, des variations de pinceaux, signatures répétitives et matérielles du peintre, des suites de tampons, des timbres et des estampilles parfois rouges, qui oblitèrent l’image et qui signalent “fragile” ou inscrivent le sceau d’un numéro dont la netteté n’est jamais indemne de cruauté, des portraits photographiques anciens, souvent flous, anonymes, et traces pourtant d’insistantes réminiscences.
Et encore : des instruments, des partitions, évoquant des violonistes dont on se dit qu’après avoir interprété la Sonate à Kreutzer ils se laisseront aller à jouer “un refrain oublié”, Mayn Stetele Belz, par exemple. Pourquoi est-ce justement à cette chanson-là que je pense ? D’abord, peut-être, parce qu’aussi loin que je me souvienne, je l’ai entendue chantonnée. Ensuite, parce que Daniel Mendelsohn – qui me semble avoir une sorte de parenté avec Alain Kleinmann, à cause d’une commune douceur dans l’obstination du lien au passé – raconte, dans son livre Les Disparus, comment les nazis et leurs supplétifs ukrainiens, s’amusant ignoblement d’une proximité phonétique entre Belz et Belzec, contraignaient à chanter Mayn Stetele Belz ceux qu’ils conduisaient vers le camp d’extermination. Les douces mesures, les paroles enfantines, le rythme troublant sur lesquels les exilés du yiddishland berçaient et dansaient leur nostalgie de l’ancienne vie, ont fourni aux exécuteurs ce raffinement pervers qui leur permettait d’humilier et de désespérer un peu plus leurs victimes.
Je voudrais encore évoquer – mais je m’arrêterai là dans l’énumération des thèmes kleinmanniens – ces carrioles attelées à un cheval, conduites par un ou deux hommes coiffés de chapkas, et qui parfois se retournent. Ils nous apparaissent à leur tour, dans leur humble et fier équipage, comme parfaitement emblématiques de l’inquiet bonheur des Stettl, de cet enracinement de l’errance juive dans les villages, dans les campagnes d’Ukraine et de Pologne. Tels sont donc les motifs les plus insistants de l’œuvre que nous célébrons ce soir.
Ce prix qu’Alain Kleinmann se voit décerner et qu’il partage avec Shlomo Venezia porte le nom d’un homme originaire de ces pays d’Europe centrale, Jacob Buchmann, dont la femme et la petite fille furent assassinées à Auschwitz. Aussi Kleinmann ne trouvera-t-il pas indiscrète cette approche seulement juive d’une œuvre dont on peut certes parler d’une toute autre façon, comme en ont témoigné Aragon et quelques autres illustres amateurs. J’espère qu’il comprendra mes raisons de ne mettre l’accent que sur l’aura juive de son travail. En iconographie religieuse, l’aura désigne une auréole, un nimbe entourant l’ensemble du corps d’un homme sanctifié ou d’une divinité, elle représente sa sainteté ou sa puissance. Le philosophe Walter Benjamin a repris le terme d’aura pour caractériser la spécificité de l’œuvre d’art en tant qu’elle est unique et qu’elle s’inscrit dans un contexte historique et spatial. Et il définit l’aura comme la “manifestation d’un lointain quelle que soit sa proximité”. Or ce que Kleinmann nous donne justement à voir, c’est la douloureuse proximité de ce lointain, la présence-absence de ce peuple du yiddish. Car la catastrophe, hurban, est omniprésente dans cette œuvre. Mais on voudrait dire qu’elle l’est en sous-impression comme on parle de surimpression. “Je crois que le pouvoir de suggestion du murmure est plus fort que celui du hurlement”, écrit-il. Ce ne sont pas les processus terminaux de la cruauté absolue qu’il évoque en effet, c’est tout ce qu’il y avait de vivant, auparavant, tout ce qui existait et dont nul ne pouvait prévoir ou prévenir l’abominable interruption. Kleinmann nous rend quelque chose des visages, des costumes, du maintien de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui, par-delà les généalogies interrompues, nous ont engendrés, il réinvente cette petite vie entre soi concrète, quotidienne, amère et douce, cette vie sépia du yiddishland, qui ne pouvait sans doute pas durer indéfiniment mais à laquelle il est arrivé ce qui n’aurait jamais dû avoir lieu.
C’est, le plus souvent, dans l’agrandissement des détails qu’on découvre les trésors de remémoration que j’ai trop rapidement inventoriés. Chaque fragment de cette œuvre, quand on le grossit, donne à voir comme un monde en soi. Permettez, cher Alain Kleinmann, à la philosophe que je suis de s’adresser au mathématicien que vous êtes en citant la Monadologie du grand philosophe mathématicien Leibniz. “Il y a un monde de créatures, de vivants, d’animaux, d’âmes dans la moindre partie de la matière. Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l’animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang.” Cette philosophie s’est désignée elle-même comme “le labyrinthe du continu”, et on a pu la rattacher à un certain baroque, celui des artistes qui ne laissent jamais subsister le moindre vide dans l’espace de leur œuvre, ce baroque peut-être aussi de Prague que vous vous plaisez à représenter. La philosophie de Leibniz pourrait entrer étonnamment en correspondance avec l’œuvre peinte et sculptée que nous célébrons ce soir, si l’optimisme, la justification de Dieu, la théodicée qui la fondent ne l’avaient pas rendue à jamais étrangère au mal radical nazi dont la sous-impression, encore une fois, hante le geste de Kleinmann.
Ce qui fait la génialité de ce travail, c’est, entre autres traits, la singularité de sa matérialité, je veux dire le caractère inattendu des matériaux utilisés ou plutôt subtilisés pour peindre, coller, construire, greffer. “Je m’inspire souvent, a-t-il dit, des hasards de la matière, des imprévus”. La langue de l’artiste s’articule à partir de ce que lui-même désigne comme “matières de grenier” : chiffons, gaze, papiers froissés ou gaufrés, feuilles d’or, calques, photos marouflées dans le support de la toile et ces portraits peints qui assurent le lien entre les matériaux et la peinture. Le carton ondulé joue un rôle saisissant, car, comme le peintre lui-même l’indique, il ne laisse pas voir, quand on le déchire, une coupure nette, de sorte qu’intégré à la toile il forme un léger relief, souvent repris par le dessin de stries diagonales, par les modules répétitifs et rythmant de bâtonnets creux et réguliers.
Ces œuvres ne relèvent pas plus de la figuration que de l’abstraction, dans la mesure où, à partir des techniques mixtes, sculptures et peintures sur matériaux, à partir des stratifications de matière, à partir des couches superposées, parfois, sans bords, sans vides, se constitue une langue avec son vocabulaire, sa syntaxe, sa grammaire, ses articulations : Unser Wort, écrit-il sur l’un de ses tableaux et le titre du vieux journal yiddish semble prendre en charge l’ensemble de ces toiles qui semblent provenir de très loin, semées qu’elles sont d’allusions familières et étranges auxquelles s’agrafe la mémoire. Ce ne sont, comme Laurence Sigal l’a fait remarquer, que labyrinthes de superpositions, de reprises et de masquages qui rendent en même temps familières et indéchiffrables les références incluses dans la matière, voire les lignes d’écriture. Les signes sont à la fois précis et effacés comme si tout flottait entre le dit et le non-dit, comme si le peintre veillait à ce qu’on ne puisse pas lire les mots qu’il trace.
On peut dire que Kleinmann nous présente les vraies fausses archives de l’histoire, de nos histoires ravagées, car c’est le temps que remonte l’espace de sa peinture et c’est le passé qu’il arrache magiquement au néant, même si tous ne reconnaissent pas comme leurs les objets et les visages qu’il représente : ces regards désaffectés qu’il se donne pour tâche de réaffecter. “Je peins la carte d’identité d’un événement”, a-t-il écrit. Or, Walter Benjamin à qui j’ai eu recours pour qu’il m’aide non pas à entrer dans cette peinture mais à m’en distancer un peu pour pouvoir vous en parler, Walter Benjamin ne disait pas autre chose quand il donnait pour consigne à l’écriture de “donner leur physionomie aux dates”. Et l’on trouve cette même volonté minutieuse d’incarnation temporelle chez le poète Paul Celan quand il écrit : “Le poème parle ! de la date qui est la sienne… de la circonstance unique qui proprement le concerne”. N’est-ce pas dans cette trace que la tradition juive demande qu’on prononce et qu’on inscrive les noms de ceux qui sont morts ? Car, dans la datation, l’inscription et l’état civil de l’événement unique, il s’agit, pour Celan comme pour Benjamin, comme pour Kleinmann, de se souvenir. Et ce rappel, ce zakhor, loin de seulement le conserver, réactualise le passé dans l’expérience du présent. C’est ainsi qu’en notre nom et à notre intention, Kleinmann fait don de leur aura aux corps et aux âmes qui ont habité ce monde.

Martin Gray
Porter son regard sur les êtres qui nous entourent, sur notre environnement, est un geste naturel, un simple acte de vie. Transmettre les perceptions saisies par ces regards, imprimer dans sa toile d’infinies vibrations, relève d’une véritable démarche artistique. C’est une autre lecture du monde que nous propose Alain Kleinmann. Son regard est chargé de mémoire, il porte une somme de souvenirs qui constituent notre histoire. Il en est le témoin, il en devient l’acteur.
Sur sa toile se juxtaposent sensibilité, émotion, force et parfois rudesse. Les visages semblent venus d’ailleurs et les regards des êtres paraissent porter au loin, très loin, derrière nous.
J’ai plaisir à parler de la peinture d’Alain Kleinmann, une peinture qui traduit une approche qui m’est chère, totalement inspirée par les autres, tout entière orientée vers les autres. Parfois dans ses toiles, j’ai l’impression de retrouver des scènes qui me furent familières, en d’autres temps, sous d’autres cieux.
Il serait invraisemblable que l’émotion que je ressens ne soit pas partagée ; je suis persuadé qu’elle l’est. C’est une des forces d’Alain Kleinmann de mettre son talent au service d’autant de vérité. À cette époque où tout va vite, très vite, où certaines valeurs semblent vaciller, où la mémoire paraît quelquefois manquer, nous avons besoin de retrouver des émotions non feintes.
Le temps est passé, les choses semblent avoir totalement changé. Le monde est devenu différent et il faut le penser à nouveau. La sérénité apparente ne doit pourtant pas faire taire toute vigilance. Il y a une obligation impérieuse à traduire en termes contemporains la mémoire de ce qui fut un passé terrible, un passé parfois héroïque. Les porteurs de mémoire ne doivent pas transmettre la haine, ils sont des vigies. Au bout de leur veille, on doit trouver l’espoir.
Je n’ai pas le langage qu’il faut pour parler de peinture, aussi je parle de vie, et c’est bien de vie dont il s’agit dans l’œuvre d’Alain Kleinmann.

Marc-Alain Ouaknin
POUR UNE MÉTAPHYSIQUE DE LA CHAUSSURE
Je connais Alain Kleinmann depuis longtemps. D’abord l’œuvre, puis l’homme.
Un homme inquiet, joyeux, vif, avec un regard qui vous donne toujours l’impression de vous poser une question. Une œuvre riche, toujours en mouvement, en évolution, en différence, avec comme chez tous les artistes, des périodes, des obsessions, des répétitions et une attention aux lieux, aux objets, aux machines. Période “couleurs d’automne et de mémoire”, période blanche qui traquent les rides du temps comme celles invisibles sur le visage du Mime Marceau, période qui reprend certains des thèmes de la période sépia pour les recouvrir, pour retrouver, peut-être, la feuille non écrite et l’épaisseur de la mémoire de ses fibres et de ses lointaines forêts, comme une volonté aussi de tourner la page, de passer, du temps passé au temps à venir, de passer sans oublier, ou peut-être, avec cette conscience de la mémoire que décrit Yosef Hayim Yerushalmi : “J’appartiens à ceux qui craignent que depuis la Shoah, de larges fractions de notre peuple ne se laissent largement ordonner leur vie collective, ou dicter leur politique présente et future, par une obsession de l’ère de la destruction et de la mort. Je comprends cette obsession, mais j’éprouve quand même un grand trouble. C’est comme si nous avions oublié cet enseignement de Rabbi Yehochoua ben Hanania après la destruction du Temple : ‘Ne pas du tout porter le deuil, nous ne le pouvons… mais trop le porter, nous ne le pouvons pas non plus !’ ”1.
Entre le deuil absolu et le non-deuil, il y a l’espoir. “Malgré” le mal et la douleur, nous continuons à espérer. Cette idée du “malgré” est contenue dans le mot “deuil”, évèl, mot identique en hébreu au mot aval, “mais” ; nous sommes en deuil, aval… “mais” nous espérons, nous continuons.
En ce sens le mot aval / évèl est significatif. Dans sa racine hébraïque de trois lettres aleph-bèt-lamèd, on peut lire “Alphabet de l’étude”. La continuation, l’au-delà du tragique se construit par l’alphabet, les mots, le lexique, le langage et l’étude. Cette étude qu’Alain Kleinmann nous offre dans sa série de livres et de bibliothèques qu’il peint de toutes les couleurs et qu’il métamorphose dans toutes les matières. Livres, fragments de bibliothèques talmudiques et de livres de prière. Tradition et transmission soulignées par les Pirkei Avot en écriture Rachi… non pour dire que “ce fut”, mais que “cela peut encore être”, que cela se doit, encore, d’être…
J’aime à penser ici aux sublimes pages qu’écrit Georges Steiner sur les modalités futur du verbe. “Il faut se réjouir avec véhémence du simple fait qu’il existe des formes futures du verbe, que les humains ont mis au point des règles de grammaire qui permettent de parler, de façon cohérente, de demain, de la dernière minute du siècle, de la situation et de la luminosité de Vega dans un demi-milliard d’années”. Rappelant aussi, en se référant à Mandelstamm, que “l’Enfer” chez Dante est un lieu où la grammaire ne comporte plus de conjugaison des verbes au futur. “En Enfer, c’est-à-dire dans une grammaire privée de futur, nous entendons littéralement les verbes tuer le temps”2.
“Souviens-toi de ton futur”, dit à sa façon Alain Kleinmann reprenant l’intuition de Rabbi Nahman de Braslav qui écrit : èn zikaron éla le’alma deaté 3, “il n’y a de mémoire que le monde qui vient”, soulignant que le ’Olam haba n’est pas le “monde futur” mais “le monde en train de venir”, le monde que l’on fait advenir par son engagement et sa participation au monde et à l’histoire. Tiqoun comme aime à le dire les Hassidim. Une façon de “mettre la main à la pâte” 4, affinité du peintre et du boulanger, qui nous enseigne que l’homme ne vit pas seulement de pain5 mais aussi de peinture, pain-ture aurait osé Derrida à qui nous devons “Une vérité en pointure”, saluant la dimension métaphysique des chaussures de Van Gogh6 !
Chaussures si présentes dans l’œuvre de Kleinmann au détour d’une photographie ou au cœur d’une sculpture. Clin d’œil de Kleinmann à l’histoire de la peinture et de la philosophie pour s’y inscrire et y “ajouter sa patte”, un “ t ” en plus et un accent circonflexe en moins, thé d’une madeleine trempée qui ouvre à tout un monde disparu, pour faire surgir des formes “qui s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables” 7, “ a ” sans petit chapeau pour ouvrir à l’universalité du propos.
Bien sûr je joue sur les mots et les signes mais c’est précisément ce que fait avec sérieux Alain Kleinmann, car le jeu est toujours sérieux, comme nous le rappelle Héraclite parlant du “temps comme un enfant qui joue en déplaçant des pions”8. Jeu avec les chaussures, mais aussi avec les valises, les landaus, les vieilles photos, les écritures en yiddish, les clefs, & Co 9.
Ce serait une erreur de voir dans ces objets lamentation et nostalgie, signes d’une peinture dolorante. Bien sûr il y a aussi de la tristesse, comment pourrait-il en être autrement ? Mais réduire cette peinture à ce regard en arrière serait figer le geste artistique qui est justement une façon à la fois d’assumer la mémoire et de ne pas s’y enfermer, de partager la douleur mais de nous conduire au-delà, de souffrir mais d’avoir confiance en continuant à donner à espérer même si cela peut être désespéré !
Je pense ici à un texte de Bobin que je cite souvent. Dans une lettre à une jeune femme qui porte le nom de Nella, Bobin évoque le carnet écrit par une Juive, sans doute Etty Hillsum, quelques jours avant sa mort : “Elle est dans un camp de transit. Hier la vie le travail l’amour, aujourd’hui la soif la faim la peur, demain rien. Le train qui l’emmènera vers demain est sur les rails vérifié par des mécaniciens scrupuleux. Le train qui filera dans un demain sans épaisseur, dans un jour sans jour. Cette femme regarde autour d’elle, et vers le dernier matin, décrit émerveillée le linge des enfants lavé dans la nuit par les mères, et mis à sécher sur les barbelés. Elle dit combien cette vue la réconforte, lui donne un cœur contre lequel viennent battre, en vain, les aboiements des chiens, les cris des soldats, le souffle lourd des trains plombés. Si ce texte est lumineux, poursuit Bobin, ce n’est pas seulement en raison du voisinage de la mort et de l’encre, de l’espérance et de l’abîme. C’est aussi, c’est surtout, par la pensée qu’il nous donne, et je ne connais pas Nella de pensée plus noble, plus simple, plus noblement simple, je l’écrirais ainsi : la pureté n’est faite que de détails, la bonté n’est faite que de gestes. Ces gestes ne mènent pas à de grandes victoires, aucune légende ne les retient. Ces gestes sont gestes de tous les jours bien plus héroïques que tout héroïsme. Laver le linge, pour que l’enfant, demain, se sente léger, confiant, dans des vêtements frais, propres. Même si demain n’est plus dans la suite des jours, même si demain ne verra pas le jour”10.
L’œuvre de Kleinmann est une œuvre qui s’appuie sur la mémoire, non pour s’y réfugier mais pour lui donner sa place, un lieu, des limites, une frontière, une frontière à traverser. Non pour errer, mais pour voyager.
L’ “errance”, titre de nombreuses œuvres de Kleinmann où l’on voit ces valises si caractéristiques du siècle dernier (XXe) et du siècle précédent (XIXe), peuvent certes nous faire penser à la Shoah et à la destruction des juifs d’Europe, mais elles ont aussi le signe de la mobilité des humains, de la vitalité des peuples qui ont toujours cherché un lieu de vie, un lieu où l’humain peut se déployer, s’épanouir et être heureux. Et j’aime alors à me souvenir que le verbe “marcher” en hébreu, dit aussi le bonheur !11 Comme l’a si génialement montré André Chouraqui, le Sermon sur la montagne n’est pas seulement scandé par des “Heureux ceux…”, mais par une suite d’invitations au mouvement, au départ, au voyage : “En marche ceux qui…” 12
Je regarde cette photo qui ouvre le catalogue Los lugares del tiempo où deux chaussures (encore elles !) font un clin d’œil (encore un !) à Moïse et Van Gogh (encore lui !), et viennent nous rappeler que la marche n’est pas seulement celle des hommes en voyage ou en promenade mais celle du corps de l’artiste et de sa main en mouvement, du pinceau qui se déplace sur la toile et qui cherche, “intention toujours dépassée par le geste”, “paradoxale intention qui devient a posteriori”, “intention qui ne sait pas encore”, comme dit Michel Guérin, “intention de l’accident”, gestes de liberté “qui rend nécessaire les accidents” 13, selon une autre de ses judicieuses formules. Ou, dit différemment par Bergson : “En vain nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent”14.
Cette marche, ce voyage et le “demain” que j’ai évoqué, je les rencontre de manière ensoleillée dans le fait qu’Alain Kleinmann a opéré un retournement dans sa vie d’artiste. Un retournement spatial, géographique. Le regard tourné vers l’Est s’est retourné vers l’Ouest, et a traversé l’océan. Buenos Aires, Cuba, La Havane, et le théâtre. Ce n’est pas seulement un changement d’aire géographique mais c’est aussi la rencontre avec une autre langue, non plus seulement le yiddish de sa mémoire mais l’espagnol d’une autre mémoire.
Espagne, sepharad, anagramme du Pardes que célèbrent le Talmud et la Kabbale, c’est-à-dire le fait que le monde se perçoit dans la complexité de fils multiples (j’aime l’homographie du fils / enfant et des fils / Shmattes) qui se croisent, se chevauchent, s’entrelacent, se nouent et se défont, tissage, broderie et tapisserie, Maasé hochèv, cette dernière nommée par la Tora “œuvre d’art” par excellence !
Jolie amphibologie de ce hochèv qui dit aussi le fait de “penser”, il faudrait dire le “geste de penser”, Rachi précisant dans son commentaire de l’Exode 26,1 que ce mot signifie “que ce qui est vu à l’endroit l’est aussi de l’autre côté”, que l’on ne doit ainsi pas se contenter de la surface visible mais chercher ce qui se joue de l’autre côté de la toile, dans l’envers du décor !
Peut-être signifie-t-il qu’il faut pouvoir tourner autour de l’œuvre ou du moins que l’œuvre nous donne l’impression de pouvoir tourner autour d’elle. Comme nous le propose Balzac dans son Chef-d’œuvre inconnu dans la critique qu’est faite à Porbus . “Regarde ta sainte, Porbus ? Au premier aspect, elle semble admirable mais au second coup d’œil on s’aperçoit qu’elle est collée au fond de la toile et qu’on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C’est une silhouette qui n’a qu’une seule face, c’est une apparence découpée, une image qui ne saurait se retourner, ni changer de position. Je ne sens pas d’air entre ce bras et le champ du tableau ; l’espace et la profondeur manquent ; cependant tout est bien en perspective, et la dégradation aérienne est exactement observée ; mais, malgré de si louables efforts, je ne saurais croire que ce beau corps soit animé par le tiède souffle de la vie”15.
Chez Kleinmann, c’est justement ce souffle de vie que l’on sent et que souligne la mise en scène extraordinairement puissante d’Irene Borges et de la troupe du théâtre Aldaba qui l’ont perçu et exprimé de manière si émouvante et si magistrale. Transfiguration et résurrection !
Il s’agit plus d’un “Opéra” que d’une pièce de théâtre, un Opéra de la mémoire et de la vie qui traverse les corps, les lieux, les couleurs, les idées et les océans. Une vie qui monte et descend les escaliers, ces escaliers majestueux, intemporels qui, selon une expression que j’emprunte à Heidegger, et qui fait écho à la même expression dans le Zohar, sont “noces du ciel et de la terre”16.
L’escalier qui ouvre cet “Opéra” en est l’âme à côté des autres objets.
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »
Les vers de Lamartine 17 jaillissent naturellement devant ces chaises, photos, bougies, parapluies, lunettes, valises, livres, roues, voiles, chaises, landaus, machines à coudre et de tous les autres objets / acteurs du théâtre kleinmannien18.
L’escalier en est l’âme et la porte d’un dialogue que par pudeur Kleinmann ne clame pas mais invite discrètement à découvrir. Porte du dialogue avec les maîtres de la peinture des siècles qui l’ont précédé et avec les autres maîtres, ses pairs et contemporains.
Je pense essentiellement à cette scène 19 où le corps de l’acteur est debout sur trois marches et danse avec son ombre. On y reconnaît le point de fuite des Ménines si savamment glosées par Foucault en préambule des Mots et des choses, si subtilement réinterprétées par Picasso. Guernica n’est pas loin ! Les Psaumes non plus, chir lama’alot.
Un Opéra, donc, qui pourrait aussi s’intituler “Cantique des escaliers”, une traduction baroque de l’expression biblique qui donne à la concrétude de l’objet toute une noblesse paradoxale qui se perd dans la sophistication des “degrés”.
“Quiconque monte un escalier sait que la gravité l’attire vers le bas, vers le début (et le début est toujours en bas), et quiconque franchit une marche sait qu’il fait un petit pas pour entendre Dieu. Dans la montée, il y a le rythme, et dans le rythme il y a la musique, dans la musique il y a le souffle et dans le souffle, il y a le divin. Et quand dans la montée on s’essouffle, c’est pour rendre à Dieu ce qui lui appartient, en blessant l’infini de son éloignement. Surtout quand on a perdu l’âge d’enjamber les marches et de heurter brusquement la monotonie de leur ordonnance”20.
Alors on monte lentement, alors il y a le rythme, et dans le rythme il y a la musique, dans la musique il y a le souffle et dans le souffle, il y a le divin.
Merci à Alain Kleinmann de nous en offrir de si belles étincelles !
Notes :
1 Traité talmudique Baba Batra, 60b. Cité par Y. H. Yerushalmi, Un champ à Anatot : vers une histoire de l‘espoir juif, in Colloque Mémoire et Histoire, Denoël, 1986, p. 107.
2 Après Babel, Albin Michel, 1998, p. 202 à 231.
3 Liqouté Moharan, I, 54,1.
4 “On utilise plusieurs expressions caractérisant l’utilisation de la pâte en peinture : pleine pâte désigne une couche de pâte épaisse travaillée dans le frais et recouvrant tout le tableau ; travailler dans le frais signifie travailler un tableau avant que l’huile contenue dans la pâte ne soit sèche ; la demi-pâte est une couche dont l’épaisseur moyenne constitue une transition entre le glacis, très mince, et l’empâtement en haute pâte et elle forme le revêtement général du tableau sur lequel les empâtements se surajoutent ; la haute pâte est une couche de pâte dont l’épaisseur considérable confère au tableau, sur toute sa surface ou localement, un véritable relief, développement d’une troisième dimension ; l’empâtement est un retour en épaisseurs.” Ce Dictionnaire précise que la pâte est un amalgame de matières pigmentaires réduites en fines particules qui, mêlées à des constituants liquides, simples ou mixtes, non volatils, filmogènes (tels que les liants agglutinants, les liants oléagineux et les liants résineux), offrent une consistance variable. La consistance de la pâte dépend essentiellement de la qualité du liant utilisé. Ni l’Antiquité ni le Moyen Âge n’ont connu les pâtes épaisses ; les peintres de ces périodes appliquaient une technique mixte : dessous exécutés “a tempera” recouverts d’une pâte très fluide “de fines couleurs à l’huile”, riche en résine et transparente. Ce n’est qu’au xve s. que la technique de la peinture à l’huile par glacis a subi une première transformation : en diminuant la quantité de résine contenue dans le liant de broyage, les peintres du Nord et certains peintres italiens ont augmenté l’opacité de leur pâte tout en lui conservant son aspect lisse. Titien a été considéré par ses contemporains comme l’inventeur de l’exécution “en pleine pâte”. Il ébauchait directement avec une pâte épaisse, pauvre en résine et riche en huile siccative. Cette méthode l’obligeait à de nombreux repentirs, pour changer éventuellement certaines parties de ses compositions jugées mal venues. Les repentirs, conséquence inévitable du travail en pleine pâte, sont devenus dès cette époque une habitude très répandue chez les peintres.
“Tintoret, Véronèse et Rubens en Flandre ont adopté la technique de Titien – technique des pâtes épaisses et des blancs en épaisseur. Pour préparer les tons de chaque teinte, il convenait d’y mélanger du blanc d’argent afin que la pâte soit assez épaisse pour ne pas couler et qu’elle puisse bien couvrir le support. La technique moderne était née. Certains peintres, tel Watteau, pour rendre leur exécution plus rapide, se servaient même d’huile comme diluant : cet abus d’huile n’a pas contribué à la bonne conservation des toiles. Les impressionnistes – qui, au contraire, ont réduit au minimum la teneur en huile de leur pâte – ont pu ainsi obtenir des épaisseurs de pâte considérables. Van Gogh et Monet ont réalisé des effets de relief en accumulant de nombreuses couches de pâte. La peinture en relief est encore pratiquée dans la période contemporaine : Fautrier, de Staël, Appel, ainsi que les matiéristes comme Tapiès, ont donné à leurs tableaux des qualités tridimensionnelles.” (Larousse, Dictionnaire de la peinture).
5 Deutéronome 8, 3 ; Matthieu 4, 4. Je pense aussi à cette lettre qu’Einstein écrivit à Simon Doubnov “… Mais les hommes ne vivent pas que de pain, et les juifs encore moins”, 8 avril 1929, in Simon Doubnov, Le livre de ma vie, Cerf, 2001, p. 1122.
6 Jacques Derrida, La Vérité en peinture, Flammarion, 1993.
7 Marcel Proust, à la Recherche du Temps perdu, Tome I, p. 47.
8 Héraclite, Fragments, Traduction Marcel Conche, Fragment 52 (130), Puf, 1986, p. 447.
9 Dans La peinture et autres lieux, Kleinmann s’en donne à cœur joie avec les jeux de mots, “on a bien le droit de s’amuser ? Non !”
10 Christian Bobin, La vie passante, Fata Morgana, 1990, p. 37.
11 Achar et ochèr.
12 Voici la traduction donnée par André Chouraqui du Sermon sur la Montagne au chap. 5, v. 1-12, dans l’Évangile de Saint-Matthieu :
“En marche !
Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit là. Ses adeptes s’approchent de lui.
Il ouvre la bouche, les enseigne et dit :
“En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux !
En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés !
En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre !
En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés !
En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés !
En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Elohîms !
En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms.
En marche, les persécutés à cause de la justice !
Oui, le royaume des ciels est à eux !
En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent,
en mentant vous accusent de tout crime, à cause de moi.
Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels !
Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d’avant vous.”
13 Michel Guérin, Philosophie du geste, Actes Sud, 2011.
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-comment-fonctionne-une-oeuvre
14 Bergson, L’évolution créatrice, Introduction, p. II. La citation complète est : “De fait, nous sentons bien qu’aucune des catégories de notre pensée, unité, multiplicité, causalité mécanique, finalité intelligente, etc., ne s’applique exactement aux choses de la vie : qui dira où commence et où finit l’individualité, si l’être vivant est un ou plusieurs, si ce sont les cellules qui s’associent en organisme ou si c’est l’organisme qui se dissocie en cellules ? En vain nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent. Ils sont trop étroits, trop rigides surtout pour ce que nous voudrions y mettre. Notre raisonnement, si sûr de lui quand il circule à travers les choses inertes, se sent d’ailleurs mal à son aise sur ce nouveau terrain.”
15 Balzac, Le chef d’œuvre inconnu, Le livre de poche. Cité par Michel Guérin dans Les nouveaux chemins de la connaissance du 28 octobre 2013.
16 Heidegger, Essais et conférences, Essais / Gallimard, 1954, p. 204 et sq.
17 Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses, Livre troisième, II. Milly ou la terre natale, 1830.
18 Au cours de l’écriture de ce texte, par la discrète rencontre poétique que fait faire Kleinmann au landau et à l’escalier, me sont revenues les images de la célébrissime scène du landau dévalant l’escalier du film d’Eisenstein, Le cuirassé Potemkine (1925), reprise de manière magistralement parodique par Brian de Palma dans Les incorruptibles (1987). Il est étonnant de retrouver dans cette dernière scène de nombreux autres objets qui traversent l’œuvre de Kleinmann. à découvrir !
19 La pintura y otros lugares, p. 55.
20 Jacques Derrida et Safaa Fathy, Tourner les mots – Au bord d’un film, Galilée, 2000.
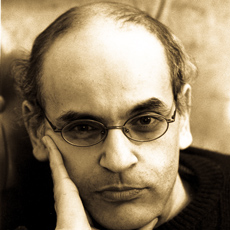
Charles Mopsik
À Alain Kleinmann, ce “Livre de la Splendeur” (Le Zohar). Pour celui qui sait si bien faire resplendir les ombres et les lumières sur des toiles tendues, morceaux de ciel qui posés sur des murs ouvrent des brèches vers des ailleurs très intimes.

Laurence Sigal-Klagsbald
CONSERVATRICE DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAISME
LA FABRIQUE DES SOUVENIRS
“Ou dans une maison déserte quelque armoire pleine de l’âcre odeur des temps, poudreuse et noire, parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, d’où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensers dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans de lourdes ténèbres, qui dégagent leur aile et prennent leur essor, teintés d’azur, glacés de rose, lamés d’or”.
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, XLVIII
La construction d’un livre redouble l’intention de l’artiste ; s’il restait une once d’inconscient dans la démarche, si le motif était encore qualifié de contingent, de secondaire ou de fortuit, la relecture de l’œuvre annule cette liberté.
La première plongée du regard dans un tableau d’Alain Kleinmann est fébrile : du foisonnement du motif, de la stratification des matières et de la cuisine des couleurs, l’œil ne sait où se poser. Comme sur un océan d’intranquillité. à la différence des maîtres anciens où le travail est dissimulé pour faire naître une surface comme stabilisée, ici l’artiste donne immédiatement à lire le temps de son travail et suscite l’archéologue dans le témoin.
Quel est ce métier ? À la fin de ce XXe siècle, la peinture peut se jouer de toutes les expériences radicales qu’elle a subies. Nous n’y réfléchirons plus en termes d’école ou de courant. Qu’est-ce qu’un langage pictural : matière, forme, ordre et couleur ? L’artiste travaillant demeure à ce niveau, il peint et ne discourt pas.
Pourtant de l’autre côté de la porte, le spectateur s’interroge à mesure que ses yeux parcourent la toile ; arrêté sans cesse par le détail, l’œil tant sollicité cherche le repos dans les images. Tandis que les couches de la matière sont creusées par le regard puis comme lentement reposées les unes sur les autres, les détails se fondent et l’image naît. Il faut parler ici d’image et non plus de motif. En ce sens, lorsque l’artiste dénie l’importance du motif, il anticipe sur la perception que nous pourrons en avoir.
La peinture d’Alain Kleinmann nécessite patience et précaution ; le discours qu’on peut y superposer doit être aussi élaboré dans les termes qu’elle est précise dans sa chimie.
Tout d’abord, il faut s’arrêter sur la disparition du dessin : point de ligne, nul aplat, nulle opposition violente de lumière ou de couleurs, nulle frontière enfin. Cette disparition incite l’œil à l’errance. Pas à pas, on entre dans un labyrinthe épais d’imbrications, de superpositions, de reprises et de masquage.
Puis s’étonner de nos questions primaires : qui sont ces gens ? Quelle est la nature des liens qui les unissent à l’artiste ? Sont-ce des photos de famille ? Où se dressent ces portes, portails et portiques, ces fières cariatides ? Pourrais-je reconnaître des gens, des lieux ? Est-ce une peinture d’observation, de mémoire ou d’interprétation ? Et la certitude que toujours l’artiste est parti d’une photo ou d’une image en miroir éveille notre soupçon. Le soupçon d’un faux. Une sorte de trucage, un piège.
Il y aurait piège, si à ce trouble ne s’associait un plaisir, une émotion visuelle indéniable. Comme si le lent travail de déchiffrage que nous impose la laborieuse démarche du peintre, nous plongeait peu à peu dans un bercement, dans la langueur d’une promenade de vieillard.
Le labyrinthe des images dans la peinture d’Alain Kleinmann s’apparente à trois structures du cheminement de la pensée : le rêve, le souvenir et l’exégèse. De ces principes de lecture, nous pouvons faire la clé de son langage pictural : stratification des fonds, disparition des lignes, surimpression des motifs et confusion des couleurs.
Le rêve procède par association d’idées dont la liberté – on le sait – est fragile et factice ; telles des irruptions fugitives dans une réalité devenue improbable, mêlée d’images anticipées ou déjà vues, se heurtant les unes les autres, les pensées rêvées cohabitent sans souci de cohérence. Comme au réveil d’une nuit peuplée des fantômes incompréhensibles d’une vie antérieure, le spectateur de ces peintures se retrouve parfois transi.
Bien sûr, il ne tarde guère à comprendre que l’émotion qui l’assaille vient d’une reconnaissance qu’il n’avait peut-être pas perçue d’emblée. Ce sont ses grands-parents après leurs noces, la photo de classe d’une grand-tante oubliée, son grand-père le caressant enfant, l’immeuble majestueux dans une capitale d’Europe centrale où ses parents étaient nés, la grille du château où après la guerre les enfants avaient été recueillis… Et puis ceux aussi qu’on ne connaîtrait pas mais qui nous seraient pourtant si familiers, formant comme une image générique du XXe siècle en Europe. Passagers et fugitifs, familles et générations, tels sont les individus offerts dans le dédale de cette peinture.
Il y a quelques années, Alain Kleinmann travaillait sur un passé plus proche, plus quotidien : les amies, les visions urbaines qui donnaient toujours l’impression d’être peintes en nuit américaine (c’était le cinéma, pas la photo alors !) les portraits vus de l’autre côté du miroir, le photographe photographié. Bref des images ordinaires, des traces banales mais jamais saisies dans leur immédiateté.
Entre le passé proche et le passé lointain, la différence ne réside pas dans la nostalgie mais dans l’invention du souvenir. Ici l’artiste admettra que se noue le fond de son travail. Jamais le tableau n’est peint al vivo. Il s’agit d’une recollection au sens français et anglais du terme : un assemblage qui puise dans la mémoire avec une sorte de tension. Si ces motifs relevaient de souvenirs spécifiques, autobiographiques, ils ne parleraient pas aussi fortement que cet écheveau de traces multiples : ce sont des souvenirs imaginaires. C’est précisément le caractère imaginaire, imaginé de cette mémoire visuelle qui rend possible un dialogue dans le regard de l’autre.
Si l’artiste cherchait à émouvoir tous les individus dont le regard un jour croiserait sa peinture, il n’aurait pas peint différemment. Les couleurs saturées s’inversent en non-teintes et en gradation d’ombres ; les contours impalpables donnent l’accès à toutes les fantasmagories. La sémantique picturale qu’élabore Alain Kleinmann réalise un tour de passe-passe qui consiste à offrir suffisamment de signes aux regards divers pour que chacun y lise son propre roman ; l’engouement que suscite son travail chez des gens si différents qui veulent le posséder, laisse penser qu’il a réussi à écrire en peinture l’autobiographie de tout le monde en accumulant des signes et des motifs que chacun peut reconnaître comme siens. C’est cela l’image générique.
Plus encore qu’une dimension nostalgique ou l’évocation d’un monde disparu qui se situe bien souvent dans des contrées d’Europe centrale ou orientale peuplées de vieux savants juifs ou de bambins à la casquette non équivoque, c’est la composition même de nombreux tableaux qui nous met sur la voie d’une des sources intellectuelles de l’artiste. L’élaboration des “images” par juxtaposition concentrique de motifs autour d’un thème central nous fait en effet immanquablement penser à la mise en page du Talmud : thème initial, suivi d’un développement, encadré par le puzzle des commentaires, des signes et des rappels. La configuration si particulière des pages de Talmud constitue une référence multiple en elle-même : à la fois topographie de la pensée, elle peut être lue comme l’inscription de l’histoire d’un savoir ; la mise en page offre la mise en perspective de références qui, ensemble, dessinent une chaîne de savoirs, une mémoire consignée, avec ses filiations et ses associations d’idées. Inscription d’une transmission (“un tel enseigne”, “un tel dit au nom d’un tel”), faisant l’objet d’un ressassement infini dans le temps. Le rêve, le souvenir et l’exégèse dévoilent en peinture leur nature profonde, leur relation fondatrice à la temporalité. Nous tenons peut-être ici une clé de la peinture d’Alain Kleinmann : elle est une remontée du temps intime, de multiples histoires individuelles avec leurs points de rencontre.
Le désintérêt, l’absence même de natures mortes, de paysages naturels dans sa peinture nous révèlent l’unique souci du peintre : dire l’individu et son histoire à la croisée de l’anecdote et du générique, construire des images de la mémoire humaine en laissant le regard de chacun s’insinuer dans les espaces libres du dessin et de la couleur.

Pierre Restany
CRITIQUE D’ART DANS LES REVUES CIMAISE, DOMUS… THÉORICIEN DE L’ÉCOLE DES NOUVEAUX RÉALISTES
Alain Kleinmann demeure pour moi l’incarnation d’un mythe de la mémoire, d’une mémoire collective, fluide et planétaire au-delà de ses fixations originelles. C’est qu’il y a au-delà de la lacérante précision de telle ou telle référence comme un sentiment de déchirure du temps, du temps de Kleinmann qui est celui des autres et qui entraîne tout naturellement les autres hors du temps. Marcel Marceau, dans un beau texte dédié à Alain Kleinmann, a bien ressenti cette impression fondamentale et furtive de l’échappée fugitive de la vie hors du temps.
La peinture vit aujourd’hui la plus grave crise de son histoire et cette crise est d’autant plus grave qu’il s’agit en fait de la crise de l’image peinte. Les défenseurs actuels de la peinture revendiquent pour elle le droit à l’expression de la masse affective immense de nos nostalgies, ce qui reviendrait à dire que ce sont d’autres formes d’art et d’autres genres d’expression qui assurent aujourd’hui le relais dans la transmission de notre mémoire vivante.
Eh bien Alain Kleinmann s’inscrit à l’opposé de cette opinion qui n’est qu’un compromis aussi bien avec l’homme et son histoire qu’avec l’art et sa poésie. Alain Kleinmann est un remarquable peintre qui a su mettre sur pied une savante technique de collages-lavis qui lui permet de réaliser, couche par couche, la plus efficace entreprise d’épigraphie de la mémoire.
C’est sans doute de cette façon, sur le plan mental, qu’ont opéré jadis les talmudistes à Babylone. Le résultat aujourd’hui, à travers l’immense tache noire de l’holocauste, est singulièrement efficace. Alain Kleinmann a le don exceptionnel de faire surgir les images poignantes, simples et définitives du souvenir à travers la stratification de notre mémoire, plus encore que de la sienne. Et c’est ce transfert implicite d’appropriation personnelle de l’information sentimentale qui nous rend les images de cette œuvre extrêmement proches, familières. Le “naturel” qui en émane les rend directement intégrables à la routine mentale et sentimentale de notre quotidien : c’est ainsi, rappelez-vous, que les images de Kleinmann échappent au temps dans la dimension objective de sa finitude.
Ces brèves et chaleureuses considérations que provoquent en moi les approches profondes de cette œuvre sembleraient prouver ma réelle connaissance du personnage. Or il n’en est rien. Je ne connais pas vraiment Alain Kleinmann. Il constitue pour moi un signal de la conscience que je reconnais de temps en temps et de façon quasi rituelle lorsqu’il m’arrive de participer à un jury qui lui décerne un prix : le prix Neumann ou le prix Wizo par exemple. Cela me suffit ; je n’éprouve pas le besoin d’aller plus avant dans la connaissance du personnage puisque ce contact est suffisamment aléatoire dans sa périodicité pour m’apparaître comme un bonheur du hasard ! Et après tout a-t-on vraiment besoin de connaître réellement un gourou ou l’auteur d’un bon livre pour en apprécier le message d’authentique sagesse et de générosité humaine ?
Seul peut-être l’œil du fou échappe aux messagers de la mémoire, et encore… La folie n’est-elle pas un aspect chaotique de la transparence de l’âme ?

André Parinaud
RÉDACTEUR EN CHEF DES REVUES ARTS, GALERIE DES ARTS ET ARTS MAGAZINE
ÉLOGE DE LA MÉMOIRE, MANIFESTE POUR UN ART EXISTENTIEL: ALAIN KLEINMANN LE NAUTONIER
C’est en faisant appel à un demi-siècle de recherches personnelles que je qualifierais de “laboratoire” du milieu artistique, et pour avoir analysé les œuvres et interrogé les artistes parmi les plus importants – Braque, Giacometti, Max Ernst, Hartung, Matta, Alechinsky, Mathieu, Soulages, Hélion, Soto, Chagall, La Poujade, Botero, Buren, Rauschenberg – que je crois pouvoir dégager aujourd’hui des observations dont chacun pourra apprécier la pertinence, à l’orée de ce millénaire, pour avoir la capacité de transformer les donnes de la quête de l’Homme. C’est à partir des perspectives et des “pouvoirs” de l’art que nos desseins s’annoncent. Il nous faut découvrir et affirmer la même puissance de valeurs qui vont révolutionner nos comportements complexes.
Tout se passe comme si les dix milliards d’humains centenaires qui transformeront demain la Terre en cerveau, riche de dix milliards de neurones pensants, s’affirmaient désormais comme les sources d’une énergie incontournable. Mais nous sommes loin d’avoir opéré, au niveau humain, aux recherches et à la mise au point des disciplines qui peuvent rendre possible cette perspective inouïe.
La notion de Temps, d’ordinaire, est le fruit d’un raisonnement-réflexe presque instinctif, né de la succession des événements que nous enregistrons et qui devient semblable à la mouvance des aiguilles d’une montre, confortant notre concept de la durée et qui marque l’existence des phénomènes dans leur succession. La chronologie a conféré au Temps une valeur baptisée objective, mais dont la véritable existence est l’irréversibilité et l’élan qui est la force conduisant tous les éléments de l’univers. Mais l’erreur, comme le dit Bergson à propos de Kant, serait de prendre le Temps comme un milieu homogène et de baptiser Temps la chronologie. L’évidence est que nous ne percevons l’existence du fluide cosmique que dans des situations exceptionnelles qui exigent de renoncer à tous les impératifs qui nous isolent et tissent nos codes habituels de pensée et de comportement. La vision de l’œuvre des créateurs artistiques peut faire naître un de ces états privilégiés.
L’effet produit par l’image “réinventée” d’un élément emprunté au réel d’un passé aigu et transformé dans un espace particulier dit artistique, offert ensuite à l’œil d’une personne installée dans son présent et traduit par un déphasement, provoque une émotion sensible qui peut accentuer, par la mise en scène de la composition, l’intensité de la couleur et la surprise. L’émotion produite par ce déséquilibre soudain peut également susciter un plaisir de découverte novateur éveillé soudainement. Nous sommes “ailleurs”. Présent, passé, ne font plus qu’un, et un fragment lentement élaboré du mental d’un “autre” est immédiatement perceptible. Le raccourci de la vision et la sensation participent à l’émotion. Notre perception du réel est transformée en un élan comme si nous disposions d’un “double cerveau” rendant perceptible l’évidence d’une autre actualité et d’un espace composite qui nous dégagerait des évidences habituelles en révélant une perception neuve d’un autre être, soudain fraternel – phénomène qui devient également une révélation de nous-mêmes, à un niveau d’innocence retrouvée. On peut poursuivre l’analyse, mais situons le “choc” qui établit un contact avec la force primitive qui a fait naître notre état sensible et conduit à l’identité de notre personnalité. Retenons que les éléments sélectionnés du Réel par l’artiste sont proposés dans une perspective originale qui conduit à une prise de conscience d’une “autre réalité” que celle qui cerne le spectateur et nous sommes invités à retrouver et à recomposer la création plastique, véritable apprentissage d’une différence avec le réel et exercice de temporalité, dans la mesure où l’amateur accepte, par ce procédé de recréation, d’éprouver l’existence d’une dimension différente mais aussi vraie que le réel et comme porteuse du “sens” des origines – le “coup de foudre” et le “plaisir d’amour” relèvent des mêmes sources.
L’apprentissage “créatif ” – conséquence du choc émotif – proposé à l’amateur, peut lui permettre une exploration initiatique capable de lui ouvrir les perspectives de l’existence d’une temporalité, c’est-à-dire l’élan du flux créateur. La première étape étant de comprendre en le vérifiant le code esthétique de l’artiste et sa quête. L’important étant évidemment de considérer l’œuvre comme un diapason d’une musique à découvrir. Nous sommes à la frontière des vérités essentielles, mais il s’agit de ne pas confondre les moyens et les fins. La Beauté est certes une réussite esthétique qui obéit à des règles formelles, mais qui peut également, par le culte qu’elle inspire, nous éloigner du sens du neuf qui nous est révélé. Elle appartient au conditionnement culturel d’une civilisation dont il faut savoir se dégager. Le vrai problème, à partir de l’émotion artistique et du déséquilibre mental que peut produire le choc émotif avec l’œuvre, est d’adopter des règles capables, à partir de l’art notamment, de nous dégager des états qui nous figent et des idées qui nous isolent.
L’art, proclamons-le, se doit d’échapper à l’ordre économique de spéculation, d’éviter les services des codes sociaux, de s’évader des influences qui peuvent aliéner ses desseins originaux. Nous devons retrouver l’élan préhistorique qui guidait nos ancêtres célébrant leurs bisons. C’est le nous-mêmes de demain qui est en jeu.
Il y a vingt ans (en 1984), j’ai fait la rencontre du peintre Alain Kleinmann dont la démarche incarnait remarquablement mon analyse de l’art. L’artiste est juif. Le peuple hébreu des origines nous a transmis le témoignage de sa langue où chaque lettre a une valeur numérique et où les mots sont semblables à des nombres. Les 613 préceptes de la Bible – qui, par ailleurs, énoncent l’existence des 365 jours de l’année – traduisent remarquablement l’héritage des connaissances d’un peuple dont la religion, avec la Tora, énonce les valeurs d’une pensée qui inspirera son histoire. Un artiste juif est en quête permanente du sens. La peinture de Kleinmann célébrait ce que je dénommais une “mémoire imaginative” associant les ressources des connaissances à une recherche de signification permanente qui en dictait les compositions au point que l’évidence de la figuration de son sujet et leur réalisation comme chacun des signes étaient à la fois figuratif et abstrait. Chaque élément semble jaillir d’une mémoire transformée, par le pinceau et l’œil, en taches, en fragments, véritable parcelle d’un langage qui, peu à peu, s’établit.
Kleinmann se mobilise aux sources de sa mémoire pour faire surgir par les signes, des formes et des couleurs avec lesquelles il trace un véritable vocabulaire. Son pinceau apparaît comme un sismographe qui retrouve les traces de tous les passés, des lettres typographiques associées aux nombres, un dessin de tissu ou une photo. Il puise avidement dans ses souvenirs comme un architecte édifiant un mur, en utilisant tous les matériaux possibles. Et cependant, Kleinmann ne s’écarte pas de la ligne de temporalité. Chaque bribe fait surgir une suite dont il établit la cohérence, d’abord par la couleur. Le sépia, par exemple, qui apparaît comme le “ciel” du Temps et situe sa dimension – tel un “murmure, dit-il, qui affirme une thématique”. Il utilise aussi le rouge qui fait vibrer le brun, et le bleu, couleur des vieux bronzes. Le temps de vieillissement des couleurs lui permet d’atteindre leur véritable densité et devient une mise en valeur de la sensibilité créatrice. Chaque toile est comme la façade d’un immeuble qui enregistrerait les traces des événements dont elle a été témoin. Cette quête de la diversité, je l’ai retrouvée également dans les matériaux – même abandonnés – qu’il utilise comme surface de son œuvre : vieilles photos, lettres, cartes de voyage…, et qui affirment leur présence comme des étrangers qu’il s’agit d’assimiler en transformant l’image. Il a particulièrement adopté le carton ondulé qu’il déchire pour faire surgir – “de derrière les choses”, souligne-t-il – un état de complexité semblable à la réalité. Il en utilise la situation comme des strates, et tous les signes comme une écriture. Kleinmann a mis au point la “fabrication de sa toile” en détrempant le papier et en le pressant ensuite comme une gravure, imprimant même les éléments en relief ou en blanc, marouflés à la colle acrylique.
Il introduit, dans son support, de véritables bas-reliefs de sculpteur dans la même matière de résine. Chaque toile compose son propre chaînon de hasard de signes et propose des chemins d’aventure qui s’ajoutent aux sujets présents. Tout peut devenir “mémoire”. On le découvre même sur la tache d’un tampon, comme pour affirmer l’authenticité d’un espace ou son contraire avec le terme “annulé” qui semble remettre en question son invention.
Il s’agit certes d’un voyage intérieur, mais dont chaque étape est un souvenir, comme des ombres sur une main, d’une mémoire, d’une vie qui passe et qu’il dégage du labyrinthe pour composer un rêve.
On a remarqué que Kleinmann, pour élaborer son message, utilisait un principe de juxtaposition concentrique sur un thème similaire à la mise en page, si particulière du talmud, encadrée par le puzzle des commentaires dessinés, “une chaîne du savoir”.
En considérant, avec l’attention d’un amateur, les peintures de Kleinmann, comme le souligne Laurence Sigal-Klagsbald, “Le rêve, le souvenir et l’exégèse dévoilent en peinture leur nature profonde, leur relation fondatrice à la temporalité.” − “Nous tenons peut-être, écrit-elle, une clé de la peinture d’Alain Kleinmann, elle est une remontée du temps intime.”
À l’époque j’écrivais, lors d’une de ses expositions : “Un ami de province, après avoir visité ‘Le Montmartre des ateliers du génie’, au cœur du Salon des Indépendants – qui évoque non pas seulement le Montmartre de la nostalgie, mais les lieux mêmes où ont été enregistrés les tremblements de terre de la sensibilité qui ont fait naître l’art et le monde moderne – me demande : “Que doit-on voir de plus important à Paris ?” Et je lui réponds sans hésiter : “L’exposition d’Alain Kleinmann”. Et je m’explique :
Que s’agit-il, aujourd’hui, de dire en peinture ? Quelle vision ouverte peut-on proposer avec un tableau ? Peut-on peindre au-delà du savoir-faire ? Est-il possible de changer en changeant la peinture ?
J’écoute la peinture d’Alain Kleinmann et les émotions subtiles qui naissent en moi : l’évidence d’abord de la qualité du dessin : d’abord, c’est-à-dire la preuve d’une authenticité instinctive. On dirait une pulsion du subconscient, un fragment arraché à une mémoire ancestrale pour nous parler d’espoir. Puis, se découvrent, comme les alluvions d’un fleuve, les indices d’une autre culture, des griffures, des graphismes, preuves d’une existence différente, de strates d’âges antérieurs et de multiples identités : un foyer de métaphores qui marie le vrai et l’inventé, le mythique et le fantasme, le souvenir et la trace. Nous sommes devant une peinture dont la dimension est le temps − dans sa substance même, sa virtualité, son utopie, sa force onirique, plastiquement transposées.
Je crois qu’Alain Kleinmann est un artiste d’une rare qualité qui a le pouvoir de nous proposer avec le sentiment de l’existence du temps − éclaté − la découverte de la nouvelle modernité.
Sa peinture n’est pas seulement une invite à concevoir une topographie particulière du tableau, mais une interrogation particulière de notre identité. Ce n’est pas un hasard si Kleinmann est nourri de la maïeutique talmudique qui permet de retrouver le sacré, au nœud des contradictions. Son œuvre nous introduit au cœur du labyrinthe de notre pensée, dans le courant de notre désir de vivre et de survivre, je dirai que cette peinture nous met dans le flux du temps, après la peur de l’apocalypse atomique. Comme si peindre était une prière et la peinture capable de communiquer la force et l’assurance d’un autre sens de la vie. Kleinmann, peintre du temps existentiel, nous le propose comme une grâce à partager. Nous sommes, nous dit-il, sur le point d’être. Un des derniers messages de Louis Aragon a été d’écrire la préface d’une exposition d’Alain Kleinmann.
Ce qu’il convient de considérer dans cette démarche d’un artiste de sa génération, c’est la force de sa vision dans le grand courant des messages plastiques. Nous sommes à une époque marquée, me semble-t-il, par la réponse des cerveaux humains au bouleversement des images, et la peinture comme l’ordinateur sont des solutions qu’il convient d’analyser. Je crois que chaque instant de notre vie est une création qui métamorphose toutes les valeurs de l’espace que nous sommes capables d’appréhender en temps, un peu comme l’aiguille d’un phonographe ou comme la chlorophylle qui transforme le gaz carbonique en oxygène. C’est peut-être cela notre fonction essentielle. C’est à partir de cette catalyse que nous existons et que le temps devient réalité. Les images sont la matière mentale de notre digestion de l’espace. Et la justification essentielle des artistes, depuis l’origine du monde, est de fixer la texture du temps-espace. Les grands inventeurs de la peinture sont ceux qui élargissent la dimension de cette connaissance existentielle. Je crois qu’Alain Kleinmann est un de ceux-là. L’image kaléidoscopique de notre quotidien, qu’il nous livre, avec une matière parfaitement plastique, une évidence figurative, mais au-delà de l’image, est une façon de nous mettre en face de ce que j’appellerais “la complexité de l’image”, qui correspond à celle que nous devons assumer aujourd’hui, pour comprendre et vivre notre réalité.
Je trouve également, dans sa peinture, une force de conviction, l’évidence du sens, l’élan qui va au-delà du dit et du peint. Je dirais un amour du spirituel, marié à la sensorialité du détail – toujours tout est vrai dans chaque parcelle de ses toiles − mais transgressé par le signe de l’homme, sa griffure, son langage, son mental en effervescence.
Les tableaux de Kleinmann sont comme une radiographie de nos âmes à la dérive du temps, dont nous cherchons à retrouver le fleuve. Je crois − j’espère − que la peinture va de plus en plus s’éloigner des afféteries et des jeux intellectuels, comme des lois de l’offre et de la demande et des procédés du marché, pour retrouver la vérité de sa force tellurique. Oui, les peintres sont des sismographes, dont le témoignage est un des rares messages qui peut nous parvenir des espaces inconnus de l’homme et de l’univers, pour nous permettre de faire le point sur les routes de l’histoire. Kleinmann est un nautonier, dont nous devons scruter l’œuvre, avec l’attention qu’on accorde aux grands voyants.
Et c’est alors que le concept de Temporalité, élément fondamental de la démarche de création artistique, a cessé d’être pour moi une hypothèse pour s’affirmer comme une valeur philosophique existentielle au plein sens du terme, et conférant à l’art une fonction initiatique qui concerne chacun d’entre nous pour trouver l’état de lucidité et de sensibilité.

Hastaire
|1| UNE SOMPTUOSITÉ CHALEUREUSE COMME UN DON
Alain Kleinmann n’est pas un peintre parmi d’autres. Une fois jetée cette affirmation péremptoire, il convient de dire pourquoi, même si ce ne sont pas les motifs objectifs de cette singularité qui font défaut.
L’abondance et la qualité des textes écrits sur l’œuvre du peintre invitent sans doute à la modestie. Nous croisons, au hasard de la lecture de tel ouvrage, tel catalogue consacré à l’artiste, d’immenses talents qui, un jour, dirent quelque chose de substantiel sur son œuvre. Comme dans le journal de voyage aux Pays-Bas de Dürer où ce dernier note sobrement “… Celui qui a rédigé ma supplique chez Monsieur Banissi est un petit homme nommé Érasme…” , nous rencontrons ici et là, Louis Aragon, Jankélévitch, Elie Wiesel et bien d’autres encore… Nous remarquons que tous insistent sur l’exceptionnel travail de mémoire accompli par Alain Kleinmann (il faut, me semble-t-il, souligner à quel point cette mémoire retrouvée, en sa picturalité, se manifeste rarement de façon aussi efficace − alors qu’elle n’est guère absente des écrits comme des écrans).
Cette importance thématique posée, il convient de s’approcher du fait pictural. Or, à cet égard, un texte ne vaut que par sa capacité à faire se lever des images, lesquelles existent dans l’œuvre, parfois de façon subliminale, parfois de manière éclatante, mais aussi aveuglante. Un peintre véritable participe toujours d’une nouvelle manière de regarder le monde, c’est-à-dire donner à voir plus que le pinceau qui nous le montre. Au-delà d’une adhésion spontanée, d’un regard vite fusionnel, l’univers de Kleinmann s’impose à nous, tant sa langue baroque, composite, semble comme impérieusement attendue, une peinture qu’on appellerait si elle ne s’était enfin révélée. Et, si cet art suscite à ce point l’enthousiasme, c’est qu’il en procède (cela tombe bien : l’Occident avait un urgent besoin de chaleur). Dans le climat artistique passablement délétère que nous traversons, il n’est pas bon d’oser la peinture. L’artiste, ici, comme d’autres, relève ce défi. (Aussi, nous sommes en droit de demander des comptes sur l’état des lieux de l’art dont nous héritons en ce tout début de siècle : les tautologies érigées en nec plus ultra de la complexité de la pensée, le signe infra-minimal qui ferait furieusement sens, la redondance archéodadaïste, tout cela fait, semble-t-il, bailler beaucoup, à l’exception des quelques-uns qui en vivent, bien sûr. Réservons-nous, ailleurs, un devoir d’inventaire. Cet héritage encombrant qui nous envahit et n’en finit pas, animé d’un dur désir de durer, ne nous intéresse que parce qu’il s’entête à s’enraciner comme arbre triste masquant les riches bois de ceux qui manifestent leur bonheur d’être libres. Libres du Prince, de son fait, des corridors où ça bruit, des minuscules officines toutes puissantes où l’ennui vient à la soupe à défaut du génie.)
C’est bien l’altérité, cette instance supposant son aller-retour, qui caractérise l’œuvre de Kleinmann. Voici un peintre qui se livre, s’expose, ose dire la peinture et ses difficultés, lui, si doué de facilités : maître en mathématiques, sémiologue, talmudiste, expert en herméneutique, comme il aurait été simple à cet Hermès Trismégiste de plaquer un vague discours savant sur une quelconque attitude formaliste ! Or, c’est dans la prise de risque que cet artiste s’accomplit ; choix de ne jamais s’ennuyer, comme celui de ne jamais accabler. Et depuis un quart de siècle nous assistons à un défilé qui nous est une fête sans cesse renouvelée ; une curiosité toujours éveillée qui cherche, trouve, s’incarne et ne se retourne pas ; qui propulse la mémoire en sa douleur comme en ses bonheurs, loin, très loin devant nous, et que nous rencontrerons à notre heure, sur notre chemin.
Aussi, parce qu’il vient du signe, du chiffre, l’artiste n’a de cesse de vouloir faire sens. De toutes façons et à visage découvert. Il sait, à l’instar de Braque, que les preuves fatiguent la vérité et, comme Montaigne, qu’il n’existe qu’entre glose, que les œuvres peintes ne sont qu’un moment de l’alphabet, les lignes de nos vies, pages que l’on tourne d’un livre qu’on ne terminera jamais.
Ces femmes, belles comme l’Orient, ces livres lus, fatigués, entassés, ces clefs qui hésitent à rencontrer leur serrure, ces vieux érudits que l’on craint de déranger, Jérusalem tant de fois céleste, toutes ces images nous regardent droit.
Somptuosité chaleureuse comme un don. Alain Kleinmann peint ces hauts plateaux que sont les villes : son histoire n’a pas partie liée avec les champs, les plaines ou autres campagnes ; non plus avec l’océan et ses rivages. D’une ville l’autre, d’un pays l’autre, une valise comme seul bien − et les livres surtout − peinture nomade. Et c’est tant mieux car les villes sont peuplées. Peuplées de ces visages qu’il nous restitue parfaitement ; ceux des siens, ceux de tous les siens. Profondeur de champ : Yvonne, Werner, Babeth, Pierre, et plus récemment, Emmanuelle et Sarah. Nets, car tout proches. Ensuite vient l’emblématique : un peuple auquel il donne tour à tour tel visage, et où chacun se reconnaîtra s’il vient de ces parages où trop a soufflé le vent de la barbarie.
Dans sa belle sobriété chromatique, peu d’artistes auront porté si haut les couleurs du judaïsme (l’approche qu’en fit Chagall, si admirable fût-elle, suppose une prise de distance par rapport à son milieu ; la peinture à ce moment de la Russie n’était certes pas un métier juif. C’est la révolution de 1905 qui lui permettra de s’affranchir et de s’exprimer avec le bonheur que l’on sait).
Beaucoup plus loin à l’est, le peintre tombera sous le charme de l’Extrême-Orient. Les images qu’il nous en rapporte reflètent son goût immodéré pour tout ce qui fait sens chez un peuple. Le hiératisme des personnages, leur noblesse, là encore, s’imbriquent avec leur écriture. Cela n’est pas fortuit : comme l’hébreu, les idéogrammes chinois sont magiques, jubilatoires, et peut-être plus encore pour ceux – dont je fais partie − qui n’en voient que la part mystérieuse du signifiant. Peut-être une piste afin de comprendre comment deux mondes si différents se rencontrent, et ne font, in fine, qu’un seul tableau ?
Baudelaire affirmait avec raison qu’un grand peintre peindra des fleurs, par exemple, mieux que n’importe quel spécialiste en la matière. Ainsi, l’artiste s’affranchit-il de temps à autre du monde hébraïque afin de moissonner d’autres expériences, partir à la rencontre de nouveaux éblouissements.
Si cette peinture captivante est très souvent voluptueuse, nous pouvons aussi remarquer une absence d’érotisme manifeste. Ce n’est point là affaire de religion : Alain Kleinmann s’octroie ce que le peintre veut. Ce n’est pas là non plus affaire de morale mais bien plutôt d’éthique personnelle, toute vraie mise en scène de l’érotisme supposant son objet à asservir. Sans doute rencontrons-nous ici le poids de l’histoire et de ses avatars. En cette mémoire, Sade ou Bataille ne peuvent être de mise.
Plus prosaïquement : comment cette magie − toute peinture efficace en est une − fonctionne-t-elle ? Ici, je serais tenté de répondre : par l’abondance de signes, de matières, de sens. Mais abondance n’est pas surabondance. Simplement, il est des peintures généreuses, d’autres qui le sont moins ; j’entends là quant à la quantité de signes transmis. Il y aurait chez cet artiste comme un devoir de complexification qui relaierait celui de révélation afin de s’incarner dans le baroquisme heureux dont je parlais plus haut (nous sommes lassés de ce surmoi minimaliste qui prétendrait nous intimer d’être très en deçà de notre ambition à habiter le monde). Historiquement le baroquisme tend à épater, réduire, récupérer, il est une politique. Dérive du langage : j’emploie le mot baroque bien plutôt comme expression d’un moi richement bariolé. Et qui se répand voluptueusement. Plus hugolien que mallarméen, Kleinmann nous offre des images généreuses qu’il se garde bien de censurer.
Dans son entreprise de complexification, il sollicite depuis longtemps cette troisième dimension qui a priori ferait défaut à l’image peinte (alors que toute trace apposée − fût-elle d’aquarelle − est physiquement une épaisseur). D’où cette richesse, ces labyrinthes, ces caches (quels dangers veut-on semer ici ?), d’où ce chant plein qui vous envahit et vous emporte. C’est à ce moment où cette troisième dimension achoppe sur les deux autres, que le peintre-sculpteur fait le saut, et devient sculpteur. Bien sûr, peut-être dira-t-on sculpture de peintre (parce que souvent frontale) ? Mais si de ces hauts reliefs surgit cette rare séduction jusqu’alors tapie dans les tableaux ? Si l’œil va et vient avec gourmandise dans les plis et replis de ces livres ensemble sidérés ? Univers unique qui brille de toutes ses teintes : noir charbon, bleu roi, vert canon, gris acier, or patiné ; palette de sculpteur que le peintre renaissant tente de s’approprier comme un nouveau monde.
Avant de parvenir, chemin faisant, à l’un de ces points d’équilibre possible qui fait qu’un tableau s’achève en une sorte d’hésitation définitive, le peintre aura mis en œuvre une alchimie très savante. Il y a d’abord l’idée, elle continue sa route et, pendant ce temps, il y a aussi de précieuses trouvailles. L’artiste fait son marché, achetant ici et là de magiques papiers. En Afrique, au Japon, en Chine, au Népal, aux Philippines, à Jérusalem aussi : de vieux plans d’urbanisation, de vieux documents qui n’ont de valeur que pour lui seul, ou à peu près. Aussi, ces superbes étoffes du Rajasthan qui participeront à confectionner la chair généreuse de ses toiles. En Europe, en France même, il écume les Puces, s’emparant de lettres, de photos, de tout ce qu’il incorporera à l’œuvre comme autant d’éléments volés. Si la photographie piège l’instant, en piégeant ces clichés, Kleinmann nous en restitue l’image insistante et pérenne ; le passé n’est jamais que du présent qui fuit.
Après avoir joué de main de maître des subtils allers-retours en quête de vérité, mais ne goûtant pas l’exactitude, le peintre prétend justement à de nouvelles conquêtes.
Il y eut d’abord ces images annulées, saturées, gommées, abolies. Ensuite vinrent ces œuvres à la mémoire lourde, à la virtuosité plus secrète, plus dense. Œuvres riches de matériaux collés, piégés, protégés, masqués, sur lesquelles l’huile, riche, encore, de son histoire à exprimer, se déposera. Et les sculptures que nous avons évoquées. Ici, j’oserais une hypothèse : les grands et somptueux papiers exécutés récemment, dans leur sobriété matiériste relative, doivent leur envol à la réussite incontestable des sculptures. Alain Kleinmann, en montant, aura suivi sa pente. D’une part, le papier − la surface retrouvée − et, par ailleurs, l’incarnation spatiale de cette complexification de l’expression d’un monde qui n’a jamais prétendu faire de la simplicité une vertu cardinale.
Que ces hautes œuvres gagnent le large, elles nous accompagneront. Et nous les écouterons.
|2| ALAIN KLEINMANN: UNE IMPÉRIEUSE LOGIQUE PASSIONNÉE
“Tous ceux qui n’ont pas le sens artistique, c’est-à-dire la soumission à la réalité intérieure, peuvent être pourvus de la faculté de raisonner à perte de vue sur l’art.” Marcel Proust
Telle une signalisation au bord des voies saturées du commentaire sur la peinture, cette réflexion de Proust devrait inciter à la prudence. Aussi, essayons de n’être point raisonnable, et ne pas perdre de vue qu’un texte écrit par un autre peintre n’est au mieux qu’un regard appuyé, enthousiaste, un signe d’amitié, d’altérité, lequel ne comble que celui qui le commet, tant l’important est l’amour porté et non celui que l’on reçoit. Même s’il s’avère que bien souvent les artistes seraient mieux fondés que d’autres à pénétrer en profondeur les œuvres qui les inspirent, la prise de risque assumée en la circonstance reste vécue le plus souvent comme une singulière effraction eu égard à l’habitude − et plus encore à ce qui se présente comme l’habilitation.
Posée cette précaution comme liminaire, prenons nos plumes les plus neuves, les plus acérées, afin d’approcher un monde qui ne se laisse pas apprivoiser facilement tant il nous apparaît richement bariolé, foisonnant à l’extrême, irréductible en ses innombrables entreprises.
Alain Kleinmann est un homme joyeux et profond, cultivé, heureux du sort favorable que l’exercice de la peinture lui a réservé, affrontant le tragique armé de son fort pouvoir de dérision, ignorant la jalousie et l’amertume, il est une force qui fonce, délaissant les détails aux bons soins des magasins d’accessoires. La formation intellectuelle de l’artiste (les mathématiques, la sémiologie), la passion de la logique qui l’anime auraient pu faire craindre l’apparition d’un plasticien sévère, rigoureux à l’excès, un conceptuel de plus en sa marée, un ennuyeux dogmatique très professionnel. Là où nous attendions Mallarmé, c’est Hugo qui vint.
Ce siècle a aujourd’hui deux ans. Et Kleinmann peint, réalise des sculptures, écrit, pense des livres avec bonheur. Sa productivité est grande, décidément tourné vers l’avenir il manifeste peu d’enclin pour le repentir. Il puise à grandes brassées dans l’océan de sa mémoire débordant d’argile humaine les éléments nécessaires à l’élaboration de son magique modelé. Un vers de Fargue semble écrit pour le peintre : “des formes se hâtent avec une sûreté ancienne”… Peut-être touchons-nous là le point sensible de cet art fait de solides fulgurances, parfois sans âge en raison d’une souveraine modernité qui ne concède rien à la mode, passerelle urgente entre des mondes que rien n’aurait dû séparer. à cette séparation artificielle des eaux, la confiscation de la notion de contemporanéité par une clique de mondains retors, Alain Kleinmann répond par l’insolence de peindre.
L’ORIGINE
LA BELLE INSISTANCE D’UN CHOIX
Dans un livre tout récent, La peinture et autres lieux (éditions Dima), composé de textes écrits par l’artiste, de photos de lieux, d’œuvres, de parents ou d’amis, de rencontres prestigieuses (Aragon, E. Jabès…), une “image” forte, un rien subliminale, clôt l’ouvrage sur une double page : le plateau d’une table de travail, des papiers en devenir, froissés, indociles telles des étoffes jetées là en attente de confection, et, posés sur la droite, des ciseaux de tailleur. Photographie prise à l’atelier. Ce mélange des genres témoigne, au-delà de l’œuvre, de l’indéfectible fidélité du peintre à l’Origine. Ici, le mode singulier est pesé.
Après Chagall, lequel aura engendré son lot d’épigones parfois adroits mais peu scrupuleux, Alain Kleinmann, dans sa belle indépendance picturale, est sans doute l’un des seuls à s’être hautement confronté à “l’illustration” de la mémoire juive, pratiquant un aller-retour étonnant entre son monde “privé” et l’universel.
“Pourquoi, jeune homme qui n’a pas vécu tout cela ? Mais tant mieux n’oublie pas, et nous aussi, avec toi” écrit fortement Ivry Gitlis à propos de l’artiste. Avec le musicien, avec le peintre, nous n’oublierons pas, nous non plus…
LES OEUVRES EN LEUR ACCOMPLISSEMENT
DEVENIR SOI-MÊME POUR SE RASSEMBLER
Une œuvre de Kleinmann s’identifie immédiatement. Toiles, papiers, sculptures s’imposent comme étant siens au premier regard porté, et ce, quelque soit le pays dans lequel on séjourne, le lieu qui les abrite, la distance à laquelle on se trouve… Nul besoin d’aller chercher la signature discrète, cachée comme dans un jeu de quotidien populaire. On dit : un “Kleinmann” ; la signature est l’œuvre. Tout simplement. Cela paraît aller de soi. Alors que, bien au contraire, en particulier pour un artiste cultivé, être soi-même à soi tout seul relève toujours d’une gageure, d’un pari gagné tant le pouvoir d’attraction des admirations est grand et envahissant. Avant cela, il faut être capable de dévorer − pour ne pas l’être soi-même − les grands autres, les intégrer, les ingérer afin de se nourrir de leurs vertus, à l’instar de ces guerriers cannibales qui imaginaient s’approprier les forces de leurs ennemis vaincus en en faisant leur repas ; pour enfin les digérer… Mais, bien qu’arrivé à cette position, cette “lisibilité” de signature, Alain Kleinmann sait fort bien que l’histoire d’un artiste n’existe qu’en constante dialectique avec l’histoire des autres peintres.
Avant de parvenir à cette invention, la somme de signes que l’on désire mettre en scène en un ordre choisi auquel personne jusqu’ici n’avait pensé tel qu’il s’offre (l’absence de style ressortant plus ordinairement d’un arrangement, d’un assemblage plus ou moins réussi de ceux des autres), Kleinmann aura connu les emprunts, les influences, les éblouissements nécessaires à la constitution, à la création de ce qui s’affirme comme sa “griffe”, sa “signature”.
Griffures, chiffres, mots, jeux sur l’apparition / disparition, toutes ces “allusions” furent l’alphabet nécessaire à une figuration nouvelle, plus complexe, plus riche de signes et de sens, apparu dans les années soixante-dix. En y apportant son tempérament à la fois logique et passionné, Kleinmann participa pleinement à cet avènement. Puis le temps, le talent, mais aussi le labeur et la ténacité firent leur œuvre : depuis beaucoup d’années, les images d’Alain Kleinmann ne ressemblent étrangement qu’à elles-mêmes…
En un temps où tout le monde fait comme tout le monde afin de se faire remarquer, cette conquête n’apparaît pas sans mérite.
LA PROFUSION
LES COULISSES D’UNE SCÈNE BAROQUE
Un goût immodéré du détournement où rien ne se risque à se perdre mais bien plutôt à se transformer : c’est avec une véritable intuition d’alchimiste que Kleinmann transmute les matériaux les plus précaires, mais aussi les plus nobles − le bon goût étant aussi éloigné de la peinture que les “belles lettres” le sont du sang nécessaire à l’écriture, un artiste devant aussi savoir, en ses manipulations, “plomber” l’or.
Les plus humbles tissus, les plus riches étoffes, les papiers modestes, ceux à la texture royale, les vieux cartons à dessin subiront le même sort : annexés, transfigurés, magnifiés, ils cracheront leurs diamants et deviendront le support ou la partie d’un tout qui s’appellera peut-être un jour “tableau” ; le vieux, le décrépit, l’usé deviendront magiquement le “poli” ou le “patiné”. Un véritable chercheur d’or est souvent un faux-monnayeur…
Ce sens rare du détournement, de la falsification, du réhabilité, accorde comme un sursis à une nouvelle vie animant ces matières qui n’en finissaient plus de mourir des morsures langoureuses du temps. Ce renouveau n’est pas un supplément d’âme mais bien plutôt une animation au sens de “donner vie” à ce cortège flamboyant que sera l’œuvre. Ce qui n’était que lettre morte devient message de vie…
Aussi, réhabilitation par une savante appropriation, qui, parfois respecte le sens premier de l’objet : ces montres à gousset montées sur socle ne s’attardant pas à courir après le temps, se contentant de nous offrir l’heure juste une fois toutes les douze heures. Avec une vitalité brûlant d’en découdre avec la matière, il agit par un impérieux désir de faire se plier les matériaux les plus divers en les appropriant à son monde avec une boulimie d’ogre sympathique. Marée qui toujours monte, train qui tente de se maintenir sur ses rails, parfois trop sage, parfois trop fou, Alain Kleinmann sait que le juste milieu est une terre qui ressemble à l’ennui.
Tant d’œuvres aujourd’hui sont muettes avant que d’avoir existé.
MATÉRIAUX
LA FIBRE INAUGURALE
Les intitulés techniques qui accompagnent les reproductions des œuvres annoncent cette profusion : papier artisanal, huile sur toile et matériaux, mine de plomb et encre sur papier gaufré, huile sur toile et sculpture, lavis sur pâte à papier et matériaux, plâtre, bronze, huile sur papier gaufré, encres sur pâte à papier et papiers divers, matériaux divers sur papier “végétal”… cette énumération nous semble nécessaire à souligner car lorsque nous feuilletons tel ou tel ouvrage consacré à l’artiste, nous nous trouvons devant une œuvre d’une cohérence rare, savamment pensée. Mais cette même cohérence prend aussi le risque de nous cacher une exceptionnelle diversité en sa curiosité, en ses découvertes.
Au-delà des intitulés qui ne sont que l’indication du choix du support, il faut ajouter ce qui se montre ou parfois se cache dans les œuvres : photos anciennes, tickets de transport ou autres, vieux papiers officiels, plans d’urbanisation…
Peu d’artistes auront eu ce rare bonheur d’invention consistant à adopter des matériaux tout particulièrement choisis en fonction de la “demande” de l’œuvre à naître.
Ces mutations sont réfléchies, examinées. Ici sont rassemblés les ingrédients nécessaires à toute vraie création : une volonté, de la jubilation dans la réalisation du projet, et ce qu’il faut d’empirisme, car n’oublions pas cette instance qui toujours amène l’artiste plus loin, le hasard. Pour beaucoup le hasard n’est que ce qui piétine dans le préconscient, cette antichambre où se stocke des “images” qui s’impatientent − tout au contraire des étoiles qui scintillent encore bien après leur mort.
L’ÉCRIT
LA LOI ET L’URGENCE
N.P.A.I. : n’habite pas à l’adresse indiquée, Les lettres, La table des matières, Questions-réponses, Vocabulaire, Idéogrammes, La bibliothèque de Mondrian, Le livre de Sarah et Yukiel, Le livre de famille, Le livre de Vilna… Les intitulés soulignent avec une belle insistance l’importance de l’écrit dans l’œuvre du peintre. Si “l’œuvre” prend en charge sa part de signifiant, le rôle du signifié est dévolu, lui, à l’intitulé. Alain Kleinmann n’a pas le goût du “slogan”, lorsqu’il s’agit de l’œuvre elle-même, il lui préfère la trace, le murmure, l’empreinte ou bien encore l’idéogramme restant à déchiffrer…
Ce rôle prépondérant de l’écriture s’inscrit très naturellement dans l’histoire particulière du peintre. Le Livre, les Textes, l’étude. Voici pour le marbre, le silex, le granit. Ensuite viennent les mots en leur ordinaire ; ceux qu’on attend, que l’on espère ; ceux qui n’arrivent pas, ou pire ceux qui n’arrivent plus. Cette tradition de l’écrit, qu’elle ait à s’exprimer soit dans le rituel soit dans l’urgence, le drame de la dispersion ou le tragique des séparations, quel peuple l’aura portée aussi haut ?
Et cette communication condamnée à ne point écrire pour ne rien dire, nous la retrouvons exemplairement, entre autres, chez Montaigne ou chez Primo Lévi.
L’artiste sait qu’on peut renverser les sens, les inverser, que le signifié ne livre que ce que l’on veut bien en entendre, enfin, avec une certaine intuition de la “chose” psychanalytique, que tout discours est le plus souvent bâti contre ce qu’il veut réellement exprimer.
SITUATIONS
L’ÈRE DÉLÉTÈRE DU TRIOMPHE DU RIEN
XXe siècle. Les écrivains écrivent, les photographes photographient, les cinéastes tournent, les comédiens jouent… Seuls les peintres n’ont plus le droit de peindre. L’Histoire de la peinture semble être restée coincée, par on ne sait quel courant d’air, à un moment mineur de son histoire, particulièrement tautologique (minimal, conceptuel). Nous sommes condamnés à vivre l’art institutionnel et international comme un “nouveau roman” définitif. Imaginons Robbe-Grillet avoir raison de tout ce qui s’est écrit depuis les années soixante ! Aussi, nous attendons que, par exemple, au Salon du Livre, les éditeurs soient subventionnés par l’état pour présenter des livres non-imprimés empilés, des presses compressées, des stylos calcinés, et interdire sous peine de ringardise l’édition de tout ouvrage coupable de sens manifeste. Qu’au Festival de Cannes on amoncelle les pellicules, etc.
Tel Diogène, nous rentrons aujourd’hui dans les lieux d’art contemporains, une lampe à la main allumée en pleine lumière, répétant devant le dérisoire étalé, exposé en majesté : je cherche un homme. Nous avons peine à voir de quel affrontement avec le tragique relèvent ces sempiternels téléviseurs empilés, crachotant leurs images forcément banales. Nous vivons l’avènement du règne de l’escroquerie du Tout - Tautologique, le dérisoire de la dérision permanente… Rembrandt, Van Gogh, revenez, ils sont devenus fous !
Les images que nous propose le vrai talent d’Alain Kleinmann, dans leur densité, leur humanité, font partie de celles qui nous consolent de ce vide sidéral en nous promettant des lendemains qui enfin donneront à voir.

Gérard Xuriguera
CRITIQUE D’ART, COMMISSAIRE D’EXPOSITIONS INTERNATIONALES
LES ARCHIVES DE LA MÉMOIRE
Continuellement en route vers lui-même, l’homme est subordonné au souvenir, à la réminiscence. Chez l’artiste, cette quête d’identité, qui passe par le défrichage des territoires embués de l’enfance, en quelque sorte le paradis perdu, s’appuie encore d’avantage sur les pouvoirs d’incarnation de son imagination, c’est-à-dire sur sa faculté de mettre en images les archives de sa mémoire.
Tantôt douloureux, tantôt attendri, tantôt ironique, mais toujours ému, ce processus introspectif conjugue simultanément songe et réalité. Et dans ces régions gouvernées par la métaphore, les ombres de la fiction sont souvent plus ancrées dans le réel que la fallacieuse objectivité du souvenir. D’ailleurs, le but de la peinture, n’est-il pas de transgresser les marges limitatives du référent, pour leur substituer la synthèse en apparence antinomique du vécu et du rêvé ? à tel point qu’il est difficile de vouloir séparer la part de l’un et celle de l’autre. “Dans l’histoire des peuples, écrit Hegel, on devrait inclure celle de leurs rêves”. Ces deux constantes, en fait, empreintes du même coefficient poétique, car issues des mêmes évidences spécifiques, établissent le juste équilibre nécessaire à l’accomplissement de ce grand théâtre de l’illusion qu’est l’art.
À partir d’un mixage d’onirique et de tangible, Alain Kleinmann travaille aussi sur les poussées incertaines de la mémoire. Il la réactive en permanence, afin de ne pas perdre le contact avec la fibre testimoniale qui le nourrit. Sachant les souvenirs fragiles, prompts à basculer dans l’oubli, face aux agressions déstabilisatrices d’une société hyper-médiatisée vouée au fugace et au transitoire, il s’efforce d’arrêter le temps, en soustrayant au néant ce qui constitue un des fondements de son existence et de sa pratique picturale.
On l’aura saisi, ses images effritées nous parviennent de contrées trop enfouies pour être délivrées autrement que par bribes et par éclats, tamisées par des flous surveillés et cependant reconnaissables, qui réfléchissent des traces du passé. D’un passé intime, partie intégrante de son être, où interfèrent, par conséquent, des notations autobiographiques, des écritures anciennes, des odeurs familières, des bonheurs paisibles ou contrariés, sortilèges d’un temps qui résiste au temps.
Alain Kleinmann affronte donc l’usure des jours, son irréductible érosion sur les êtres et les choses. Diffuse ou concentrée, son iconographie voilée, subrepticement murmurée, comme si elle ne souhaitait pas altérer sa remontée de l’arrière-conscience, apparaît fractionnée, distillée par des images décalées en amont ou en aval, à la manière d’un jeu de patience à réordonner. On y reconnaît, parfois sans véritable lien déterminé, les visions archétypiques d’Alain Kleinmann : portraits de famille, édifices levés par un graphisme sûr et délié, visages graves, groupes d’enfants indistincts, objets utilitaires, musiciens appliqués, photos volontairement désuètes. Autant de signes conviviaux corrodés par la patine des ans, qui recèlent leurs secrets et leurs émois contenus, en se coulant en surimpression dans une brume irréelle happée d’une lumière tombante.
Cette lumière, souvent mitoyenne de celle de De La Tour, par son aptitude à sublimer les sujets les plus humbles et à isoler l’essentiel, éclaire de ses phosphorescences localisées, soit des personnages au cours d’une pose, soit une silhouette solitaire, soit une barque à la voile dehors, soit un fauteuil abandonné, qui font corps avec les fonds sépia et leurs textures burinées.
Mais si Alain Kleinmann, par les effets de sa thématique à séquences, semble rejoindre l’esprit de la figuration narrative, voire son versant analytique, et bien qu’il se plaise à raconter des histoires, ou plutôt des moments de vie fragmentés, rassemblés dans une histoire globale, il cultive plus les voies de l’imaginaire que le constat. Sa perception de la surface diffère dans les moyens et la finalité.
Dans les moyens d’abord, car il affectionne les belles matières froissées, l’introduction de tissus divers, de gazes, de cartons, de tickets de transport, de vieilles lettres qu’il accumule, et n’a pas recours à de simples photo-montages, pas plus, corrélativement, qu’à l’imagerie lisse et aseptisée des tenants du courant narratif. Dans la finalité ensuite, parce que sa syntaxe est chargée d’humanité, de toutes les sensations amères ou jubilatoires qui rendent notre quotidien si précieux et si touchant, à l’opposé de la figuration analytique, volontairement froide et tournée vers l’enregistrement du document.
Toutefois, dans cette vie en suspens, la nostalgie n’est jamais passéiste dans la mesure où nombre d’emblèmes de notre quotidienneté connotent de leur poids intrinsèque le sens des compositions. Superposés et dilués sur la trame rugueuse du tableau, ils provoquent des affaissements et des boursouflures, des replis inattendus et de soudaines ruptures qui respirent au diapason des contre-jours et des textures oxydées et décrépies, en les revêtant d’un ton très contemporain.
Une telle inclination matiériste nous rappelle l’intérêt d’Alain Kleinmann pour les passages suscités par la peinture abstraite. Alors, sans dissoudre le sujet ni choir dans le mimétisme, il en utilise les ressources plurielles et l’autonomie des unités. Tensions et pigmentations, étendues accidentées et plages lacunaires scellent ici des alliances aventureuses qui vont permettre la mise au jour superposée des figures et des objets. Un métier éprouvé, une pensée économe, accompagnés d’une gamme chromatique réduite et infiniment nuancée, rythment ces toiles lissées de sonorités nocturnes entrecoupées de fulgurances, où espace, substance et motif ne sont qu’un.
Depuis longtemps maître de ses pouvoirs, Alain Kleinmann nous offre une œuvre mûre et cohérente, dont la présence singulière procède à la fois de la tête et du cœur. Une œuvre enfin, qui dans sa longue transhumance intérieure à travers le temps, ne cesse de nous ramener au nôtre.

Thomas Robache
MON PÈRE EST UN TABLEAU DE KLEINMANN
Même si je suis plus âgé que lui, je me considère comme le fils naturel d’Alain Kleinmann. La filiation est évidente : mon père, de notoriété publique, était un tableau de Kleinmann.
Je n’évoque pas ici son apparence de beau mec glabre au regard noir mais son histoire. Il traverse à pied le pont de Kehl en 1933 et c’est déjà un lavis de Kleinmann. Il survit sur les marchés de Belleville pendant le Front populaire et c’est une toile kleinmannienne parcourue de tampons, de caractères et d’indications mystérieuses.
Soldat démobilisé, il démonte la carcasse des bœufs dans les abattoirs du Périgord. Il est donc définitivement un grand format de Kleinmann avec son livret militaire en voie d’effacement, les dernières lettres reçues de Forêt noire… et toujours les photos sur les murs tellement humaines mais tellement allemandes.
Alors tout s’enchaîne. À la fin de sa vie, alors qu’il se prépare méticuleusement à accueillir la maladie, mon père, laïque convaincu, s’acharne à ramener triomphalement à la maison des croûtes intégrant obligatoirement, et dans le désordre, une bougie, un caftan, des barbes tristes et quelques prières éparses.
La famille lassée pousse un long hululement de désespoir sous les murs encombrés : “Toi dont la culture est le bain quotidien, trouve-nous un peintre… juif mais, s’il te plaît, un peintre…”
Une bougie à la main, je cherche, je cherche encore et j’échoue. Plus exactement, je dérive dans ma recherche. En fait, je rencontre un peintre, un homme… mais, s’il te plaît, un peintre.
Depuis cette très ancienne rencontre, je regarde Alain caresser nonchalamment les techniques dans le sens du poil de pinceau, l’aisance du trait, les couleurs du temps ou d’un autre temps, les supports, les matières.
Il pourrait être “trucs et ficelles”. Il pourrait être un homme facile. Je l’ai vu sur une nappe de restaurant remporter contre un artiste de renom une invraisemblable battle du trait improvisé. Alors il se lève. Il dit à voix intelligible : “ En vérité, cela ne me suffit pas ”. Il ébroue sa courte silhouette et marche au-delà. Il pousse l’élégance jusqu’à faire oublier son talent, sa facilité. Quand il peint, il parle aux autres. Mieux, il les écoute. Et la technique s’efface devant l’intention. Et l’intention s’efface devant l’aboutissement.
Souvent je compatis. C’est un travail harassant pour un artiste de juxtaposer un langage à son travail. Double langage : une peinture vers l’intérieur, une parole pour l’export qu’absorbent critiques et acheteurs avisés.
Alain Kleinmann fait radicalement l’économie de cette parole exportable. Besoin de rien. Il parle de ce qu’il sait, de ce qu’il aime. Il parle de vous. Il peint même de vous. Il a raison : ses tableaux se débrouillent tout seuls.
Bien sûr qu’il a une histoire, celle de son père… et celle du mien. Cela ne constitue jamais un territoire, ni un enfermement. Il franchit les lignes de démarcation avec des papiers fatigués et peu plausibles… Il salue bas une vieille dame très digne à Bangkok.
Il gravit sans même être essoufflé les escaliers d’avant Fidel à La Havane. C’est toujours un monde tendre malgré l’inquiétude légitime. Un monde ou l’on pressent l’événement qui va survenir, un monde d’après le séisme, quand les fleurs repoussent et que le vivant reprend sa place.
Sur tout cela, j’aurais aimé avoir le temps de dialoguer avec mon père. Il me reste toujours les expositions d’Alain Kleinmann.

Jack Lang
L’horizon de toute pratique artistique d’avant-garde, comme l’ont montré de nombreux courants poétiques et philosophiques du XXe siècle, et notamment dans la peinture avec les révolutions impressionnistes, cubistes, surréalistes, demeure la transformation du monde. En questionnant notre imaginaire collectif, en projetant de nouvelles visions, l’art nous appelle à inventer d’autres possibles. Ce travail de création artistique est ainsi au cœur des dynamiques culturelles qui nourrissent nos sociétés.
La culture est source d’une énergie incontournable, le terreau vivant, le socle fondamental sur lequel se bâtissent les activités économiques et sociales d’un territoire. Une vie culturelle riche insuffle un élan essentiel au tissu urbain et social. Elle est ainsi un facteur puissant d’intégration sociale et de lutte contre les inégalités. Une politique culturelle véritable a donc pour vocation de libérer ces énergies en donnant la priorité aux forces de la découverte, de l’esprit et de l’imaginaire, pour construire l’avenir. Il s’agit ainsi de valoriser toutes les ressources et les gisements d’intelligence encore inexploités.
La culture n’est pas un bloc figé, c’est une sorte de mémoire vivante, en renouvellement permanent, ancrée dans un héritage commun. Il s’agit de trouver dans ce patrimoine la source des progrès des développements futurs. La transmission de notre mémoire collective devient alors l’affaire de tous, et notamment celle des artistes, comédiens, musiciens ou peintres ; il leur appartient, chacun dans leur domaine de prédilection, de participer à cette quête collective et indispensable.
La démarche artistique d’Alain Kleinmann autour de la mémoire est en tout point remarquable. Je connais et apprécie le travail de cet artiste qui œuvre avec passion et détermination. En contemplant son travail, on ressent au plus profond de soi une impression qui mêle l’immédiat et l’immémorial. Au contact de ses tableaux, on éprouve le vertige de l’interrogation sur l’identité de l’homme mais aussi sur celle du temps…

Richard Dembo
Le Baal Chem Tov, lorsqu’il voyageait à travers le pays rencontra un homme dont la fortune avait fait la renommée. Le Baal Chem Tov le prit par le bras et l’entraîna vers la fenêtre. “Que vois-tu par cette fenêtre ? – Je vois la ville, la place du marché, les marchands, la foule qui se presse”. Le Baal Chem Tov l’entraîna alors vers un miroir. “Que vois-tu maintenant ? – Je vois mon visage” répondit l’homme, sans comprendre ce que le Maître voulait lui dire. Le Baal Chem Tov s’expliqua : “La fenêtre comme le miroir sont faits de verre, seulement derrière le miroir, on a rajouté un peu d’argent”. De même l’art peut servir à vivre le monde ou à s’en séparer et il est des peintres qui usent de leur art comme d’un miroir, d’autres comme d’une fenêtre. La peinture d’Alain Kleinmann s’ouvre aux autres, elle donne à voir, à vibrer, à sentir. Elle dit aussi avec pudeur et profondeur l’histoire et l’âme d’un peuple, sa mémoire, son espoir et sa pérennité. La peinture d’Alain Kleinmann dépasse l’anecdote ou la mode pour venir dire un moment d’ineffable.

Daniel Mesguich
Alain Kleinmann, dit-on souvent, est le peintre de la mémoire. Mémoire des visages révolus, des choses cassées, jetées, abandonnées. Certes. Mais que nous la regardions, et alors sa peinture nous regarde, et ces visages nous dévisagent. Et voici qu’il est le peintre de l’oubli, aussi bien, et de ce que les visages, les choses, nous sommes sur le point, toujours, de les perdre…
Flaubert, à peine rencontrait-il quelqu’un, le voyait immédiatement, prétendait-il, déjà mort, cadavre en son cercueil. Kleinmann est le peintre du déjà.
Il est le peintre du encore, aussi bien : « encore là », disent les visages, disent les choses. « Pas encore cendre, pas encore rien ». Il est le peintre de ce qui reste quand « ça n’est plus ». De ce qui revient quand c’est parti, du retour de la dispersion. Il est le peintre de la Revenance. Le peintre des spectres.
Mais, en peinture, on le sait, tout, toujours, n’est déjà plus ; rien, jamais, n’est encore là. Les choses, les visages, n’y sont pas : en l’image peinte d’une pipe, n’est-ce-pas, aucune pipe.
Mais pour que l’image peinte d’une pipe existe, il a fallu qu’une pipe, ailleurs, existât… Le mouvement de cette spectralité, cette revenance, c’est cela, que Kleinmann peint. Ça ne va pas sans dommage pour la pipe. On ne peint jamais que des ruines, semble-t-il dire à chaque œuvre. Et l’on ne sait plus, déjà, on ne sait pas, encore, si, à tel endroit ravagée, cette colonne est de pierre ou si elle est de peinture.
Car Kleinmann ne dit pas seulement la mémoire de la catastrophe qui s’est abattue sur le peuple juif, même s’il la dit (les numéros qui marquent, ici ou là, presque toutes ses œuvres – cryptés, eux-mêmes à demi-effacés, mutilés, ou intacts et aussi visibles qu’un titre – suffiraient douloureusement à le signifier, qui s’y impriment à vif comme sur l’avant-bras d’un déporté).
Il ne dit pas seulement, même s’il la dit, la mémoire de quelque passé, dérisoire ou splendide, il ne cueille pas, n’accueille pas, ne recueille pas seulement telle machine à coudre, telle clef, telle lampe, telles chaussures, tels livres jamais plus ouverts, telle valise, telle montre, tel landau, tel fauteuil dont les mites elles-mêmes déjà ne veulent plus, telles lettres ou formulaires, telle photographie de femmes ou d’hommes, de famille entière assassinée, d’hôtel ou de palais déserté, à la peinture ou la texture brouillée (c’est que ce n’est pas qu’il peigne « à partir » d’objets ou d’images « déjà » existants, c’est que ceux-ci lui sont véritablement un pinceau et une première peinture ; l’autre peinture, celle de sa palette, se mélange à la première et, de sembler chercher à l’effacer, la vivifie, la rappelle), objets à la peinture ou la texture rouillée, vert-de-grisée, sépiaïsée, ocrée, jaunie, crevée, éclatée, coulée, boursoufflée, fripée, bubonnée, squelettée, ruinée, gercée, etc. Et c’est comme autant de cris poussés par les choses avant de sombrer dans le glacial silence de l’oubli.
Il ne dit pas seulement, même s’il les dit, des visages d’hommes et de femmes qui ont été. Qui ont eu des joies, des peines, des déceptions, des projets, des rêves, des amours (certains n’en ont même pas eu le temps), et, par l’obstination de ses compositions (car Kleinmann compose, oui, comme on dirait d’un musicien, et c’est en jouant, lui, et en se jouant, de la décomposition, car la lave qui a tout ruiné n’ a pu laisser cette corde intacte, et cette page ne peut tenir seule en équilibre dans cette cage, ou au bord de cette chaise), des visages à qui, il semble tenter-follement-de rendre leur poids de vivants sur la terre, de restituer follement-comme pétris, nouveaux golems inoffensifs, à partir de la cendre qu’ils sont devenus -, leur regard d’humain.
Il ne dit pas seulement-follement-la suspension de la décomposition, de l’engloutissement inéluctable dans le lac de l’oubli (qui est la matière même du monde, disait Borgès)-car lui ne s’y fait pas, à la disparition totale, à la dissolution à jamais, à la « perfection » de la mort, alors il la brouillonne, il la cochonne…
Il ne dit pas seulement le passé (et que ceux-ci avaient été des vivants) ; et par ses « fausses » jaunissures, ivoirisations ou sépiaïsations, il ne dit pas seulement le présent (et que cela n’est plus et que nous devons nous souvenir). Même s’il les dit.
Il ne dit pas seulement, non plus, qu’il dit pourtant si nettement, le peindre de la peinture ; que le référent n’est jamais dans le tableau, que la pipe peinte n’est pas un pipe, et qu’on ne peint jamais (selon les lois de la perspective ou pas, sous tous leurs côtés ou pas) que la ruine de tout motif…
Non.
Ce que dit Kleinmann, c’est le passé, certes, le « cela a été », mais l’à-venir, aussi bien, le « devenir ruine ». Sa peinture rappelle autant qu’elle anticipe. Ce peintre de la mémoire ne connaît pas la flèche du temps.
Et voici l’événement, le coup de tonnerre de la pensée-peinture de Kleinmann : de donner face à l’Effacé, de donner figure à l’Infigurable, visibilité à l’Invisible, représentation à l’Irreprésentable (car ses peintures ne sont pas des spectacles, il n’y a plus, là, de spectacle), il en vient à nous faire voir, à nous faire entendre l’Irreprésentable en tout représenté, l’Infigurable en toute figure, l’Invisible en tout visible.
Non plus le thème de la ruine (qui serait encore un spectacle), mais cela qui ruine tout thème.
C’est chaque chose du monde, et chaque vivant du monde, en son « essence », c’est à dire en son spectre, que dit Kleinmann.
Ce que dit Kleinmann, ce que chante Kleinmann, ce qu’il sculpte ou bien qu’il peint, c’est le spectre du monde. C’est le monde.

Daniel Sibony
Psychanalyste, auteur entre autres de Création, essai sur l’art contemporain (Seuil, 2005) et de Fantasmes d’artistes (Odile Jacob, 2006)
KLEINMANN TEXTURE LA MÉMOIRE
Le travail de Kleinmann touche à l’essence de la peinture qui n’est pas dans le thème traité mais dans la peinture qui l’incarne. Mais ce travail pictural est occulté quand on ne voit que l’aspect commémorant un monde disparu, même si on y voit une beauté plastique évidente.
Car cette beauté est intrinsèque à la texture même de l’image, texture en symbiose totale avec le thème qu’elle traite qui est la résistance à disparaître d’un monde qui a disparu mais qui persiste dans le nôtre et en nous-mêmes si on veut bien le chercher. Et on ne peut que vouloir, vu que cette recherche est celle de la présence même et de la manière dont elle travaille nos textures intérieures ; là où s’intriquent des perceptions et des mémoires où l’on peut se reconnaître puisqu’elles concernent la manière dont la chose revient en force à travers son effacement.
Au-delà de paradoxes apparents, l’artiste montre l’apparition et la disparition ; la présence dans le travail de l’absence ; l’émergence dans l’effritement ; il rend tout proche l’éloignement et tout cela crée une pression inflexible du temps à prendre, au moins avec le regard.
Devant ces choses familières – « gares, lieux publics, mouvement de foule, rapport entre les regards, scène théâtrale, espaces de murmures inquiétants, d’espoir et de lueur nichés dans les ombres » (Aragon), le spectateur qui regarde comprend inconsciemment que ces lieux sont ici « passés » par leurs états limites : par l’arête où le monde bascule sous le poids de corps qui tombent par millions.
Il y le geste de faire parler la mémoire qui dort, la faire parler dans l’état d’hallucination où elle se trouve et d’où c’est elle qui questionne notre réalité. Et bien sûr, ce geste donne de quoi nourrir des mémoires affamées, celles qui ont refoulé l’événement et consentent sur le tard à s’en approcher peu à peu, de plus en plus, jusqu’à ne voir que lui. Ce geste nourrira aussi d’autres faims qui s’ignorent, de ceux qui n’ont pas encore compris que cette histoire leur est arrivée à eux aussi. Mais je dis que ce qui leur est montré et qu’ils peuvent voir dans ces œuvres, au-delà du geste qui la leur donne, c’est la texture de cette mémoire, si précise qu’elle touche aussi à leur mémoire.
Bien sûr cela se fait principalement via la mémoire du peuple juif mais le fait est que cette mémoire est rythmée depuis toujours par la menace de disparaître et l’insistance et l’envie de réapparaître mue par une force automatique qui la dépasse. Car ce peuple ne se définit que par sa propre transmission, celle qui le porte et le traverse, qu’il délaisse ou qu’il retrouve, qui le perd et le retrouve ; il vit ensemble au rythme de l’effacement presque imminent et de la résurgence. Même la Bible, texte noyau, vibre de disparition menaçant le peuple à tout moment à cause des autres ou de lui-même, et de retour mille fois promis et plus ou moins ratés.
De sorte que la texture de cette mémoire c’est cette mémoire elle-même ; et l’artiste ici mène ce travail de textures par l’image et parlécrit ; en texturant son peuple juif, il texture toute mémoire, en cela il fait œuvre singulièrement universelle.
Toute beauté est somatisation de l’amour, et la beauté de ces œuvres somatise l’amour qu’il a pour cette texture de la mémoire que chaque œuvre décline fil à fil.
Car comment faire vivre une mémoire qui s’est pétrifiée, comment y toucher sans qu’elle s’effrite ? C’est le danger qui guette Pompéi détruite et figée par le feu : dès qu’on y touche ça s’effrite dès qu’on découvre ce qui a disparu on aggrave sa disparition. Mais la peinture de Kleinmann échappe à ce danger, mieux : elle l’utilise car c’est avec l’effritement qu’elle réinscrit la mémoire, qu’en un sens elle renouvelle.
Chaque thème est une charge de temps que la peinture décharge sur nous à bout portant, de quoi blesser nos regards de pur semblant et nous appeler à une vision plus lointaine. L’artiste active une mémoire en peinture et par là-même nous invite à questionner l’action de la mémoire ; sa passion ou son actif autant que son passif.
Il nous fait croire qu’il nous montre la mémoire alors qu’il nous montre plutôt sa morphogénèse et sa question radicale : de quoi est faite notre mémoire et comment est-ce qu’elle travaille, à supposer qu’elle travaille ?
La mémoire que peint Kleinmann est en route, elle avance vers la suite à partir de quelques racines que la suite rend indestructibles. Il fabrique du passé mais au présent, et en passant il redonne vie à un monde disparu et ce qu’il nous donne c’est de la réapparition.
Lui-même a trouvé le moyen de faire passer tout ce qu’il nous montre par une certaine usure du temps autrement dit par son passage, où un déclic essentiel est l’éclipse et le retour, le retour incessant de ce qui s’est éclipsé. S’il transforme tout ce qu’il touche en mémoire c’est qu’il fait dessus le travail même de la mémoire, de l’oubli et du rappel. Car la mémoire rappelle les choses qui s’éloignent et quand le rappel réussit, elles sont présentes et nous offrent en prime tous l’écart de temps qui sinon se serait perdu.
En quoi il retrouve l’essence de la peinture : un tableau ce n’est pas de l’espace peint c’est un objet porteur de temps multiples qui est prêt à en donner si on sait le prendre, et de toute évidence, le temps ne se donne que si on sait le prendre, si on sait recevoir les objets-temps.
L’artiste fait cette opération, celle de créer des bulles de temps à partir d’objets quelconques : il prend l’escalier d’un perron de la havane (une ville qui déjà par elle-même est une mémoire d’où sans doute son enthousiasme pour Kleinmann) et il lui fait subir un traitement, une sorte d’affaiblissement, de quasi évanouissement qui fait que l’œuvre devient un rappel à la vie de cet objet qui allait disparaître ; l’œuvre se rappelle à la vie et transmet ce rappel.
Les photos ponctuent, on le sait, cet effet de disparition contrariée ; car ce qu’une photo nous donne c’est l’instant d’une mort qu’elle contrarie et nous charge de faire revivre. Chez Kleinmann, cette charge est énorme en même temps que ludique : une feuille peut être lourde, un bronze peut sembler voler, tout dépend de ce dont ils sont chargés.
Une œuvre aussi légère que l’Atelier avec sa machine à coudre est écrasante. Elle est recouverte de chaux et cela évoque celle que répandait les nazis sur les fosses communes ; du coup, la machine à coudre devient symbole non seulement de la vie des ateliers anéantie mais de la Shoah elle-même. Elle devient un objet et sa représentation. En cela, elle approche le registre du divin sans aucun fétichisme, registre qui se définit par l’identité entre le nom et le corps, sachant que le corps divin ou plutôt sa présence, ce par quoi il fait habiter son Nom, c’est l’ensemble de tous les noms qui s’y rapportent, tous les fragments de sa parole possible ; c’est donc le corps du texte et sa transmission c’est-à-dire le déploiement vivant de la texture en marche.
On voit comment ce travail donne dans le même geste la présence, la présentation et la représentation, aussi bien des objets que des êtres. Et c’est possible parce que, encore une fois, il y a identité entre la mémoire juive, sa présence, ses représentations et sa texture.
D’ordinaire, on oppose matière et mémoire ; or c’est ce que j’appelle un entre-deux, une dynamique d’entre-deux, avec des croisements récurrents : il y a la mémoire de la matière, c’est toute la physique qui l’explore à l’infini, et il y a la matière de la mémoire, et c’est ce que peint Kleinmann. Bien sûr d’autres artistes peignent aussi la chair de leur mémoire inconsciente qu’ils mettent à vif sur la toile ; mais ici, c’est différent, c’est la mémoire des choses et des êtres qui est peinte, activée par celle de l’artiste devenue chose parmi d’autres et en même temps catalyseur de cette chimie qui fusionne les noms et les corps. Un peintre comme Soutine peint la mémoire de son peuple, sa chair en détresse et rejoint les gestes de ce que sera l’expressionnisme dont je pense que la vérité est de faire se rejoindre le nom et la chose. Kleinmann peint la mémoire des choses, c’est une façon de les rappeler à elles-mêmes et à nous, donc une façon de les appeler, de donner leur nom en peinture.
De ce point de vue c’est au travail de Jasper Johns que je voudrais le comparer, celui qu’il fait dans ses chiffres, ses drapeaux et ses cibles. Son drapeau, il le porte et le plante au cœur de l’art de telle façon qu’on ne sait pas si c’est le drapeau qui est peint ou la peinture qui se fait drapeau. Celui-ci devient un objet-symbole produit par touches et retouches de tout le drame qui l’a engendré (ou qu’il a engendré) et dont il serait la mémoire, la mémoire-peinture. L’artiste le constitue pendant qu’il peint entre l’image du symbole et le symbole de la présence, et cela nous restitue le sensuel des mémoires pour lesquelles il fait sens. Kleinmann nous donne leur sensibilité, la sensation qu’elles deviennent. Ces images qui ne sont pas là que pour mémoire sont des sensations de mémoire où clignotent le passage du temps et l’émotion du temps retenu, elles concernent tout ce sur quoi le temps a passé. Chaque image est un chant au temps retenu, un clignotement de la mémoire en attendant ; mais quoi ? Le nouveau commencement. Ce terme que la Genèse nous donne en guise de premier mot, comme le symbole et le moyen de la Création.

Michel Gad Wolkowicz
ALAIN KLEINMANN OU L’OMBRE DE L’OEUVRE : PEINDRE L’IMPOSSIBLE
MÉMOIRE, TRANSMISSION, CRÉATION, ART, PSYCHANALYSE, PENSÉE JUIVE
« En Zikharon ele lealma deate – Il n’y a de mémoire que dans le monde qui vient. » (RabbI Nahman de Bratslav)
« C’est le langage qui assure – dans l’instant du nom – la désignation du lieu comme figure. » (PIerre FédIda, «Topiques des lieux», Le Site de l’étrange)
Un édifice invisible
«Il y a en effet un chemin, écrit Freud, qui permet le retour de l’imagination à la réalité, et c’est l’art.» D’où vient ce génie, ce miracle chez Alain Kleinmann, cet être de patience et de déter- mination, cet artiste qui transmute ces traces et ces registres enfouis redevenant sensibles, en souvenirs et en œuvres d’art? En tendresse intense. Nous les portons ces figures d’enfants, d’étudiants, de femmes dévouées et dignes, ou de vieux sages, elles deviennent un moteur plutôt qu’un gel mélancoliforme. Les mots, les images y sont à la fois une mémoire commune, fami- lière et toujours renouvelée. Les œuvres d’Alain Kleinmann constituent pour la mémoire col- lective et pour chacun, non pas des reliques ou des fétiches, mais des documents de mémoire, des restes de vie, des empreintes pouvant être empruntées par chacun singulièrement pour reconstruire ou plutôt réactiver, réactualiser, cet édifice invisible dont nous héritons et que nous avons à transformer dans une transmission réciproque. Histoire et histoire s’intriquent, s’éclairent et nous éclairent. D’où l’universalisme du singulier, une expérience profonde de subjectivation, produite par cette œuvre.
Merci infiniment à chacun des contributeurs, pour leur implication enthousiaste, pour leurs apports diversifiés, brillants, approfondis, sur l’œuvre et à partir de l’œuvre d’Alain Kleinmann, et aux axes thématiques engagés. Leurs regards nous enlèvent, nous accompagnent tout en nous ouvrant à des possibilités de représentation et de lecture plurielles et renouvelées. Des réflexions exhaustives passionnantes dégagent des points de force et déplient des problématiques essen- tielles avec une créativité stimulante, aiguisant le regard et la pensée.
« Il y a des larmes et des rires dans les choses » (Daniel Mendelsohn, The Lost)
Alain Kleinmann transfigure le monde, fictionne les mémoires, des images que chacun peut se réapproprier dans sa culture, sa langue, ses traditions, ses couleurs. Il joue avec les objets, ainsi que Winnicott le dit des enfants sains, avec les mots, avec les signes, car le jeu est une affaire sérieuse, il ne joue pas à, il joue avec, c ́est un play, pas un game. Les objets simples nous illu- minent, fragiles. Un monde englouti, disparu, six millions de visages, d’histoires, qui travaillent, étudient, souffrent, rient, démunis, en détresse, qui ne cessent d’espérer, de transmettre, d’en- richir le monde de découvertes, de créations. Des visages de femmes, de talmudistes, de musi- ciens, de rabbins étudiant, sont magiquement nimbés, dorés, pensifs ou extatiques. Chaussures d’enfants et valises abandonnées, ou stockées et numérotées, livres de prière et lettres en yiddish recouverts de poussière, emballages effilochés, photos jaunies sans noms, chevalets et vieilles machines à coudre et à écrire, clefs et passeports déchirés, cartes postales jamais arrivées, montres, petits landaus pour poupées esseulés, restes d’escaliers vacillants au milieu des gravats d’im- meubles aux trois quarts démolis, de couvertures de vieux ouvrages, d’alphabets étalés, de salles d’études, des paysages de désolation, mais aussi de lumière, des objets familiers, des noms orphelins, des rouleaux de la Thora froissés mais infinis ; la misère profonde avec, en arrière-fond, la tourmente, les pogroms, les trains, les convois inexorables des déportations vers les camps de la mort, que les images transcendent en parcelles d’un langage qui rétablit le murmure du temps, de l’intime; les strates du psychisme au travers des résines, les cartons marouflés, les colles acry- liques, les gravures repeintes, les tampons rouges administratifs, comme un voyage et une topographie d’un temps intérieur; des ombres des souvenirs, des rêves d’une mémoire ances- trale. Qu’étaient-ils, qu’étaient-elles devenues? Où? Une vérité matérielle et psychique se dégage avec une force de conviction qui participe du vertige de l’identité et du temps d’un trouble des évidences, et de réalité qui étrangérise la pensée.
«L’art est, comme la prière, une main tendue dans l’obscurité, qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne », écrit Franz Kafka, non pour dire que ce fut mais pour dire que cela peut encore être, que cela se doit, encore, d’être.
Transformer le mortifère et la compulsion de répétition en forces de vie, la destructivité en créativité…
La création artistique « est le souvenir de leur mort et l’affirmation de notre vie ». « Souviens-toi de ton futur», dit à sa façon Alain Kleinmann, reprenant l’intuition de Rabbi Nahman de Bratzlav qui écrit : « Il n’y a de mémoire que dans le monde qui vient », soulignant que le Olam haba n’est pas le moment futur mais le monde en train de venir. Le monde que l’on fait advenir par son engagement et sa participation au monde et à l’histoire.
L’œuvre de Kleinmann s’appuie sur la mémoire, non pour s’y réfugier ; mais pour lui donner sa place, un lieu, des limites, une frontière, une frontière à traverser. Non pour se retirer mais pour voyager. Ce n’est ni lamentation ni nostalgie mortifère ou fixation mélancolique et, s’il y a de la rage et de la tristesse bien évidemment, réduire cette peinture à ce regard en arrière serait figer le geste artistique qui est justement une façon à la fois d’assumer la mémoire et de ne pas s’y enfermer, de partager la douleur mais de nous conduire au-delà de la souffrance, une force au contraire pour assumer le rôle testimonial : «un océan d’intranquillité!», selon Marc-Alain Ouaknin. L’unique souci de l’artiste : l’individu et son peuple. Un regard profond et tendre sur eux, sur nous. Leur histoire singulière et collective, de multiples histoires avec leurs points de rencontre.
Plongés dans chacun de ses tableaux, de ses compositions, nous retrouvons le fonds commun, ce qui nous fait nous réunir sur et autour de ce qui fait peuple qui se donne comme destin de combattre le destin, y compris celui qu’il se donne! Un destin tordu, d’angoisse ou de rire…, assumant une éthique de vérité, de responsabilité, d’élévation-élection de l’intellectualité, l’am- bivalence et ainsi la conflictualisation psychique, refusant la soumission et l’absolution, ouvrant aux champs de l’inconnu, de l’indéfini de la pensée, de la métaphore, du transfert, à l’infini plutôt qu’à un absolu. Tirer des événements une expérience, et faire d’une expérience un évé- nement, s’y appuyant pour transformer, créer, ainsi restituer à nos parents ce qu’ils n’ont pu nous transmettre de leur héritage, assumer d’être les «témoins des témoins», comme l’écrit Régine Waintrater dans Sortir du Génocide, seule façon de leur être fidèles, eux qui ont construit en eux, ensemble, une extraordinaire puissance de survivre à l’effroyable, à l’absolu non-sens, aux deuils impossibles des millions d’assassinés et des chers disparus, à la destruction, à l’exter- mination, à l’éradication de leur existant, mis hors monde, à l’enfer inimaginable, survivre pour eux, les disparus, pour nous les enfants, saisis entre le désir de nous protéger de l’horreur innommable, et de nous transmettre la mémoire des nôtres, de notre peuple, l’histoire et ses leçons, et le sens de continuer. Eux qui ont puisé cette formidable volonté de transformer le mortifère et la compulsion de répétition en forces de vie, la destructivité en créativité. Paraphrasant Georges Perec, la création artistique « est le souvenir de leur mort et l’affirmation de notre vie. »
Alain Kleinmann leur a redonné leur dignité, leur humanité.
Une tendresse infinie nous imprègne, mais non sans admiration et fierté pour ces gens simples, pauvres, rendant vivante une culture si riche, les musiciens Klezmer, violons, clarinettes, accordéons, accompagnent un alphabet nomade, les pages d’un album-photos d’une tante fris- sonnent, des femmes dont la beauté généreuse et l’intelligence du regard transcendent les nuages noirs déjà présents, des pères protecteurs, et aussi en écho la musique cubaine, sa sen- sualité, ses volutes de Havane. L’horreur n’est jamais représentée, risquant d’effacer, d’annuler la richesse spirituelle, culturelle de ce monde. Le vide, l’exil, la mort, la disparition, s’imaginent en creux des accumulations, des manuscrits.
Schmattehs
Cela rue de Paradis au cinquième étage. Un atelier immaculé a contrario de ce qu’exhibent certains artistes afin d’entretenir le mythe de l’artiste maudit, évanescent, dans lequel beaucoup s’incarnent. Alain Kleinmann ne joue aucun rôle, il est fait d’une consistance forte qui l’extrait de la masse compacte et de la mode stéréotypée, des facilités et des raccourcis artistiques; il est fait d’une culture impressionnante qui le dispense de tout mimétisme, de tout maniérisme, de toute compromission avec les médiocres starisés. Son étoile transparaît de la mémoire de Jérusalem, des Schmattehs de Varsovie ou de Lublin, des paires de ciseaux de coupeur de l’atelier de fourrure de ses parents. «La fou rire, monsieur!» (Pour les non-yiddishisants!!!) Comme ceux de mon père, chemisier «sur mesures». Dans l’atelier dans lequel je dormais enfant puis dans lequel j’aimais étudier, il y avait trois machines à coudre et à boutonnières noires aux ornements dorés Singer, dont la familiarité m’a fait croire que Singer était un cousin. Et le plaisir du café souvent le dimanche matin dans cet atelier d’Alain, entourés des tableaux bien accrochés ou bien rangés, et de s’en imprégner régulièrement, des bibliothèques-monde, des installations d’ateliers, cafés auxquels succèdent cigares et vodka accompagnant nos échanges qui me sont précieux, qui me nourrissent, me stimulent. Chacune de nos rencontres à la fois inscrit une fiable et singulière continuité et produit de l’inédit profond et joyeux, de la créativité, qui remet la pensée à l’œuvre, du sens à donner, de l’essentiel à dégager. L’homme est à la fois tranquille et inquiet, profond, vif et mesuré, impliqué, délicat et déterminé, analytique et imaginatif, bien- veillant, affectueux, encourageant. Une joie de penser avec lui, d’être-là. Une confiance réci- proque. Les objets cachent les mots enfouis et les révèlent.
Le peintre scrute le monde comme s’il soufflait sur la poussière pour laisser entendre le son d’un violon étouffé et pourtant vibrant. L’artiste est un chasseur d’histoires, un conteur qui remonte les souvenirs pièce par pièce, restituant les visages, restituant aux personnes disparues leurs visages, leurs histoires, en deçà et au-delà de l’extermination, de la disparition.
Homme magnifique et immense artiste, véritable Mensch et ami précieux, Alain est l’un de ces hommes qui marquent votre existence. Son attention aux lieux, aux temps, aux objets, aux visages, déplie, élabore, symbolise les obsessions, les répétitions, dans un mouvement de recouvrement sur recouvrement, qui tisse et retisse les plis de la mémoire.
Déchirure du rêve éveillé
J’ai le souvenir des Disparus de Daniel Mendelsohn, de la scène où les membres rescapés de sa famille le regardaient à chaque fête juive comme étant lui-même un revenant, halluciné en son grand-père disparu, ou en un oncle, un cousin, un amoureux peut-être ; des gants de boxe usés, seule chose retrouvée après la guerre, dans la cave du petit atelier-appartement de mon père dans le XIe arrondissement de Paris, occupé pendant sa déportation au Struthoff puis à Majdanek. Le surplus d’archétypes rend abstraite la figuration rétablissant et sublimant un destin.
Kleinmann est une personne profondément ancrée dans une tradition forte et animée, nourrie d’études, de commentaires, de confrontations de pensée, d’expériences créatrices, et un artiste d’une espèce rare parmi les artistes contemporains, nonobstant les modes et les complaisances. Il approfondit le chemin, creusant les signes du passé et construisant les mots du présent qui donnent images et formes à chacun. L’œuvre n’est pas simple contemplation nostalgique, mais force qui vient de très loin et qui remonte au présent pour le futur de nos enfants.
«Comment ne pas être curieux, moi dont le visage rappelait aux amis survivants de mon père un visage disparu depuis longtemps» (Daniel Mendelsohn, Les Disparus). Alain Kleinmann a cette conscience de la mémoire que décrit Yosef Hayem Yerushalaim : « J’appartiens à ceux qui craignent que depuis la Shoah de larges fractions de notre peuple ne se laissent largement ordonner leur vie collective, ou dicter leur politique présente et future, par une obsession de l’ère de la destruction et de la mort ; je comprends cette obsession, mais j’éprouve quand même un grand trouble. C’est comme si nous avions oublié cet enseignement de rabbi Yehoshoua ben Hanania après la destruction du Temple : « Ne pas du tout porter le deuil, nous ne le pouvons… mais trop le porter, nous ne le pouvons pas non plus.»
Selon Binswanger, «l’artiste voit en avance les formes anthropologiques», sans qu’il sache à l’avance quelle modalité d’être va être prélevée de sa propre présence. Il attend de son œuvre ce mouvement de retour des figures ignorées, dans l’attente de la constitution du rêve, tel que seul le rêve éclairé de la nuit profonde pourrait être le support des ombres.
« Entre le deuil absolu et le non-deuil, il y a l’espoir » (Élie Wiesel)
L’œuvre nous accorde un seuil de vie, qui ouvre à la mobilité et à la réanimation vivante des tonalités assourdies et écrasées par l’état déprimé. Malgré la peine et la douleur, nous continuons à espérer. Deuil contient evel, aval, «mais». Au travers le langage, l’étude, le livre, les biblio- thèques qu’Alain Kleinmann nous offre dans des couleurs et des matières différentes, les œuvres nous poursuivent, nous habitent ; nous les habitons : tradition et transmission soulignées par les Pirké Avot? La Shoah n’a pas réduit l’identité à une catégorie prismatique (de victime); des gestes de tous les jours alors héroïques dans des conditions misérables, de persécution, d’aban- don, d’errance.
Richard Dembo, le réalisateur de l’extraordinaire film La diagonale du fou, citant le Baal Shem Tov, disait de l’art de Kleinmann qu’il était «à la fois un miroir et une fenêtre. Il fait resplendir les ombres et les lumières sur des toiles tendues qui ouvrent des brèches vers des ailleurs très intimes. » Douloureuse proximité de ce lointain, présence-absence de ce peuple du yiddishland, généalogies interrompues, en sépia puis en mémoire neigeuse, blanche, les détails sont agrandis. Chaque fragment de l’œuvre recrée tout un monde.
« Mériter son visage » !?
Une véritable épreuve psychique qui participera du défi éthique et artistique, ainsi saisi d’une bouleversante inquiétante étrangeté, envahi d’une infinie tristesse et d’un sentiment de respon- sabilité écrasant devant la tâche qui lui incombait : rendre aux victimes une place dans l’histoire, y inscrire leurs noms, leur rendre un visage, leur construire une sépulture en même temps que leur histoire. Quand l’absence est le seul contenu et la seule forme de survivance. Comme le délire, l’œuvre doit sa force à la part de vérité historique qu’elle met à la place de la réalité, et la puissance de l’image est moins dans l’indéfinie représentation de la représentation, que dans son abîme; comme geste qui symbolise le travail psychique de filiation et la perpétuation du lien entre les vivants et les morts.
Le processus de création répète ainsi le traumatisme, l’œuvre étant à la fois ce non-lieu vers lequel dans nos têtes les trains n’en finissent plus de rouler, les corps ensanglantés ou réduits en cendres n’en finissent pas de disparaître, et la restauration de ce qui a été anéanti, annihilé, par la destructivité, l’oubli, l’éradication d’un monde, l’effacement des traces, des gestes, de la voix, de la parole. L’artiste montre ainsi combien le processus de création nécessite d’arrachement à soi, à l’effroi, au conformisme, le refus de tout ce qui, dans le geste et le style, pourrait comporter banalisation et tentations esthétiques narcissiques.
L’œuvre est le lieu de sépulture qui, chez les humains, dans leurs échanges, permet la survivance d’un humain dans un autre humain
L’événement de sens y est effet de désignification, la rencontre y appelant l’altérité interne « dans le doute sensible», comme l’appelle Weiszäcker, où l’art peut restituer, amplifier la pensée, et le deuil est appelé à sortir du vide, reconnaissant l’insistance d’une filiation, la rencontre y appe- lant l’altérité interne dans le doute sensible où l’art peut restituer, amplifier la pensée. Cette œuvre de sépulture ne vise rien moins qu’à la reformulation de la notion d’ancestralité, moins sur le fond d’un «trésor symbolique» que d’une «résonance matériale».
D’une mélancolie du destin à une conscience hypothétique : la conscience est alors une langue étrangère. Une langue-à-venir. L’image présentée est proche de ce que Pierre Fédida a appelé « l’image matricielle », image source des constructions à-venir, trouble des temps mélangés. C’est aussi à l’œuvre, donnant mémoire de l’infantile et de la construction, qu’il revient, comme au rêve, d’accorder au visage la primitivité humaine qui tient dans cette immobilité fixe, dont l’événement porte une présence à la plus forte intensité.
Et l’informe primitif de la figure humaine manifeste, en un sens, que cet art de l’altération qui révèle le visage est aussi un art de la restitution qui capte, détient et révèle ce qui d’un visage est passage et le plus fragilement vivant, le masque, l’extase immobile, rendant au visage son étrangeté, polysémique et inactuelle. Déliement de l’âme en remontant, écrit Walter Benjamin. L’œuvre est ici une «épreuve de vérité psychique» et de responsabilité généalogique où se laissent produire les figures du Nom. Ne s’agit-il pas pour le rêve, en construisant une sépulture, tel que celle dont le sommeil, dans son rêve, pourrait se donner la tâche de recevoir les visages et de leur donner image – image qui a vu ?
Modalité d’existence – entre fantôme et réalité, entre survivance et réminiscences
Se voyant pensée dans l’horizon d’une sculpture de l’intérieur des visages, sa fondamentalité consiste, en ce qui fait événement, entre sédimentation et métamorphose, et qui porte une présence à la plus forte intensité.
Pas comme ces installations sensationnelles, Monumenta, conjuguant foule de bougies, de lumières, dans un noir emblématique ou d’immenses blocs de béton ou d’acier et de livres en pierre, associant en les fusionnant dans un universalisme bien-pensant contre toute violence et destruction génériques, indifférenciées, les camps d’extermination nazis et les villes allemandes bombardées par les Alliés, Auschwitz et Dresde, et les « écrivains maudits », Céline aux côtés de Celan : OBSCÈNE! Il ne suffit pas de représenter le passé pour passer la mémoire, pervertissant le travail en «devoir» de repentance et d’auto-purification déshistoricisante. «Artistes de la mémoire» en mise en catégorie? Boltanski, Kieffer, Kleinmann, du même? Les uns font du négationnisme sans le savoir, le premier réduit l’identité juive à la disparition, au mort, le second en fait une abstraction dans l’universalisation de l’Holocauste. Kleinmann, suivant Yerushalmi qui refusait de parler des juifs morts dans la Shoah s’il ne pouvait parler de l’histoire du peuple Juif, de la vie des juifs, de leur culture, de la culture, de la pensée du Judaïsme.
« Dit le vrai qui dit l’ombre. » (Paul Celan)
Surtout pas une idole, pas de monument commémoratif qui répéterait la disparition des victimes, la disparition de la disparition, faire de ces « ombres » des revenants, faire des disparus des morts, liant destin collectif et vécu singulier, intriquant trauma, histoire et création, et interrogeant les modalités éthiques et les conditions psychiques de la construction et de la transmission de la mémoire.
Comment recueillir les voix mortes, les regards hantés, qui nous appellent ?
«La mémoire est la racine de la délivrance comme l’oubli est celle de l’existence.» (Israël Baal Shem Tov, 1700-1760, fondateur du hassidisme). Avec Alain Kleinmann, nous avons réalisé en septembre 2020 le rêve que nous entretenions depuis plusieurs années, conjuguant un grand Colloque Schibboleth – Actualité de Freud «Mémoire/Transmission/Création – Art / Psychanalyse / Pensée juive », et une exposition de ses travaux. Cet événement a réuni au Centre Européen du Judaïsme à Paris, avec Alain Kleinmann et moi-même, Marc-Alain Ouaknin, Daniel Mesguish, Daniel Sibony, Monette Vacquin, Thibault Moreau, Patrick Bantman, Claude Birman et Jean-Pierre Winter, et de nombreux participants et auditeurs. Il ne manquait que les danseurs et artistes de La Havane qui ont monté plusieurs spectacles à partir de ses tableaux.
Zikharon
Se remémorer en hébreu : la mémoire est tournée vers l’avenir, comme le signifie le Kaddish, la prière que l’on récite pour les morts, et qui tend vers une sanctification de l’Éternel et s’adresse à leurs enfants et à la perpétuation de la vie… Et qu’elle ne puisse se dire qu’en pré- sence de dix hommes, le Minyan, inscrit l’advenir de l’enfant, sa construction, dans le lien du singulier et du collectif, l’entre conflictualisable identité – appartenance, a contrario d’une identification mimétique, et dans la transmission comme désir et processus. C’est porter une mémoire vers, comme porter un nom, c’est se porter vers un nom, pas une incarnation moïque. Ce n’est pas une mémoire compulsive, glaciaire.
L’art n’est pas sacré ; « Toucher l’âme est au-dessus de la peinture en Soi », dit Chaïm Soutine ; l’œuvre est un makom. Ce lieu, d’un hébergement psychique qui n’a pu se constituer, comme contenant de traces, d’empreintes, des brisures, des traumas. « Les mots manquent, là où nous avons manqué aux mots», selon l’expression de George Steiner. L’art, comme l’humour, tente de donner des représentations à l’irreprésentable, des affects là où l’effroi a gelé le psychique.
Une œuvre est une mise à l’œuvre. La vie s’anime dans un long travail de deuil, deuil comme un travail de mélancolie, deuil transgénérationnel, quand les enfants ont à élaborer des idéali- sations enfouies, des traumas enkystés, des parties détruites chez leurs parents, leurs grands-parents.
Motty Omer disait que l’art était une marche vers la mort, et Pierre Restany que c’était un triomphe de la vie, alors que certains, depuis l’urinoir de Duchamp, prédisaient la mort de la peinture il y a une vingtaine d’années. La beauté formelle ne participe-t-elle pas à produire du sens? Aussi, s’agirait-il de questionner ce qui participerait du fonds commun d’un art juif ou d’un art israélien, leurs signifiants, gestes, textures respectifs ? Qu’est-ce qu’un objet de culture ? Un travail de culture? En quoi l’art aurait-il une fonction de miroir mais aussi d’alerte, en quoi serait-il une interprétation polyvoque d’un symptôme ? Produire l’interlocuteur étrange intime.
Mémoire et survivance, traces hallucinatoires, figures de l’exil, douleurs muettes et trauma- tismes cumulatifs : l’œuvre comme le visage, Self-portrait, qui devient alors, depuis le Site de l’Étranger, lieu d’une construction de l’originaire et ainsi de l’Autre1 , est un matériau d’inter- locuteur éveillant cette puissance de l’image et des métamorphoses qui émergent avant tout des mots du langage. En effet, que serait le souvenir sans visage et un visage sans nom, sans « œuvre de sépulture»? La mémoire peut-elle se passer des noms, des lieux, des figures qui, seuls, témoignent de l’insigne courage de se détacher de la masse ?
Peindre l’impossible. L’ombre de l’œuvre
«Qui appartient au peuple du Livre se doit de peindre l’impossible», écrit Barnett Newman. Entre survivance et réminiscence, l’œuvre renouvelle l’événement du primitif et l’horizon d’une sculpture de l’intérieur des visages.
L’âme de l’artiste est une surface de résonance langagière où se forme le nom des choses. L’image est arrêt sur le langage, l’instant d’abîme du mot. Un visage qui frissonne, venant de très loin ; une temporalité du visage se dessine à l’ouverture des mots des choses. Comme le rêve, le visage touche au mort, au vif. Deuil et visage portent la même temporalité. Le dessin est mis en langage de l’autre. La matière de la peinture est matière muette de la mémoire.
Matière d’interlocuteur; le tableau n’est-il pas l’ombre des mots, d’un récit à l’autre? La vie remonte par «paquets de choses» qui se comportent comme des marranes de l’histoire. C’est la déambulation d’une réminiscence des visages et des paroles entendues, par ces formes régres- sives sensorielles des images et de laisser produire en lui le pouvoir des noms. Son pouvoir de nommer à l’origine.
Remontée de ce qui n’est plus. Empreinte, marque en creux, impression au sens de gravure. Le présent est occupé à creuser au sein même du matériau primitif l’épopée de la figure, où l’objet est un fond reconstruit du temps d’un regard, l’ouverture imprévue d’une lumière. C’est dans cet écart que se jouent Traumatisme / Deuil / Création.
Dans le refus d’un style, de tout clin d’œil, la pratique de l’art tient d’abord d’une éthique. Alors sculpter l’impossible ? L’ombre de l’œuvre. La mémoire pèse plus que les souvenirs. Le voyage devait nous ramener, non pas au bout de la nuit, mais plutôt à ses origines. Quelle mémoire chante et pleure dans la nôtre ? Les parchemins peuvent brûler mais les lettres demeurent intactes.
Elles sont indestructibles. Car le plus grand danger n’est pas tant l’oubli de ce qui advint dans le passé que l’oubli de l’essentiel : comment le passé advint. Alors Nahman de Bratzlav avait cette habitude un peu folle de brûler lui-même ses écrits pour que les mots voyagent plus vite par la voie des nuages et du vent, et trouvent leurs justes destinataires. Chaque récit est un poème, chaque poème est une prière, et de chaque prière nous ferons des histoires. L’origine n’est-elle pas dans ce qui se fait et se défait? Revenir, c’est par là que passent tant la création artistique que la création dans la cure analytique.
« Les véritables souvenirs sont des souvenirs au présent, ils ne doivent pas tant rendre compte du passé que décrire précisément le lieu où le chercheur en prit possession» (W. Benjamin, 1916). Cette ouverture par l’œuvre appartient à cet epos, une temporalité du visage se dessine (le dessin dessein / DASEIN interne de la parole) à l’ouverture des mots des choses invitant à ce dépassement de l’image par l’image et nous donne à nous représenter cette conception ben- jaminienne de la mémoire comme activité de fouille archéologique quand il déterre un corps et modifie ainsi le sol même, sol sédimenté portant en soi l’histoire de sa propre sédimentation – où gisent les vestiges, trait après trait, couche après couche, retrait après effacement, l’archéolo- gique conduisant là à un géologique qui est le temps propre d’un devenir de l’âme-fossile, une généalogie des lieux, des noms, des visages. Un lieu porte-empreinte.
Kleinmann nous fait figurer l’image survivante, entre symptôme et fantôme – de ce passé anachronique venant au jour du présent réminiscent. Les détails de l’œuvre sont comme des restes de vie qui ne pourraient entrer dans le matériau du rêve de la nuit et qui, tenus à l’exté- rieur, deviennent des fragments séparés dont l’effet produit une extraordinaire violence phy- sique et psychique.
Savons-nous devenir nos souvenirs? Avons-nous pris le temps de vivre nos deuils et nos drames intimes? Il s’agit moins de rechercher une mort oubliée ou une mort encryptée que de pouvoir qualifier le lieu du souvenir comme lieu toujours d’extrême fragilité, à la limite de l’inquiétant étrange qui tient la mort en suspens, et, pour cette raison, où rien ne se passe. Et ce deuil sans fin ne serait-il pas ce dont le souvenir a besoin pour se ressouvenir, le rêve qui est mémoire de l’infantile ne pouvant n’être que la parole qui a vu en dormant ? La mémoire est ici une rumination du récit, privée de l’animation du présent. Elle «met en tombeau ce qu’elle chercherait à ranimer», tandis que l’optique de l’œil participe du figurable de mémoire géolo- gique qui advient avec l’inachèvement. L’artiste est « séparé par la main du secret qu’il détient », selon la formule de Mallarmé, l’œuvre est cette mémoire hallucinatoire régressive qui va cher- cher les formes vivantes d’un passé anachronique au travers de la présence en personne de l’artiste, présence entre intimité et étrangeté. Entre le familier et l’inconnu, entre la présence nostalgique et l’imminence de la perte, entre le réel de l’événement et le détour de la métaphore, la mémoire occupe le lieu, alors transcendant. On dirait que ce qu’on appelle «image» est, un instant, l’effet produit par le langage dans son brusque assourdissement.
La construction qui est la mémoire d’un passé irreprésentable et la voyance de l’image, le temps de sa métamorphose, entre figuration et abstraction, participe, dans la fondamentalité du travail de mélancolie, d’un bouleversement et d’un réaménagement poïétiques. La déchirure de l’image, zurbild, bouleverse le cours du récit et trouble le représentable et vient en effet ruiner la représentation au moment où elle apparaît, sous l’espèce de ces êtres fantomatiques qui pro- duisent une traductibilité et une énorme charge émotionnelle et spirituelle, l’œuvre, de fragmentations en masse, restituant alors le pouvoir des ombres indistinctes – et de leur vertu guerrière –, restituant une capacité à se laisser transformer en ces puissantes réminiscences hyp- notiques transférentielles. Il s’en dégage une émotion violente tant par leur composition puis- sante d’évidence que par l’impression oppressante qu’elles produisent. Les noms trouvent lieu dans ces figures de l’étranger du langage, celui-ci étant anéanti lorsque la guerre ne distingue plus rien, les transferts – de nature monothéiste – étant tels, et le visage en étant leur lieu, que Freud les avait désignés des puissances mémoriales hypnotiques d’appel des images, où attendent en silence les noms des morts perdus2. De là dépend la figurabilité du langage. Les morts se souviennent de la violence qui a voulu leur disparition en masse, la guerre ayant fait défaut lorsque le langage fut perdu – le génocide se chargeant de défaire le compte de la guerre. Le crime de masse consiste en ce que les morts ne sont jamais assez disparus. C’est bien ce que la masse déconstruit. Le cadavre en est le paradigme, œuvre diabolique de la désimagination humaine, dans ce projet forcené d’anéantissement, d’éradication – extrême – de la disparition. La fin du semblable-différent et la disparition de l’apparence, de la figure de la mort, caracté- risent le déshumain, et celui-ci ne commence-t-il pas toujours – jusque dans le quotidien de l’homme – précisément par une perte des visages ? Fantômes et passions superposent des couches jusqu’au découvrement de l’image dans le temps de son hallucination, rendant sensible une puissance du souffle indistinct, ce qui insiste à en déterminer la singulière et puissante présence et la frappante beauté. L’œuvre, lieu de condensation inactuelle des sédimentations et des transformations, des mouvements de l’informe, les modalités de deuil et de (re)création, des stigmates phylogénétiques et anachroniques des expressions pathiques, des non-lieux topiques d’effondrements psychiques passés, des puissantes réminiscences transférentielles et des agita- tions fixes-mélancoliques, vertigineuses.
À la fin de sa vie, rabbi Zoussya, maître hassidique, prononce ces paroles : « Dans le monde qui vient, la question qu’on va me poser, ce n’est pas : pourquoi n’as-tu pas été Moïse? Non. La question qu’on va me poser, c’est : pourquoi n’as-tu pas été Zoussya?» (Élie Wiesel, D’où viens-tu ?).
Dans le contexte de l’art contemporain, l’œuvre d’Alain Kleinmann s’impose avec une force et une rigueur exemplaires
Il traverse à chaque instant, d’une toile à l’autre, d’une gravure à une sculpture, la totalité du chemin parcouru, exprimant ce qui ne peut être contenu, en s’armant contre et avec le retour des images obsédantes, qui se justifie d’un pas nouveau; la douleur psychique inarticulée est devenue organisation sculpturale de la surface, mais aussi organisation chorégraphique de l’es- pace d’où un in-sight pourra émerger. L’expressionnisme abstrait américain, constitutif d’une présence, est peut-être issu de la désillusion face à l’effondrement de la culture, aux massacres de masse de la guerre, au génocide, ainsi face à l’art d’avant. Rothko, que son fils Christopher fera dialoguer avec Levinas sur le rapport de l’art avec la réalité, substituera la présence (la figure) au visage du monde. D’où cette tension : l’ombre de l’objet, c’est ce que nous saisissons de l’objet et qui nous échappe. C’est le travail de symbolisation, quand le symbole échoue, scindé, en négatif, à se constituer comme tel, dans la totalisation en fétiche ou en relique.
L’artiste est saisi de l’absence, une absence qui n’immobilise pas le temps, mais qui engage une responsabilité de la subjectivation. Les Lumières, l’Universel, la philosophie, l’art n’ont pas empêché ça : les camps, les fours crématoires, l’assassinat du peuple Juif, six millions d’hommes, de femmes, d’enfants. Au contraire, « le progrès a conclu un pacte avec la barbarie », prophétie Freud en 1933. Alors pourquoi faire un portrait ? Rothko se sent seul. Il fabrique le flou. Se tourner vers le Sujet? Éliminer tous les obstacles entre le peintre, l’Idée et l’observateur? Avec l’exigence de se trouver face à une présence, de construire un lieu ultime.
Donner un visage, redonner une dignité, une vie dans la mémoire, une place dans l’Histoire, l’espace trans-subjectif. Gravure en mémoire, œuvre du figurable, d’une construction au cœur de l’intime, l’œuvre nous donne une vue de la pensée, une condition d’une mise en discours intérieur du fantasme, du mythe, d’une historicité singulière, telle que se laisserait s’écrire l’inactuel, lorsque seulement le figurable est produit dans et par le langage qui voit. Yerushalmi commente : «Les pierres importent moins que les souvenirs transmis par les pères.»
Une certaine forme d’oubli fournit les matériaux pour la mémoire. «Chaque forme est un monde», disait Malevitch. «L’art ne rend pas le visible», selon Klee, mais celui d’Alain Kleinmann tend à nous rendre lisibles à nous-mêmes. Son travail nous rassemble et donne figures et noms aux formes primitives qui se meuvent en nous, en même temps qu’il nous absente avant qu’il ne se recrée, transferts de transferts du corps de l’œuvre en ses métaphores. Pour qui le connaît, l’homme – ce Mensch véritable – est entièrement dans son œuvre, patiente, rigoureuse, entière, exigeante, généreuse.
Une véritable mise en abîme qui tient plus qu’à l’indécision de l’être, révélant un moment critique des héritages humains. La pluralité de significations de l’œuvre est en effet la condition même de son existence. Ses œuvres, selon la formule de Willem De Kooning, « résistent à toutes les interprétations et se transforment dans le même temps». L’expérience vécue, ses tracés, se paient d’une épreuve psychique rendant une langue inconnue disponible à l’acte des choses, ou encore instauratrice d’une capacité tragique dans l’agissante amnésie de sa recherche.
Ainsi, le Site de l’étranger s’institue alors interlocuteur du rêve et du langage, point de charge d’une puissante pensée des transferts généalogiques, d’une plasticité et d’une mobilité alors disponibles. Le visage devient alors lieu à la fois d’une construction de l’originaire et ainsi de l’Autre dont il nous fait nous demander quelle en est la substance d’apparence. Ainsi, une sub- jectivation ne peut se constituer hors du phénomène humain du visage qui est «entre» deux corps, «entre» deux lieux, «entre» deux humains essentiellement incertains (pour ainsi dire précaires). Ici le lieu du corps engage parole et mémoire, mettant fin au sommeil de l’oubli. Le destin prend la forme de cet éveil et devient autrement pensable qu’à l’état d’un discours insomniaque, quand le rêve rêve de nouveau, alors mélancolique. Seuls les noms résistent3, et quand assassiner ne suffit plus, dans l’expérience de l’extermination, il s’agit de vouer l’humain au dissemblable, la « solution finale » consistant en ce qu’un peuple n’ai jamais existé. Alors c’est le rôle de l’artiste, comme de l’analyste, d’imaginer le traumatisme et la déshumanisation. Ne pas céder à «l’inimaginable», à «l’impensable», à la négligence du temps et de la représentation.
Le rêve est fait d’images visuelles qui sont choses dont les images se ressouviennent et sont l’intérieur des noms de ces choses. On sait que le transfert, fondamentalement se référant néga- tivement entre l’amnésie du symptôme et une dette réminiscente du langage, dispose selon Freud de cette mémoire hallucinatoire régressive qui va rechercher les formes vivantes au travers la présence en personne de l’analyste qui, comme l’artiste, est un reste diurne, dès lors que l’hallucination négative rendrait possible le mouvement d’absentisation propre à l’action psy- chique – quasiment physique – sur la présence, de telle sorte que remontent les morts, retour qui se donne comme la forme du primitif dans sa nature animiste et totémique4, et qui sculpte le rêve de l’intérieur, participant à réinstaurer cette puissance mémoriale des transferts.
L’étrangèreté est à elle seule le mouvement du processus qui ouvre à l’angoissante subjecti- vité des passages, le travail d’Alain Kleinmann nous amenant à concevoir la régression – topique – comme restitutive de la plasticité et de l’intégrité de « l’animique primitif ». Alain Kleinmann occupe une place unique dans le monde de l’art, faisant vivre dans ce champ l’historicisation, la transmission, ainsi qu’il le fait dans la vie.
Comme dans les poèmes de Paul Celan, air et pierre se rencontrent parce que dans beaucoup d’images fortes se rencontrent une grâce et un deuil immenses, un geste et un suspens du geste, un désir et un renoncement, une presque consolation et une perte inconsolable, une masse puissante et infaillible et des blessures touchantes, entre donner forme à ce qui se pétrifie et à ce qui demeure. Rêve et réveil tout à la fois, éveil du vivant inanimé, articulant la question de la matière d’image à celle du temps des morts. Dans l’œuvre de Kleinmann, ce qui est boule- versant, c’est aussi le matériau de cette réminiscence. Il s’agit d’arracher à l’image sa dernière ressemblance : en faire la sépulture sensorielle de l’absence, se dessaisir – donc – de l’empreint.
Alain Kleinmann interroge la substance de l’apparence humaine lui restituant sa capacité de résonance à partir de l’expérience violente de l’anéantissement du vivant humain, son œuvre comportant cette réanimation de ce vivant psychique inanimé dont le deuil est la mise en mou- vement. Alors que la dépression est en effet cette expérience de la disparition et cette fascination par un état mort – peut-être un mort – qui serait alors la seule possibilité de conservation, sous la forme de la brumisation et du vivant inanimé.
Compter et conter les morts. Comme le rêve, le visage touche au mort5, au vif, deuil et visage portant une même temporalité. Et il construit un paradigme essentiel, une présence lourde, imposante, lieu du figurable, en même temps que mise en abîme, brusque assourdissement du langage en même temps que dessein interne d’une parole dans le « mouvement en tournant du souffle » (A. du Bouchet), dont parle Paul Celan. Comme un visage qui frissonne venu de très loin, son intimité par excellence6. Alain Kleinmann travaille « là où les mots font défaut, là, selon l’expression de George Steiner, où nous leur avons fait défaut. » Se voyant pensée dans l’horizon d’une sculpture de l’intérieur des visages, l’œuvre d’Alain Kleinmann nous fait retrouver une capacité exemplaire à réinstaurer le mémorable : arracher à l’image sa dernière ressemblance, en faire la sépulture sensorielle de l’absence. Ses œuvres nous traversent au plus profond de la tragédie de l’extermination, sans jamais pourtant la représenter. «Il n’y a de trace que dans le désert – Ici n’est pas le lieu, ni même la trace. Ici est sable. » (E. Jabès, Le Livre des Ressemblances, Paris, Gallimard, 4e éd. 1991, p. 266.)
Les souvenirs sont souvenirs d’une invention, et c’est comme invention qu’ils reviendront
Un tableau est retour d’une amnésie en acte. Il se peut que les souvenirs servent d’écran à la mémoire alors qu’ils prétendent être ce qui s’est déposé en elle. Comme le délire, l’œuvre doit sa force à la part de vérité historique qu’elle met à la place de la réalité. La psychanalyse n’a rien à appliquer à l’art, elle a plutôt à se compliquer de lui, à s’ouvrir au questionnement qu’il réac- centue sans relâche. L’œuvre pourrait être cela, accéder à la mobilité qui ouvre l’accès à la réa- nimation vivante des tonalités assourdies et écrasées par l’état déprimé. Elle pourrait être une fiction. « Œuvre d’amour », comme dit Freud à l’issue de son commentaire de la Gradiva – où commence la fin de la vie. Non pas quand, mais où ? Patrick Modiano en est l’un des interlocu- teurs implicites : «Il faut longtemps pour que resurgisse à la lumière ce qui a été effacé : des traces subsistent dans les registres et l’on ignore où ils sont cachés et quels gardiens veillent sur eux et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont-ils oublié tout simple- ment que ces registres existent. Il suffit d’un peu de patience. »
L’événement créateur nous arrache à ce qu’il y a d’insupportable, comme dans le film Shoah de Claude Lanzmann qui identifiait le souvenir à la disparition absolue du souvenir, quand l’absence est le seul contenu et la seule forme de survivance. L’œuvre d’Alain Kleinmann nous fait retrouver une capacité exemplaire à réinstaurer le mémorable. L’œuvre, ce travail de matière de l’homme, érige à ces femmes et à ces hommes, à ces enfants, substance et dignité, et leur redonnera, selon le prophète Isaïe, «un nom impérissable», en exergue de Shoah, le film, un lieu d’un avoir eu lieu qui fasse que ce lieu, au même titre qu’Auschwitz ou Majdanek, ne constitue pas l’origine du monde, qui ressuscite les disparus pour les tuer et les accompagner, que le non-advenu, le non-arrivé soit arrivé.
Lieu de condensation inactuelle des sédimentations et des transformations, des modalités de deuil et de re-création, il nous fait figurer «l’image survivante de ce passé anachronique venant au jour du présent réminiscent». Alors l’œuvre, participant de l’émotion du présent et de l’in- tériorisation du souvenir, de l’amnésie, serait-elle le vide de la métaphore et le temps de l’intervalle?
Le deuil appelé pour sortir du vide, rencontre d’une altérité, reconnaissant l’insistance d’une filiation
Giacometti se tenait sur un seuil, entre identité et perceptions.
Restituer la vie psychique au symptôme, et d’abord laisser le rêve produire ses transferts, serait au plus près de ce dont la psychanalyse a fait son souci. La mémoire archaïque du transfert au fondement du travail de deuil ne serait peut-être rien d’autre que ce qui répond à la nécessité de laisser dans la pensée se désagréger l’image pourtant immédiatement présente du corps cadavre. Tenter de créer un lieu pour ce qui a eu lieu, et n’a pu, selon Winnicott, être alors éprouvé. Il s’agit moins de rechercher une mort oubliée ou une mort encryptée que de pouvoir qualifier le lieu du souvenir comme un lieu toujours d’extrême fragilité, à la limite de l’inquiétant étrange qui tient la mort en suspens et, pour cette raison, où rien ne se passe. Et ce deuil sans fin ne serait-il pas ce dont le souvenir a besoin pour se ressouvenir, le rêve qui est mémoire de l’infantile ne pouvant être que la parole qui a vu en dormant? La mémoire est ici une rumination du récit, privée de l’animation du présent. Elle «met en tombeau ce qu’elle chercherait à ranimer ». La dépression ne serait-elle donc pas, se définissant par une position économique qui concerne une organisation narcissique du vide, l’expérience vitale de la mort impossible? Le cannibalisme serait alors l’expression mimétique d’un deuil mélancolique – comme s’il s’agissait d’étouffer la mort pour dévitaliser la vie, dans le gel de l’auto-conservation, de simuler la mort pour se protéger contre la terreur de la décomposition.
Non seulement Picasso ne rend pas Cézanne caduque et dépassé, mais il l’enrichit. Toute œuvre nouvelle enrichit et élargit toute l’histoire de l’art. La résistance à l’art consisterait à ramener le langage de l’art à celui du oui et non. C’est pourtant la chute du roman, c’est ce qui éclaire d’une lumière nouvelle tout le déroulement antérieur de l’intrigue, le moment qui devient intéressant pour l’artiste, celui où le héros abandonne une attitude figée et fétichiste dans son rapport à l’art, pour accéder à un niveau supérieur de connaissance à travers la jouissance artistique.
L’abord spécifiquement psychanalytique d’un objet est auto-impliquant : aussi, la promenade artistique, comme analytique, esthétique-éthique que je vous propose emprunte les chemins du transfert. L’exil de l’œuvre, mémoire archaïque du transfert, s’accompagne d’un retour vers le futur, comme la parole possède une ombre qui l’accompagne et la creuse, et Benjamin évoque le souvenir qui s’arrête en chemin, tandis que la réalité continue. Ce qu’on appelle l’humain est de l’ordre de la résonance des états qui permettent de penser la semblance et le semblable.
La rencontre de ces deux figures, l’artiste et le psychanalyste, ne peut se faire que sous le sceau de l’étrangeté. Daniel Mesguish dit que la «peinture d’Alain Kleinmann anticipe autant qu’elle rappelle, qu’elle donne vie, événement à ce monde, donne face à l’effacé, figure à l’in- figurable, visibilité à l’invisible», l’illisible plutôt, représentation à l’irreprésentable, l’imagina- tion à l’inimaginable? Ainsi Le songe d’une nuit d’été, Shakespeare y associe création littéraire et délire. Joyce Mac Dougall souligne la violence extrême qui préside à l’énigme de toute activité créatrice, qui participe à la pulsion sublimée dont l’œuvre est le fruit.
À propos de Léonard, Freud parle de «sublimation des origines» : déplacement, condensa- tion et métamorphose se soustraient d’emblée au destin du refoulement, comme une dérivation inaugurale. La sublimation ne se contente pas de tirer vers le haut, mais a surtout une activité de transformation, de transposition, de métamorphose, toutes opérations indissociables de l’extraordinaire plasticité des pulsions partielles : difficile de ne pas établir le parallèle avec le travail du rêve.
La création constituerait-elle un moment de vérité de la civilisation? «Nous avons une mémoire, mais nous sommes les souvenirs», écrit Lou Andreas Salomé. Les visages d’Alain Kleinmann augmentent le regard donnant sens et puissance à un authentique travail de figura- tion et d’intériorisation : « non seulement, écrit Primo Levi, nous n’avons pas le temps d’avoir peur, mais nous n’en avons pas la place». L’œuvre entend l’appel des morts et la douleur des vivants. Notre mémoire est plus lourde que nos souvenirs.
« L’art aurait-il le pouvoir, comme le soutient Aharon Appelfeld, de sortir la souffrance de l’abîme ? »
L’« âme » de l’artiste est une surface de résonance langagière où se forme le nom des choses, ce qui nous fait nous demander comment l’image peut se concevoir depuis sa désimagination. Être artiste, comme être psychanalyste, nécessite d’être constamment clivé, de pouvoir être déplacé par rapport à une idée totalisatrice du Moi. L’artiste voit ensemble humain-déshumain dans un seul et même processus, disposant de cette ressource animiste de produire des images, véritables interlocutrices du symptôme. Notons pourtant la relative impuissance de l’art face au malheur humain, écrit Freud dans Malaise dans la culture. La fonction de l’art se résumerait dans cette tentative pour provoquer une illusion faiblement efficace.
Le déni anti-traumatique : telle serait en quelque sorte la devise que Freud attribue à l’art qui peut trouver sa fonction dans son pouvoir d’effacement du traumatique, et transformer la blessure en parodie d’invulnérabilité. L’art aurait donc un pouvoir analogue à celui de la cica- trice qui peut être palpée en dépit de l’impossibilité de mettre en scène le souvenir qui lui correspond, assurant ainsi la fonction d’un cataplasme qui serait néanmoins gardien de traces inaccessibles, inscrites dans le corps. Le souvenir transcrit par l’art, ouvre aussi bien sur un sentiment de sécurité que sur l’absolue surprise connectée au réel qui « advient. » dans la mesure où il est porteur d’une double efficacité, anesthésier les plus profondes blessures et dans le même temps les réveiller. Freud, après plusieurs tentatives inhibées pour parvenir à Rome et trouver l’église Saint-Pierre-aux-Liens, se trouve sidéré lorsqu’il prend conscience de son ambi- valence vis-à-vis de Moïse, s’identifiant, face à la statue de Michel Ange, d’abord à la racaille idolâtre et pulsionnelle, objet de la colère de Moïse, plutôt qu’à celui-ci, capable de contenir colère et quête de jouissance. La jouissance narcissique, par ailleurs, se nourrirait de la puissance de l’effet de saisissement provenant souvent des œuvres les plus grandioses; et peut-être fau- drait-il établir une complicité entre l’effet produit par l’œuvre d’art et la position masochiste? Freud parle d’un paradoxe dans la mesure où le plaisir esthétique extrême s’exprime par l’équi- valent d’une soumission à l’égard d’une force qui nous dépasse, qui nous «terrasse». La jouis- sance esthétique entretient sa complicité secrète avec le régime féminin de la jouissance.
Brancusi écrivait : «Une œuvre d’art doit être comme un crime parfait», une mise en pièces comme un geste de pensée restitutif de la figure du père, d’une architectonique référée à un temple japonais brûlé tous les vingt ans afin, en le reconstruisant, d’en retrouver et transmettre le sens. Ainsi, dans la Kabbale, les Livres brûlés.. L’œuvre artistique et le symptôme ne pour- raient-ils pas parfois susciter cette même angoisse ? Remonter aux sources pulsionnelles qui ali- mentent autant la force motrice de la création chez l’artiste que l’émotion du spectateur.
Egon Schiele de son côté écrivait que « l’art ne peut pas être moderne, il est éternel ». Il s’agit de lire les commentaires étayés, rigoureux, imaginatifs d’Alain Kleinmann dans son livre sur l’art contemporain. Il ne cherche pas à nous imposer un sens mais à nous le faire vivre. L’œuvre d’Alain Kleinmann, à l’instar de celles d’Ofer Lellouche et de Gérard Garouste, engage un processus d’interprétation polyscénique, polyphonique, polysémique, a contrario d’une univo- cité totalisante, synthétique et résolutive. Alain Kleinmann a illustré, et alors interprété la Haggada, le récit de la sortie d’Égypte lors de la fête de Pessah, ce périple fondateur qui mène de l’obscurité à la lumière, de l’aliénation à la liberté responsable. Son œuvre, structurée comme le Talmud, qui est travaillée de part en part par la quête du sens, trouve dans ce récit une matière inépuisable : il y est question de l’homme, de l’histoire de l’humanité autant que de la question de la transmission. La Haggada recèle les richesses qui font de sa lecture un événement vécu. Sa peinture, c’est aussi de l’étude : « Les mots en savent plus sur nous », écrit Valère Novarina.
Kafka n’a pas demandé de tout brûler, mais il pensait que c’était la brûlure qui le ferait vivre, que les failles des choses produisaient de la lumière qui passe. L’art nous est donné pour éviter de mourir de la vérité, écrivait Nietzsche. « Dans le pays où l’on a toujours raison, les fleurs ne s’épanouissent pas au Printemps », écrit Ami Yehuda Amichaï. Entrer dans l’œuvre de Kleinmann, c’est entrer dans la maison du Midrash, une immense bibliothèque d’étude; la peinture n’est pas faite pour être commentée, elle est un makom, le lieu, celui d’un lieu psychique qui n’a pu se constituer, qui n’avait pu contenir traces, empreintes, brisures, blessures, traumas.
Comme l’humour, l’art tente de subjectiver des positions d’impasse, d’irreprésentable, de momification, de catégorisation prismatique. Sortir d’une catégorie d’être, ouvrant aux champs du transfert, de la métaphore, de l’indéfini de la pensée, de la représentation.
La cassure toujours possible avec Dieu et avec le destin est le ressort même de la transmis- sion ; on la retrouve entre deux générations, ce qui à la fois les sépare et les relie. L’évènement fondateur en est la lutte de Jacob avec l’Ange, choc traumatique de l’altérité de laquelle ne se crée rien de moins que le nom d’Israël et le Symbolique, étrangeté d’un peuple qui s’invente un Dieu pour combattre avec lui.
L’unheimlich comme dynamique de transmission
Jusqu’à son testament, L’Homme Moïse et la religion monothéiste 7, Freud se pose la question des modalités spécifiques de la construction et de l’intériorisation anti-idolâtre d’un édifice invisible qui caractériseraient le mystère du caractère du Juif et de son peuple dont il a hérité, poussant à la conquête de l’intellectualité et de l’abstraction sur la domination de la sensorialité et de la perception immédiate, du lisible sur le visible, qui le constitue, alors qu’il n’a ni la foi ni un excès de nationalisme, de puissantes forces émotionnelles innommées qui marquent un sentiment d’identité intérieure, un fonds commun et un sentiment d’appartenance, une consistance et une substance particulières introduisant une disjonction entre le père réel et le Père Symbolique, ainsi un entre-deux marquant le travail de l’œuvre. Freud associe le mystère d’une même construction psychique des Juifs à des modalités particulières d’identification et de la transmis- sion, singulière et collective, et phylogénétique. C’est l’homme porteur de la question d’exis- tence, du nouage du langage à l’inconscient et au sexuel, et du désir à la Loi, dont il s’agit de s’approprier les signifiants pour le chasser de son lieu d’être pour s’y greffer, qui a été exterminé.
Passer de l’identité à l’existence. L’unheimlich, comme dynamique de transmission, est un effet qui se produit dans l’entre-deux, un certain rapport à l’être, dans un mode d’être où «ce n’est jamais ça ! ». L’œuvre est unheimlich pour ceux qui font de leur identité une heimat, un chez soi aux ouvertures bien contrôlées ; toute transmission authentique est vouée à se déformer, comportant l’intégration d’un manque, ne serait-ce que celui inhérent à l’échec du fantasme, l’élément étranger perturbant le narcissisme absolu (B.Grunberger). En reproduisant ce qui nous échappe, en reproduisant la perte de réalité, l’œuvre rend présente une réalité inconnue en négatif. «Un temps parfois se regarde dans les yeux», écrivait Proust.
Sculpter l’impossible : l’ombre de l’œuvre – Une véritable épreuve psychique qui participera du défi éthique et artistique, ainsi saisi d’une bouleversante inquiétante étrangeté. L’œuvre noue nos voix intimes et étrangères, ayant l’expérience d’une épreuve disponible à l’acte des choses ou encore instauratrice d’une ombre des mots, à la fois miroir et masque, moment de vérité de la civilisation.Proche de Rilke et de Benjamin, Alain Kleinmann insiste sur la nouveauté toujours reconduite des choses revenantes. L’œuvre entend l’appel des morts et la douleur des vivants. Geste de pensée qui crée ce qui se joue de l’autre côté, au-delà de la surface visible. Ce souffle de vie met en scène une pièce de théâtre, une transfiguration. Un Opéra de la mémoire et de la vie qui traverse les corps.
Un processus renouvelé qui nous échappe et nous change, nous trouble et réactive nos défenses et nos conflits, nos aspirations et nos angoisses. Dans L’écrivain et la création littéraire, Freud écrit que l’écrivain se comporte comme un enfant qui joue, à savoir «qu’il crée son propre monde, ajoutant que l’enfant crée un monde de fantaisies qu’il prend très au sérieux et qu’il investit largement sur le plan émotionnel. » Le champ transitionnel ouvre au jeu, à la créativité artistique, au sentiment religieux et au rêve. La créativité est porteuse d’une violence extrême accompagnée d’une profonde angoisse et d’une grande culpabilité. La violence est un élément essentiel de la création, celle-ci surgit du corps érogène.
«Nous vivons un temps particulièrement curieux : nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie», écrivait encore Freud en 1938, dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste. Freud cite Léonard de Vinci : «La peinture travaille per via dipore, à l’inverse, la sculpture procède per via di levare, c’est-à-dire qu’elle enlève à la pierre tout ce qui recouvre encore la surface de la statue qui y est contenue (…). La méthode analytique ne recherche ni à ajouter ni à introduire un élément nouveau, mais au contraire à enlever, à extirper quelque chose. La création artistique ou l’activité scientifique, le symptôme ou le rêve, selon des modalités différentes, visent la réalisation du souhait inconscient, et se manifestent selon les mécanismes de compromis du travail du rêve. »
Le rêve ne pense ni ne calcule. Il ne juge pas. Il transforme; la sublimation ne se contente pas de transformer, elle œuvre et surtout elle s’adresse à l’opposé de l’autisme du rêve. Cette présence de l’art participe d’une démarche intellectuelle, spirituelle, esthétique, éthique, cultu- relle, psychopathologique, un croisement et une confrontation des regards, une réétrangérisa- tion des langages respectifs.
Créer, c’est revenir, recréer comme le montrait Winnicott. Reste un travail de mélancolie. Dans la misère, la pauvreté, la persécution : l’étude, le travail, l’exigence d’élévation intellectuelle et spirituelle, le refus de la soumission et de l’absolution. Un juif se définit par ce qu’il fait. Mon copain Michaël Bar Zvi parlait d’une politique de la transmission : restituer un héritage aux parents qui n’ont pu nous le transmettre, ou qui nous l’ont transmis malgré eux, enkysté, pour le rendre vivant, reconnaissant la dette, leur exprimant la gratitude, et ainsi nous en différencier.
L’art et l’humour s’y conjuguent. L’œuvre d’Alain Kleinmann, dans l’approfondissement de la mémoire, des traces, des filiations de pensée et de vie, des modalités de transmission, des représentations intimes et collectives, a alors une portée universelle, au travers l’unheimlich du langage, de l’ici-en-deux de la situation analytique, ou de la scène artistique, de l’anachronie de l’interprétation. Et l’art comme la psychanalyse sont eux-mêmes des romans, et c’est l’histoire des transferts de transferts à laquelle les résistances contribuent. Pour V. Jankelévitch, « l’humour exige de l’homme qu’à l’idole renversée, démasquée, ne soit pas immédiatement substituée une autre idole». Son narcissisme trouve son ressort dans l’accueil courageux de la désillusion, et d’un travail de subjectivation.
La déshumanité concerne la destitution d’une ressemblance du semblable
Cette question de l’apparence humaine et des effets d’apparition/disparition de l’autre est au centre de l’hallucination négative, donc au principe même de l’expérience de régression trans- férentielle. Ce qu’on nomme vie psychique ne serait-ce pas précisément cette apparence humaine essentielle à laquelle on reconnaît l’humanité de tous les jours et qui assure au vivant inanimé une subjectivité?
«Zakhor! Souviens-toi!» est probablement le second commandement qui meut le travail d’Alain Kleinmann, un travail de mémoire. Une troisième injonction : «Et tu lui donneras un nom impérissable!». La décision de la mémoire engage une conception de la transmission, transmission de la transmission transcendant l’identification mimétique et la transmission de la haine en tant que haine de la transmission et jouissance narcissique clonique et clanique, le paradigme en étant l’envie et le fantasme omnipotent de destruction et de substitution.
Non seulement le deuil se trouve temporalisé, mais le monde lui-même se trouve agi d’une mobilité nouvelle. Apparition entre signification et signifiance, sillage des survivances, la voyance de l’image est le temps de sa métamorphose.
Pour Walter Benjamin, la mémoire est moins possession d’un remémoré, collection de choses passées, qu’appropriation, toujours dialectique du rapport de celles-ci à leur lieu : l’approxima- tion même de leur avoir lieu (Didi-Huberman, 1992). Ainsi, à propos de la métaphore archéo- logique du ressouvenir, erinerung, de l’acte de déterrer, ce qui importe est moins ce que l’on extrait, l’opération d’exhumer, ausgraben, que la modification du sol qui en résulte, portant en soi l’histoire de ses propres sédimentations : «La mémoire n’est pas un instrument qui servirait à la reconnaissance du passé, mais elle en est plutôt le médium » (Benjamin, 1928). La mémoire de l’artiste et de l’analyste dans la cure est bien, chaque fois, construction singulière (V. Smirnoff, 1993) toujours en transformation d’un « passé anachronique », et cette pleine et entière respon- sabilité généalogique de la régression transférentielle qui restitue aux visages leurs masques d’an- cêtre, et à partir de laquelle seulement des remaniements du matériau psychique sont conce- vables. Et c’est même à cette condition que l’interprétation, issue du silence de l’absent et ainsi acte de transférance aux origines, événement temporel de la subjectivité et – par excellence acte de manifestation de l’étranger au cœur de l’intime – est changement de vue et ouverture des possibles dans un processus d’historicisation. C’est ainsi que la mémoire mélancolique pourrait être cette agitation-immobile qui prive de l’émotion du présent et de l’intériorisation du sou- venir de l’amnésie : un affect du temps négligé. L’amour positivé de transfert, cette formation d’un singulier défi autocratique, participe d’une croyance en l’auto-guérison, vestige d’une perpétuation du refus d’abandonner un occulte et énigmatique transfert sur un objet psychique profondément enkysté et une idéalisation narcissique synthétisant un moi absolu dans une dépendance auto-sacrificielle à l’objet. Alors quelle disponibilité à se laisser modifier par les transferts permettrait au souvenir de se donner un à-venir et cela dans le présent; quand la réétrangéréisation de l’analyste se construit à travers «L’angoisse dans le contre-transfert et l’inquiétante étrangeté du transfert» et de l’artiste via un approfondissement de la dépressivité du deuil, un dessaisissement qui ouvre sur une mémoire : au moment précis où il se souvient, il devient autre. Il n’y aura ni émergence authentiquement vivante du souvenir sans cette trans- formation concomitante du moi, ni in-sight perceptif sans levée de l’amnésie infantile. La remé- moration n’est pas un but mais une méthode. Le transfert, comme moteur de l’investissement créatif, entre cette amnésie du symptôme et une dette réminiscente du langage, se sollipsise lorsque le moi de l’analyste ou de l’artiste ne peut, de par sa propre présence et son incarnation dans l’objet imaginaire idéalisant, dissymétriser la relation à l’objet à utiliser et à (re)-créer ou à la situation analytique. Une peinture par trop explicative, militante, pourrait bien alors participer d’une identification projective entraînant un processus d’enclavement d’un transfert intra-psy- chique «positif» annulant à la fois l’unheimlich du langage, et l’anachronie de l’interprétation polysémique et métaphorisante, productrice de réalité et de sens.
La subjectivation participe de l’universel du singulier et l’universel de la subjectivation
Ce peuple d’Israël semble animé par le désir de durer, de résister à l’effacement, de maintenir un certain rapport à l’être. Ce qui expliquerait l’obsession des anti-juifs de nous coller au contraire le signe de l’avoir absolu! L’entre-deux noms, ainsi Freud – «Ce dont tu hérites, acquiers-le pour mieux le posséder, ce qui sera laissé de côté sera d’un poids lourd » et Groucho Marx – « Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations nouvelles, qu’ont-elles fait pour moi?» (Wolkowicz, 2020), dit la force, l’ambivalence de la transmission, sa responsabilité réci- proque, qu’il y a du surdéterminé, de l’aléatoire, du libre arbitre, du choix de la névrose, qu’elle est vouée à se déformer, à se tordre, d’angoisse ou de rire, intégrant un manque, ne serait-ce que celui inhérent à l’échec du fantasme, l’élément étranger perturbant le narcissisme absolu (Grunberger, 1985), que la transmission est tordue, et ses effets imprévus. De même que la transmission entre générations est réciproque, la relation entre l’artiste et le spectateur l’est tout autant. Libnot lit-on à Pessah : enseignes à tes enfants, construits tes enfants, construis-toi par tes enfants!
« Et tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. »
Conclusion. En hébreu, « ami » c’est havèr, un mot dont deux anagrammes sont riches d’ensei- gnement, hibur, le lien et Bahar qui signifie le «choix», le fait de «choisir». Amitié, vie, choix et temps, qui marquent l’importance de l’intrication des liens d’amitié et des liaisons de pensée, l’occasion d’une réflexion philosophique articulée renouvelant le sens de la vie et le rapport au monde et aux autres. L’œuvre d’Alain Kleinmann met au travail les questions essentielles, ainsi
deuil et mémoire, et elle ouvre aux choix d’existence, à la transmission. Et dès lors en effet, ainsi que nous l’avions évoqué avec Marc-Alain Ouaknin à propos de notre livre La transmission en question(s) – en hommage à Michaël Bar Zvi et à Raphaël Draï, lors de son émission Talmudiques, comment ne pas penser à ce verset 19 du chapitre 30 du Deutéronome [1] : «Je prends aujourd’hui à témoin le ciel et la terre, que je vous ai proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ». Que signifie choisir ? Qu’appelle-t-on la vie? Qu’est-ce que vivre? Pourquoi ajouter «toi et ta descendance» et les mots «afin que tu vives»? Cette injonction dans ce verset participe de la transmission comme éthique et comme processus, la transmission de la transmission. Peu d’autres qu’Alain Kleinmann peuvent s’incarner autant dans ce «Et tu choisiras la vie», magnifiquement commenté par Raphaël Draï et Benno Gross. Une éthique de liberté responsable qui amène Kleinmann le peintre non seulement à faire partie de l’Histoire de l’art, mais à participer à faire l’histoire de l’art, de la culture.
Alain Kleinmann nous mobilise dans un véritable travail de culture, au sens freudien selon sa formule « Wo Es war, Soll Ich werden », là où Ça, Je doit advenir, désigné sous le sceau de « l’as- sèchement du Zuydersee », que Raphaël Draï a paraphrasé ainsi : « Wo Canaan war, Soll Israël werden», une conquête éthique par le travail de culture, physique, d’Eretz Israël, de la terre d’Israël, et par le geste de pensée qui métaphorise aussi le travail du peintre. Comme ses œuvres qui intriquent tradition, transmission, création. L’auteur est un père qui est un fils non divin, un étranger du dedans, un surmoi intériorisé, un étranger qui choisit son peuple et le guide. Le peuple s’invente et se réinvente, en l’intériorisant sous la forme non-idolâtre d’une grande idée, alors pas comme une icône intouchable incorporée; faire parler le destin et tenter de peser sur lui. Une conflictualisation des liens d’appartenance, une identité polyphonique, polyscénique, polysémique, démontre que l’identité comme la transmission, sont des constructions toujours en devenir, un processus qui échappe, ce qui en est la condition. L’artiste interroge : que faire de nos filiations entamées, blessées, confusionnantes, que faire de nos héritages, y compris mortifères, paradoxaux, brisés? Paradoxes qui rendent fou ou momifié, à l’origine d’un travail de métaphorisation, de symbolisation, d’historicisation, de subjectivation.
« Rien n’est plus entier qu’un cœur brisé » (Rabbi Nahman de Bratzlaw).
Chaque tableau est un mot d’un chapître d’un roman, chaque mot est fragment d’une histoire, un reste… L’art d’Alain Kleinmann ne cherche pas à nous imposer un sens mais à nous le faire vivre. Kleinmann conteste l’idée déconstructiviste que tout est Art, que la vie est Œuvre. Pour lui l’art est construction en devenir. Quelles traces demeurent en nous des quêtes antérieures des hommes ? Que l’univers de la peinture de Kleinmann puise dans les souvenirs transmis, dans le rêve, dans le vagabondage de la pensée associative ou dans les strates des littératures sacrées ou profanes. «Gam zou le tova!», «Rater mieux» comme disait Beckett, selon Ouaknin. Commenter, interpréter les histoires offertes par les livres : Wiesel, Jabès, Modiano, la Torah, le Talmud, la Kabbale, le livre de Jonas.
Dans la créativité le faire dérive de l’être, et le travail de l’artiste, comme dans la cure ana- lytique, c’est le temps même de la dérivation.
L’œuvre, comme transfert, est une passion agie
En reproduisant ce qui nous échappe, en reproduisant la perte de réalité, l’œuvre rend présente une réalité inconnue en négatif. Peut-être est-elle en effet davantage une amnésie en acte qu’un souvenir en acte? Et pourtant se dégage cette vérité d’un type bizarre : ce n’est qu’issue de la non-existence que l’existence peut émerger, le souvenir est oublié mais fait impression. Et l’im- pression est durable.
« Les images tiennent les mots dans un gémissement sous le poids millénaire d’une sincérité fausse et défigurée» (Paul Celan, Todtesfugue). Ainsi, plus qu’un travail de deuil, le processus tant artistique que psychanalytique est un travail de mélancolie. Comme s’il fallait ici encore oser cette pensée que dans une vie, tout dépend d’une véritable capacité du souvenir à se donner un à venir. Et cela, dans le présent. N’Hommer! L’œuvre actualise cette hallucinante pré- sence-absence : exister, se tenir hors de soi, un être là-bas, télescopage entre la clinique du contemporain et nos prières millénaires, L’an prochain à Jérusalem; étrangeté de l’exil et de temps mélangés, trouble de réalité et de pensée.
Alors Si c’était Jérusalem (Wolkowicz et Bar Zvi, 2019), comme un conte, un reste diurne, entre Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste, indissociables, entre idéal du moi et surmoi, entre symbole et symptôme, lieu transcendant du Primat de l’Autre, lieu du Nom, lieu des lieux
– Makom, lieu de passage de l’identité à l’existant, un peuple et une Loi s’y constituant ensemble par un travail spirituel, du lisible et de l’interprétation : et pour les autres, lieu du Trésor du Symbolique garant d’une puissance infinie d’être, pensable en seuls termes métonymiques d’avoir, envie, identification mimétique, destruction, et substitution. Voilà Yerushalaïm qui nous habite et d’où l’on parle, deuil, mémoire, joie et lumière, lieu de la parole fondatrice; «Je serai» est un infini, pas un absolu. En hébreu, Shem (le nom), Sham (là-bas), Shema (Écoute)… « Les actions des pères sont des signes pour les fils » (maxime juive).
En revendiquant son être Juif, Freud interroge le reste, ce qui résiste de tout ce patrimoine, au-delà de la foi et d’un excès d’orgueil national : « l’essentiel », ces obscures forces émotionnelles d’autant plus puissantes qu’on peut moins les exprimer par des mots ainsi que la claire conscience d’une identité intérieure, d’un sentiment d’appartenance suffisamment fiable pour s’extraire des préjugés et de la masse compacte, résultant d’une même construction psychique des Juifs, de modalités spécifiques de la transmission, conjuguant « l’héritage archaïque de l’homme » et une identification anti-idolâtre, par intériorisation, à L’Homme Moïse, le meilleur de ses fils, puis au Temple par-delà sa destruction, sous la forme d’une grande idée, un édifice invisible (Wolkowicz, 2015), trait identificatoire participant de la force d’un moi commun et d’un surmoi culturel inconscient, d’une communauté de destin.
Ce qu’il faut bien nommer déshumain réside dans cette fuite de l’être vers son agglomérat compact ; ce jeu identificatoire, en quoi l’humain relève à la fois de l’apparence et de la ressem- blance, est annihilé dans la masse, par incorporation et disparition plutôt que perte et deuil.
Le transfert à l’œuvre dispose de cette mémoire hallucinatoire régressive qui va rechercher les formes vivantes du « présent réminiscent d’un passé anachronique » (Fédida 1995), dès lors que l’hallucination négative (Green, 1977) rendrait possible, par la voie de la régression trans- férentielle, le mouvement d’absentisation propre à l’action psychique, quasiment physique, sur la présence, de telle sorte que remontent les figures ignorées, les souvenirs.
Que l’œuvre ouvre à une anachronie du passé justifierait sans doute que l’interprétation, issue du silence de l’absent et par excellence acte de manifestation de l’étranger au cœur de l’intime, ne puisse jamais être formée hors du paradigme du rêve (Fédida, 2000), le rêve étant la mémoire archaïque du transfert qui est l’infantile, l’aperception interne au transfert du transfert de l’autre, et l’analyse de sa résistance, qui rend possible une oscillation métaphoro-métonymique garantissant la négativité de la construction dans l’après-coup, si l’artiste demeure celui qui accorde au langage d’être l’interlocuteur véritable de la parole – « le lieu de l’anachronicisation du temps» (Fédida, 1995) et de la remémoration, formée à l’inquiétante-étrangeté de l’autre- moi du rêve, ainsi acte de transférance aux origines. Cette topique de l’autre-absent, lorsque c’est transférentiellement que le rêve donne image, pense, se ressouvient, tout en étant suscep- tible de renseigner sur la surdétermination psychique et sur la compulsion de répétition, tout en potentialisant une puissance d’imagination.
Transfiguration de la mémoire traumatique dans l’œuvre d’art
«Le travail de deuil se doit de remplir une mission psychique définie qui consiste à établir une séparation entre les morts d’un côté, les souvenirs et les espérances des survivants de l’autre» (Freud, Totem et tabou, 1912). Le traumatique est cette destitution du temps d’intériorisation du vécu de l’événement ou encore cette destruction des potentialités temporelles propres à une réminiscence, tel que cela apparaît, produit par les idéaux-dépressifs, dans la remémoration s’emparant de la souvenance participant d’une emprise narcissique mélancolique, dans certaines œuvres mimétiques, plaquées. Et l’on peut se demander, a contrario, comment la détermination, le génie de l’artiste, transfigurent la mémoire traumatique dans l’œuvre d’art. La mélancolie serait alors le signe que, depuis longtemps, s’est substituée à la guerre (l’autre-hostile) la dispa- rition en masse. Le souvenir compulsif montre en négatif que le deuil assure au vivant la garantie de son impossibilité de se représenter sa propre mort, et c’est ainsi que se peut concevoir l’éco- nomie d’une défense dépressive du travail de deuil face à la dépression qui serait l’expérience vitale de la mort impossible. Comme si la mémoire avait besoin d’un deuil, événement (avec la pudeur) pour ainsi dire transcendant de la subjectivité.
L’hallucination négative favoriserait l’activité fantasmatique et restituerait, grâce à cet autre, « les conditions favorables de la capacité dépressive » ; la construction du souvenir, création plus que retrouvaille, formation de compromis, génère des affects contradictoires contribuant au travail de deuil et à la capacité de chacun à créer-trouver sa propre histoire. G. Perec (1985, p. 84) décrit ce processus de réaffectation propre à l’analyse : le patient, en quête d’un lieu pour exister, fait l’expérience inédite de cette chose passée dans le présent, c’est–à-dire dans le trans- fert. Dans Construction puis dans L’Homme Moïse, il s’agira encore du retrait de la présence sensorielle, condition de langage d’une mémoire anachronique grâce à laquelle la parole recueille sa figurabilité, au sens où le langage réserve la mémoire phylogénétique d’un meurtre ayant eu lieu et restant pourtant toujours à accomplir. Quelle dépressivité, travail psychique d’arrachement à l’état gelé déprimé, serait nécessaire pour cet étrangement du sujet, œuvre psychique de déga- gement de l’emprise hallucinatoire de la parole, quand celle-ci ne peut se dissuader de constituer positivement le langage en idéal?
Moshé et Ytzkhak meurent, vont au paradis, continuent évidemment à discuter et à rire fort. Et Dieu, sollicité par les autres qui se plaignent de leur présence bruyante, leur demande ce qui les anime autant. — Des souvenirs! — Des souvenirs? — Oui, d’Auschwitz — D’Auschwitz et ça vous fait rire ? — Oui, tu ne peux pas comprendre, tu n’y étais pas !
« D’emblée la résolution du Roi laissa la trace de son retrait dans la transparence suprême. Une flamme obscure jaillit du frémissement de l’Infini, dans l’enfermement de son enfermement. Telle une forme dans l’informe, inscrite sur le sceau. Ni blanche, ni noire, ni rouge, ni verte, ni d’aucune couleur. Quand ensuite il régla le commensurable, il fit surgir des couleurs qui illuminèrent l’enfermement. Et de la flamme jaillit une source en aval de laquelle apparurent les teintes de ces couleurs… par-delà ce point c’est l’inconnu, aussi est-il appelé : «commencement», dire premier de tout.» (Traduction du Zohar : Charles Mopsik)
Alain Kleinmann : construire une identité Sinaïtique.
Notes
1. Fédida P., «La mélancolie de l’immortel», Le Site de l’étranger – la situation psychanalytique, Paris, PUF, 1995.
2. Fédida P., « La parole de l’œuvre », in Humain/Déshumain, Paris, PUF, 2007.
3. Wolkowicz M.G., «N’Hommer – De la figuration des noms à la résistance des noms, de Sham, Shem au Shema, du wicz au witz », in La Force du nom, Masson C. et Wolkowicz M.G. (dir.), Paris, Éditions du Rocher/Desclée De Brower, 2010.
4. Wolkowicz M.G., «Le transfert hypocondriaque ou l’insomniaque analyste», Un monde en Trans – Transfert de transferts ou d’une hypo- condrie du contemporain, Sèvres, EDK, 2009.
Références bibliographiques
Appelfeld A., in Roth P., Parlons travail, Paris, Gallimard.
Benjamin W. (1928), Denkbilder, in Mythe et violence, Paris, Denoël, 1991.
Benjamin W. (1916), Destruction et mémoire, OC1, Paris, Payot, 2003. Didi-Huberman G., Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, 1992.
Fédida P., L’absence. Paris, Gallimard, 1978.
Fédida P., Le site de l’étranger, Paris, Puf, 1995.
Fédida P., Par où commence le corps humain, Paris, Puf, 2000.
Fédida P., Des bienfaits de la dépression, Paris, Odile Jacob, 2001. Freud S. (1937), Analyse sans fin et analyse avec fin, in Résultats, Idées, Problèmes, Paris, PUF, 1985.
Freud S. (1912), Totem et tabou, Trad. M. Weber, Paris, Gallimard, 1983.
Freud S. (1938), L’Homme Moïse et la religion monothéiste, préf. M. Moscovici, Paris, Gallimard, 1986.
Freud. S., Der Wahn und die Traüme in W. Jensens «Gradiva», Verlag, 1907.
Granoff W., Filiations – L’avenir du complexe d’Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, 1975.
Green A, L’hallucination négative, in L’Événement psychiatrique, n° 3, 1977.
Grunberger B., Le narcissisme, Paris, PB Payot, 1985.
Jankélévitch, V, L’ironie, Champs, Essais, 1964.
Kleinmann A., Interrogations sur l’art contemporain, Paris, Max Chaleil, 2017.
Kleinmann A., Alain Kleinmann, Somogy, éditions d’Art, 2014. Laplanche J., Problématiques 5. Le baquet, transcendance du transfert, Paris, Puf, 1998.
Morgensztern.I, Rothko, un humaniste abstrait, film, éditions Montparnasse, 2003.
Newman B., Selected Writings, op. cit., Déclarations, p. 305.
Ouaknin M.A., Tout l’humour juif, préface, Paris, Buchet Chastel, 2004. Perec G., Penser/classer, Hachette, 1985.
Scully.S., Mark Rothko, corps de lumière, L’échoppe, 2000.
Smirnoff V., Le contre-transfert, maladie infantile de l’analyste, in Un Promeneur analytique, préf. M. Moscovici, Paris, Calmann-Lévy, 1998. Widlöcher D., Comment on devient psychanalyste, et comment on le reste, Paris, Odile Jacob, 2010.
Wolkowicz M.G., Le transfert hypocondriaque ou l’insomniaque ana- lyste, in Wolkowicz M.G., Un monde en Trans -Transfert de transferts ou d’une hypocondrie du contemporain : pp. 271-331. Paris, EDK & des Rosiers, 2015.
Wolkowicz M.G. (dir.), La psychologie de masse, aujourd’hui, Paris, Édition des Rosiers, 2012.
Wolkowicz M.G. (dir.), États du Symbolique. Depuis L’Homme Moïse et
5. Wolkowicz, M.G., «Ouverture : De Shmattès à Panim. Figures et tra- versées des noms. De l’intérieur des visages à l’étranger du langage – Le visage comme construction de l’originaire ou malaise sans civilisation», in Masson C. et Wolkowicz M.G. (dir.), Panim/Pnim, L’exil prend-il au visage ?, Sèvres, EDK Éditions, 2009.
6. Wolkowicz M.G., Sham/Shem, «Two sculptures» at Israël Museum, Jérusalem.
7. «Nous vivons un temps particulièrement curieux – écrivait encore Freud en 1938 dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste –, nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. »
la religion monothéiste, en passant par Freud, Rothko, Appelfeld… – Droit, Loi, Psychanalyse, Paris, In Press (coll. Schibboleth – Actualité de Freud), 2015.
Wolkowicz M.G. (dir.), Le sujet face au réel et dans la transmission, Paris, In Press, 2017.
Wolkowicz M.G. (dir.), La transmission en question(s), Paris, In Press (coll. Schibboleth – Actualité de Freud), 2020.
Wolkowicz M.G. et Bar Zvi M. (dir.), Si c’était Jérusalem, Paris, In Press (coll. Schibboleth – Actualité de Freud), 2019.
Wolkowicz M.G., Mériter son visage?, in Wolkowicz M.G., États du Symbolique, Paris, In Press, 2014.
Wolkowicz M.G. (dir.), Un monde enTrans – Transfert de transferts ou d’une hypocondrie du contemporain, Sèvres, Éditions EDK, 2009. Wolkowicz, M.G., «Entre survivance et réminiscences», Review of the Department of psycho-analysis and clinical psycho-pathology of the Columbia University, t. 2, vol. 44, n°72, Mossley, Tau Press, March 2006.
Wolkowicz M.G., L’édifice invisible ou la déchirure du rêve éveillé, Journal of the London Psychiatric Society, n°20, septembre 2008.
Wolkowicz M.G (dir), Panim/Pnim, l’exil prend-il au visage ?, éditions des Rosiers, Paris, 2008.
Wolkowicz M.G., L’Écriture de vie – le rêve de la nuit et les cahiers de l’absence, les processus de subjectivation et la construction du souvenir, in PTAH, n°15/16, Géographie et histoire de la subjectivité, Paris, Éditions ARAPS, 2004.
Wolkowicz M.G., Sham/Shem, Two sculptures at the Israël Museum, Jerusalem, 2006.
Wolkowicz M.G., Meina : In the shadow of Création; Where words are Missing or Have Failed, Where We Have Missed or Failed Them, in Lellouche Ofer : HEAD II, Tel Aviv Museum of Art, 2012.
Wolkowicz M.G., The transmission of hatred and the hatred of trans- mission. The psychopathology of a murder and an anatomy of a silence. The nobody’s name. A contemporary symptom, in Lange A, Mayerhofer K., Porat D., Schiffmann L.H., An end to antisemitism. Confronting antisemitism from, perspectives of philosophy and social sciences, De Gruyter, 2021.
Wolkowicz M.G. (dir.), L’identité en question(s) – Qu’est-ce qui fait peuple? / Le Sujet Juif (Dir.), coll. Schibboleth – Actualité de Freud, Paris, In Press, 2022.
«Zwischen Überleben und Reminiszenz, Menschliches Nichtmenschliches, der Schatten des Erinnerbaren, eine Konstruktion im Herzen des Vertrauten — Das eigene Gesicht verdienen» / «Between Survivance and Reminiscence, Human
Dehuman, the Shadow of the Memorable, a Construction in the Heart of the Intimate — Deserving One’s Face », in Ofer Lellouche, catalogue, Vienne (Autriche), éditions Musée Albertina, 2023.

Richard Prasquier
ALAIN KLEINMANN
Clair ou obscur, sonore ou silencieux, obvie ou caché, ouvert ou fermé, dévoilé ou dissimulé, actuel ou passé, vivant ou mort, notre condition humaine est pétrie de ces oppositions entre présence et absence qui structurent nos attachements, nos désirs, nos apprentissages, nos craintes et nos rituels, qui font de nous des hommes et pas encore des robots. Sur cette pâte travaillent les praticiens de l’art, de l’érotisme, de la psychanalyse et de la manipulation des masses. Ils savent susciter le désir, extraire le non-dit et enchanter le présent. La peinture occidentale s’est longtemps développée comme un jeu entre ombre et lumière.
Mais près du gouffre, que vaut la dialectique du décryptage ? Elle présuppose un minimum de commun, une parole, une écriture, des images.
Le vieux Simon Dubnow, immense historien du judaïsme, enfermé par les nazis dans le ghetto de Riga, disait avant de mourir à ses proches : Yidn, shraybt un farshraybt (« Juifs, écrivez et conservez »). Sur les mêmes bases, Emmanuel RIngelblum et son équipe ont fait dans le ghetto de Varsovie l’inoubliable travail de mémoire que l’on connait. De nombreux Juifs pourchassés ont écrit des témoignages à jamais perdus et il est inutile d’insister sur les documents écrits ou oraux laissés par les survivants. Travail immense et absolument indispensable. Pourtant, Primo Levi, dans les Naufragés et les Rescapés, nous met en garde : ceux qui écrivent sont par définition des survivants, qui n’ont pas été « dans le ventre de la Gorgone ».
D’où le paradoxe : les lieux d’extermination de l’Action Reinhard ou ceux des tueries de masse n’ont pas eu de survivants ou un nombre minuscule, ces quelques Sonderkommandos rescapés des révoltes de Sobibor ou de Treblinka ou, encore moins nombreux, ceux qui ont pu s’enfuir. De Belzec, peut-être le lieu le plus emblématique de la Shoah, on ne possède qu’un témoignage isolé et très bref de Juif qui y ait été déporté. Et par définition, il était un survivant…
Ce sont eux qui nous ont fait comprendre ce que fut la Shoah, mais ce sont les morts qui en constituent la vérité. Elle est insoutenable et irreprésentable. Car six millions d’hommes, femmes, enfants, vieillards, assassinés de sang-froid, cela représente la plus profonde coupure anthropologique de l’histoire et fait disparaitre ce continuum de sens commun sans lequel nous ne pouvons pas échanger. Et cette coupure, que Claude Lanzmann a essayé d’exprimer à sa façon dans son film Shoah, outrepasse le langage descriptif. Pour l’évoquer, tout en la mettant à distance, Georges Perec a écrit un livre sans lettre « e ».
Que peut la peinture ? Adorno a écrit, on le sait, qu’il n’y a pas d’art possible après Auschwitz, ce nom devenu, probablement à tort, métonymie de la Shoah. Adorno se trompait, bien sûr. L’humanité a continué et a produit des œuvres d’art bouleversantes. Après avoir négligé la Shoah, elle a appris à la commémorer, à la métaboliser, et aussi, malheureusement, à l’instrumentaliser.
Mais a-t-elle su la représenter ? Non, bien sûr, ce n’est pas possible. Personnellement, cependant, dans les œuvres de Alain Kleinmann, dans ces escaliers délabrés qui donnent sur des portes qui s’ouvrent sur le noir ou sur rien, dans ces petits objets obstinés qui ont perdu leur usage, dans ces visages indéterminés mais si présents en même temps, paisibles, fragiles et fugitifs, je ressens ce sentiment qui m’étreint souvent dans les lieux de la Shoah, la proximité du gouffre…
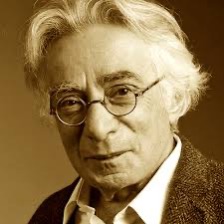
Tobie Nathan
TEL-AVIV ET UNE TOILE D’ALAIN KLEINMANN ; LA BEAUTÉ NAÎT DU DÉSORDRE.
Tous les matins, même certains jours de grand vent en hiver, la lumière se lève sur Tel-Aviv. Elle provient de loin, de Jérusalem, enjambe les tours et s’en va éclabousser la mer — une lumière parfaite, celle des villes dédiées aux dieux, Delphes, Olympie, Babylone… Mais à Tel-Aviv, on chercherait en vain le temple d’un éventuel patron de la ville, elle qui a inscrit, dans ses fondements, le culte de l’éphémère. Tous les jours, on craint de voir cette lumière détournée au bénéfice de l’instant… Réputée poumon économique, le travail y prend pourtant un air de vacances. Non que les habitants y travaillent peu, bien au contraire ; ils s’affairent par tous temps, en tous sens ! Mais les vacances ne sont-elles pas dédiées à explorer les marges de l’ordonnancement du monde ? C’est ce que fait Tel-Aviv tous les jours, de l’aube à l’aube : encenser les marges. De là, ce sentiment de liberté qui l’imprègne… cette impression, aussi, que, si l’on revenait demain, elle aurait encore changé.
Ville de toutes les libertés, des corps murissant au soleil, des vallées qu’on laisse deviner à la cambrure des jeans, des grossesses nues, des nombrils surgissant ronds hors des ceintures des femmes, des muscles gonflés de sève, de ces hommes fiers de leur peau épilée jusqu’à l’intime, satisfaits de leur crâne luisant… Si à Jérusalem, la plupart des hommes ont la tête couverte, à Tel-Aviv, les crânes virils sont rasés. Selon la tradition, les Juifs se couvrent pour se rappeler à chaque moment de leur vie qu’une force trône au-dessus d’eux. Tel-Aviv serait donc une ville de crâneurs, comme si les hommes y prétendaient n’avoir ni honte devant dieu ni peur de la chaleur du soleil. Lorsqu’on regarde ces corps qui déambulent sur les plages, la ville s’impose grecque-antique, passionnée de beautés physiques s’étirant sur le sable, arc-boutant leur force. Elle respire la liberté sexuelle, aussi — non pas la licence ! Les regards toujours à l’affût repèrent sans cesse des objets d’amour enchantés par la pleine lumière.
Ici, l’amour est de tous les moments, au café, dans les bus, les taxis, les boîtes de nuit, les fêtes nocturnes, si fréquentes sur les terrasses, à la plage aussi, bien sûr — à la plage, surtout !
S’il me restait une seule image de Tel-Aviv, ce serait celle de ce pas suspendu, de cette tête se retournant d’un seul mouvement, capturée par la grâce d’une démarche inconnue. Et ici, il s’agit de toutes les amours, celles des couples hétéro enlacés, descendant le boulevard Rothschild tenant leurs jeunes enfants par la main, des rendez-vous de seniors dans les squares de kikar hamedina, des couples gays, avec ou sans enfants, attablés au café Evita… Les jeunes gays de Los Angeles, de Berlin, de Rome ou de Paris se donnent rendez-vous ici tous les ans, pour la parade du mois de juin. Les captifs des villes de province, des mondes aux morales révolues, des pays aux cultures confinées, en rêvent chaque jour. Et les autochtones, les fondateurs, les Yékés réfugiés au nord de la ville, s’enorgueillissent doctement qu’ici tout est permis… Est-ce de là que la ville est inquiète, fébrile plutôt, comme effrayée par le temps ? Est-ce la raison pour laquelle on la surnomme « la ville qui ne dort jamais », comme si, se sachant ouverte à tous les abandons, elle se surveillait jour et nuit, redoutant le sommeil ?
Ville d’insomniaques qui prend soin du pays tout entier car celui qui ne dort jamais est appelé « le gardien d’Israël » ?
Tel-Aviv n’en finit pas de raconter son histoire, à tel point qu’elle paraît légende. En 1909, encore longue étendue de dunes, royaume de quelques pêcheurs connaissant des coins poissonneux, la ville s’est détournée de la mer pour sortir de l’ombre… La mer, alors, n’était pas son essence, mais sa marge. On s’y baignait un peu, on venait surtout se laisser hypnotiser par le cycle des vagues… Les choses ont changé ! Pour les cent ans de la ville, la tayelet, la promenade du bord de mer, a offert un rythme à la beauté des corps sur 13,7 km, depuis Herzlyia jusqu’à Bat Yam. La marge s’est faite vitrine. On se donne à voir, courant, roulant à bicyclette, glissant sur des roulettes, tissant des habitudes. Des mères de famille au pas de gymnastique les mains sur la poussette « Mac-Laren » dernier modèle, de riches épouses joggant leurs Ipods pour étouffer les klaxons, des retraités parcourant le front de mer, les yeux fixés sur leur chrono, et l’on ne peut rater les tennis blanches des femmes arabes enveloppées de noir. Tous se retrouvent ici pour un rite œcuménique à la gloire des corps. Et lorsqu’on s’arrête enfin pour reprendre son souffle, sur la plage Gordon, au café Lala Land, c’est encore pour admirer des corps, ceux des surfeurs qui dansent les vagues pour dépasser le vent.
Quant aux premiers carrés d’immeubles, ceux du bord de mer, on se demande qui peut y habiter, dans le dantesque vacarme des camions, coincés entre l’impossible rue Hayarkon et les embruns. De fait, une maison sur deux est en chantier d’où l’on voit parfois surgir des êtres étranges, en culotte orange, les cheveux ébouriffés et la barbe sale, vous proposer une place de parking… Ce sont les gardiens des marges, vieux Russes abandonnés par l’histoire… Si vous êtes curieux, parlez avec eux de littérature ! L’âme de la ville se trouve ici, en bord de mer, aux confins…
Curieux retournement de l’histoire : au IXème siècle av. J.-C., les Philistins peuplaient les rivages, les Juifs les collines de Judée et de Samarie, aujourd’hui, les Palestiniens sont là-bas, les Juifs ici ! Tel-Aviv est l’essence d’Israël, on y parle toutes les langues, les langues oubliées — yiddish, ladino, judéo-arabe des Juifs du Yémen, d’Irak ou du Maroc et les langues d’aujourd’hui… Quelle que soit la vôtre, vous trouverez un chauffeur de taxi capable de vous offrir une conversation. Les habitants détestent les relations formelles, se refusent à seulement fournir une information, répondre à une question. Ils vous apostrophent, veulent vous conseiller, vous guider. Et puis survient la question, toujours la même : « D’où viens-tu ? _ De Paris ! _ Oui… mais avant ? » On reconnait Tel-Aviv à cette interrogation : Mais avant ? D’où provenaient tes parents, tes ancêtres ? Car qui sait ? Si l’on se révélait cousins, après tout ? Lieu de toutes les parentés, ville de tous les possibles, des bonheurs les plus inattendus… Aucun plaisir n’égale ce moment pour rien, ce temps à simplement passer le temps. Ce temps aux marges…
Si Jérusalem est la ville où l’on s’en va chercher les réponses, guettant messies et prophètes qui, en vérité, y pullulent, Tel-Aviv est la ville de tous les fantasmes. Comme si l’on en avait soupé de ressasser l’histoire… Ici, quoiqu’il arrive, il s’agira toujours d’éplucher les apparences jusqu’à faire apparaître la structure cachée. Un architecte doué a su inscrire dans la pierre de ce bâtiment de luxe, l’immeuble Isrotel, la philosophie de cette ville qui nourrit la passion d’arracher l’écorce jusqu’à parvenir au noyau…
Sous l’écorce, le Juif… C’est ici que, pour la première fois depuis deux millénaires, on n’a plus eu besoin de se poser la question d’être juif ; où c’est devenu une évidence — ni une fierté ni une tare… rien qu’un fait, comme le soleil qui se lève chaque matin ! Les gens s’y bousculent, les voitures s’entrechoquent, les bruits sont impudiques, une anarchie constitutive y fait et défait inlassablement l’espace, comme la mer sur le sable.
En 1909, sur cette plage, soixante familles se sont partagé les lotissements — la photo est célèbre, accrochée en bonne place dans le bureau du maire ! — c’était alors une longue étendue de sable. Et l’on ne peut s’empêcher de penser que les habitants de Tel-Aviv craignent que, derrière les apparences, elle soit restée ce qu’elle a toujours été, une plage, rien qu’une plage où la mer finira un jour par tout effacer…
Un petit bistrot dans une rue proche de la mer, une rue qui porte un nom de philosophe, de savant ou de talmudiste, comme presque toutes dans cette ville… Parquet ciré, bibliothèques de bois verni, un chat obèse paresse sur un sofa et une femme vous demande ce que vous voulez boire dans la langue de la Bible… Sur un mur peint en blanc, un tableau d’Alain Kleinmann…
Combien je lui donne raison à cette femme, les tableaux d’Alain Kleinmann sont l’expression parfaite de la philosophie de Tel-Aviv, à la fois vertiges de virtuosité technique et plongée immédiate dans le ventre de l’histoire. Je nourris une admiration absolue pour son œuvre, ses tableaux, ses bronzes, une admiration brute, presque « sauvage », née, me semble-t-il, de l’étonnement de voir surgir la beauté du désordre, comme Dieu a créé la perfection de l’homme d’une simple motte d’argile.

Thibault Moreau
UNE ŒUVRE DE PAROLE. AVEC L’ART D’ALAIN KLEINMANN
« Les pierres importent moins que les souvenirs transmis par les pères ; le souvenir symbolisé par les pierres pourra être évoqué sans elles afin de se perpétuer parmi les générations à venir1.»
Les mots pour peindre
« Je ne fais pas de différence de nature entre une peinture, une sculpture, un dessin, une gravure ou des matériaux. Ce sont comme les différents mots avec lesquels on peut construire des phrases. Plus le vocabulaire est développé, plus précise est l’expression. J’ai le même sentiment en ce qui concerne des photos, des tissus, des tickets, des objets, des écrits, des numéros, des alphabets, des signes typographiques ou musicaux, des cartons ondulés, des timbres, des docu- ments… Ce sont des mots pour peindre2. »
Peindre comme respirer
« J’ai commencé à peindre à l’huile sur toile quand j’avais 7 ans et j’ai fait ma première exposition à 18 ans. La peinture m’a donc toujours semblé un langage proche et naturel et je n’ai jamais ressenti le besoin d’en faire une mythologie ou une sacralisation. C’était simplement le langage avec lequel je pouvais parler “le plus loin et le plus profond”, et cela depuis mon enfance. Pendant les rares périodes durant lesquelles je n’ai pas peint, j’ai eu l’impression d’étouffer, comme cela arriverait à quelqu’un qu’on empêcherait de parler pendant plusieurs semaines3.»
Sous le beau nom de « Galerie du temps », le musée du Louvre-Lens présente une sélection de «plus de 200 chefs-d’œuvre issus des collections du Louvre […] et offre un parcours inédit à travers l’histoire de l’art4 » : elle « permet d’appréhender […] toute une part de l’histoire de la création humaine européenne, proche-orientale, égyptienne et indienne, de l’invention de l’écriture à la révolution industrielle5 ».
Quel étonnement pour un visiteur arpentant cette galerie et songeant cet été 2020 au thème «Mémoire, transmission, création/art, psychanalyse, pensée juive», de n’y trouver nulle trace ou mention de la civilisation traversant la plus grande partie de ces cinq millénaires d’histoire, et sans doute la plus vivace de toutes : celle dont s’est conçu et s’invente le judaïsme toujours vivant.
Étonnement dont notre réflexion prendra un de ses départs, confrontant cette observation, les questions et hypothèses qu’elle appelle, avec les manifestations de l’art d’Alain Kleinmann, telles qu’apparaissant dans l’exposition de ses toiles récentes au Centre Européen du Judaïsme (septembre 2020), qui côtoyait la conférence dont ce texte est issu, dans la lecture de son cata- logue, ou en lui rendant visite en son atelier : pour proposer quelques pistes de réflexion sur la gageure de son art aujourd’hui, sa pratique, sa filiation au judaïsme.
Dans ce cortège de civilisations peuplant la Galerie du temps, l’absence du judaïsme est sin- gulière, intrigante et probablement instructive. La plupart de ces civilisations élues pour, de leur cortège, donner un aperçu de «la création humaine européenne, proche-orientale, égyptienne et indienne, de l’invention de l’écriture à la révolution industrielle» sont citées dans les tradi- tions écrite et orale dont vit et que véhicule le judaïsme — qui a eu affaire à elles dans sa construction et donne à leur propos abondance d’indications au fil de ses récits. Serait-il excessif de qualifier de commun dénominateur de ces civilisations accueillies dans cette galerie leur côtoiement du judaïsme, de sorte que celui-ci pourrait en être un fil conducteur, voire un de leurs historiographes?
Nous devons corriger : nous avons dit qu’il n’y avait nulle trace du judaïsme dans ce musée ; en effet, nous n’avons vu ou lu aucun objet ou œuvre ou texte témoignant de la culture ou de la création juive dans notre visite, ni aucune mention de cette civilisation, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi on n’en pourrait pas présenter un seul témoignage; il y a toutefois une exception à cette exception, trouvée dans la lecture de l’ouvrage cité plus haut, Tout le Louvre-Lens, qui fait office de guide pour le musée en l’espèce d’une indication dans la fresque tempo- relle : « 1000-962 av. J.-C. : Règne supposé de David, roi de Juda et d’Israël6 ». Notons au passage que pour les dizaines d’autres dates retenues dans les chronologies de cet ouvrage, c’est la seule dont le personnage soit affecté d’un indice d’incertitude; d’aucun des rois ou person- nages mentionnés il n’est dit que son règne serait «supposé»7 – sauf David : quel attribut lui réserverait donc un tel statut d’exception?
Pour éclairer cette absence8 plusieurs hypothèses, se complétant éventuellement, peuvent être évoquées, mêlant des raisons internes, propres au judaïsme, ou externes, c’est-à-dire liées à ses entourages.
La principale des raisons internes – un caractère majeur du judaïsme – est l’interdit de l’ido- lâtrie et ses défenses : prohibition de la fabrication de représentations peintes, sculptées, gravées protégeant de leur attrait (Exode 20, 49).
Il en résulterait qu’il n’y aurait pas d’œuvres à exposer ? Cette idée relève d’une opinion mal informée, inexacte : bien que dans la pratique du judaïsme la création artistique ait tradition- nellement été réservée à «“l’enjolivement du commandement” (hiddour mitsvah)», et soit alors très encadrée10, elle existe néanmoins, et a, dans ce registre, donné lieu à la fabrication d’objets rituels et à la peinture ou la sculpture d’images présentes dans les synagogues.
À l’intersection des raisons internes et des externes, on trouve les rapports que les Bnei Israël, les Fils d’Israël, ont entretenus avec les nations au sein desquelles ils ont vécu, en exil, réguliè- rement persécutés (aux prises avec les différentes figures du mode de vie en terre étrangère plus ou moins hospitalière ou hostile : défense, exode, assimilation, intégration, marranisme, sou- mission, conversion, etc.); et comment ces rapports se sont traduits dans les modalités de leur vie psychique, tant individuelle que collective et donc dans la création d’objets culturels, artistiques.
Sous la catégorie des raisons externes se regroupent les dispositions et actions – si ordinaire- ment hostiles – des entourages dans lesquels ce peuple a vécu (notamment la mise à l’écart, les restrictions de pratiques, les censures, la répression de la pensée, ou pis, l’expulsion, voire la destruction des patrimoines et l’assassinat des personnes), causes d’un environnement tirant à conséquences pour ce peuple en nombre de domaines et figures de la vie, du savoir, de la conscience individuelle ou collective, de la création et de l’expression, allant de l’empêchement implicite ou explicite du développement des savoirs et savoir-faire, des voies de transmission, à des modes de vie précaires, incertains, voire dangereux quand il faut faire face à la volonté d’anéantir entraînant migrations ou disparitions.
Il en résulte que d’une part le mouvement de création est bridé, soit par la prohibition de la création d’images peintes ou sculptées, soit par la censure à l’égard des constructions du judaïsme; et d’autre part, ce qui a pu naître d’un art «décoratif» ou d’un artisanat dédié aux objets de culte, a bien souvent été dispersé ou détruit. Quant aux éléments culturels qui auront survécu à ces facteurs, il leur reste encore à apparaître dans le cadre des recherches des spécia- listes de l’art et autres collectionneurs ou concepteurs de musées.
Ici joue le rapport à l’art en France, marqué par un romano-christianisme11 qui a infusé ou organisé la conception même de ce qui relève de l’art ou de la culture, et par conséquent a déterminé la sélection de ce qui est digne de rentrer dans l’histoire, les collections, les musées, livres, films, sites numériques, etc. Or, s’il existe une composante du christianisme qui veut poursuivre à sa manière le judaïsme sans le condamner (cf. la condamnation du marcionisme, et les motions de Vatican II redessinant la place des Juifs dans les discours), elle est concurrencée par une autre qui veut substituer le Chrétien au Juif (à commencer par le modelage de la figure d’un Jésus déjudaïsé, incirconcis12), et qui pour ce faire mène une double action et d’annexion de l’histoire d’Israël comme sa propre histoire, et du recouvrement du nom d’Israël par le sien au nom de la vérité (Vetus Israël/Verus Israël13); l’absence du judaïsme dans les collections pré- sentées au Louvre-Lens pourrait matérialiser une occultation de cet acabit…
Sous un autre angle, nous avons nommé le goût d’empire que cultive le romano-christia- nisme, qui développe et se développe avec une notion d’universel que le singulier pluriel juif14 incommode, ou agace peut-être : parce qu’avec son sens de l’infini, il défendrait cette tentation de totalité15 ?
Enfin, dans le christianisme lui-même, par-delà les différentes déclinaisons propres à ses divers courants (catholicisme, orthodoxie, protestantismes…), la place faite aux images (icônes, sculp- tures…) conjuguée avec la notion d’incarnation peut marquer, pratiquement, c’est-à-dire malgré les savantes constructions théologiques, une régression du monothéisme en une religion connaissant (mais ne reconnaissant pas) plusieurs divinités : évoquons la place du crucifix ou de la Vierge Marie, et des icônes la représentant.
Qu’y aurait-il donc de si gênant à donner sa place à une des principales matrices de la civili- sation occidentale pour une des branches qui lui doit tant ?
Paul Salmona et Claire Soussen préfèrent ne pas interpréter, intentionnaliser ce phénomène, et, plutôt que de parler d’occultation, décrivent, explorent, déplorent une « tâche aveugle dans le récit national16 ». Les mobiles de l’ignorance sont complexes à démêler… (entre crainte ou refus de savoir, censure, inconscience, négligence, atavisme culturel, ilotisme, fabrication d’in- nocence, négation d’une dette symbolique, etc.).
Ce phénomène du refus du judaïsme, s’il vient à s’intensifier comme à plusieurs reprises dans l’histoire et produire des effets de destruction de tout ce qui est juif dans les multiples guerres menées par les différentes puissances conquérantes à travers le Moyen-Orient et l’Europe, se traduirait tant par une raréfaction des objets et traces propres aux développements du judaïsme dans l’Occident comme dans le Moyen-Orient ou le Maghreb, que dans le regard qui est, ou plutôt n’est pas porté sur eux.
Ce que construit la civilisation du judaïsme chercherait-il en vain sa place dans les musées parce qu’il en contrarierait l’esprit?
Marquons une pause avec notre lecteur qui se demanderait quel rapport auraient ces consi- dérations avec l’art d’Alain Kleinmann?
La dérive de notre réflexion s’est prise à traverser le paysage culturel historique dans lequel s’est formée la connaissance que nous faisons avec cet artiste et son art. Elle est donc marquée de notre propre histoire avec ce siècle et avec l’histoire, de la découverte de l’art que manifeste et signe Alain Kleinmann, ce qu’il fabrique, autant que de l’histoire dont il est le fils.
Le peintre, par son art – le travail psychique, culturel qu’il poursuit et condense à sa manière, à quoi mène son œuvre à qui veut bien le suivre, la voie qu’il fraie avec quelques autres17 –, est déterminé par une volonté, un style propres; il est affecté par son histoire et par son temps (ses généalogies, les mémoires de ses familles, et les cultures et les sociétés qu’il côtoie et dont il provient, qui ont contribué à celui qu’il devient), autant qu’il les fait advenir en inventant des formes nouvelles, inédites, en ajoutant d’œuvre en œuvre, sa toile, son texte à l’édifice invisible.
Un des départs de la création artistique d’Alain Kleinmann est le face-à-face intérieur avec les exils et disparitions auxquels les siens ont été confrontés, ont survécu, ou succombé :
Un cadeau de ma mère
«J’ai 48 ans et mon troisième enfant, Hanna, vient de naître. L’autre soir, ma mère sonne à ma porte et me dit avec sa modestie habituelle : “J’ai un petit cadeau pour toi.” Je regarde ce qu’il y a dans le banal sachet en plastique Monoprix qu’elle me tend. À mesure que j’en découvre les objets insolites, elle me dit : “C’est le sac de Téphilines de ton arrière-grand-père, le Talit du frère de ta grand-mère et le petit journal que je tenais quand tu étais bébé”, et par pudeur elle me parle vite d’autres choses. Quand nous nous quittons quelques minutes plus tard, je me précipite sur le contenu du sac, compre- nant les trésors d’affects, d’histoire et d’amour dont elle vient de me combler.
Je lis simplement à la date du vendredi 4 décembre 1953 de son journal, la phrase suivante : “Mon petit Alain chéri, je souhaite de tout mon cœur que nous ne soyons jamais séparés contre notre volonté…” et je comprends soudain que je ne suis né que huit ans après la guerre18… »
Le silence de mon père
« Mon père parle très peu, et d’une certaine manière, je suis constamment à la recherche de son histoire. Or cette histoire, je la lis dans le visuel, pas dans le mot, c’est-à-dire que c’est dans le regard de mon père que je comprends ce qui a pu se passer pour sa famille, pour lui […]19. »
Les vieilles photos
«Il est probable que le besoin que j’éprouve de travailler sur d’anciennes photos de famille provienne du fait que ma propre famille, ayant dû fuir plusieurs pays d’Europe centrale, n’ait pu conserver que de très rares photos. Je me suis comme senti obligé de repeupler ces albums que je n’avais jamais eus et de remplir les vides de façon imaginaire20. »
Un face-à-face confrontant la volonté de vivre avec les puissances de l’effacement.
Ainsi peut-être sa parole de peinture est-elle particulièrement évocatrice dans ces peuples, ou ces humanités dépeuplées pour lesquelles des guerres, des régimes totalitaires, des effets d’une modernité déshumanisante, ont lacéré les tissus des transmissions et désagrégé les liens des familles et des sociétés et des nations. Renvoyons par exemple aux reflets lisibles dans son cata- logue des rencontres et échanges dont et auxquels son ouvrage participe : l’Orient de la Chine, les scènes cubaines…
Nous y lisons le signe d’un goût pour un certain universel : qui permet que chacun y entende quelque chose, et que s’en suscite, favorise, ensemence le filage, le tissage, le récit d’épisodes ou lignes de sa propre histoire. Ce n’est pas seulement une affaire de compréhension : ce qui m’est donné à voir, à lire, à entendre engendre ou rencontre une parole en moi, mienne et inattendue, parfois dérangeante, troublante ; parole elle-même appelée à entrer en travail jusqu’à savoir trouver sa forme et se dire à tel ou tel avec la même vertu : transmettre sa vie de parole qui va son chemin, d’histoire en histoire, de personne en personne, de génération en génération, de peuple en peuple.
De notre détour par l’absence de représentant du judaïsme dans la Galerie du temps, nous revenons avec l’observation d’un effacement de son art dans la représentation de l’histoire qu’il m’est difficile de ne pas relier aux différentes entreprises d’effacement du judaïsme vivant à travers l’histoire… Et de considérer, à bien regarder comme s’opèrent les effacements dans l’humanité, entre les peuples ou entre les personnes, que cette opération ne concernerait pas seulement le judaïsme : il y aurait lieu d’y apercevoir un combat, un affrontement, qui a lieu à l’intérieur du judaïsme même, tout au long de ses engendrements, de ses générations, comme il a lieu dans l’humanité entière : le combat que, pour reprendre des termes freudiens, nous nommerions celui de la vie, de la création, face à la mort, comme haine destructrice.
Pour m’exprimer autrement : Ne pas mener ce combat revient à laisser faire les forces de destruction, qui expulsent du temps et de l’histoire une existence (celle d’une personne, celle d’un peuple) soit en l’anéantissant, soit en le figeant dans une forme fixe, sépulcrale, par une technique de maîtrise ; et c’est au fond se laisser engloutir comme être vivant, capable d’histoire, se soumettre à cet arrêt.
Un autre détour par les pierres évoquées dans la citation mise en exergue de notre texte éclairera ce point.
Au moment de préparer l’intervention que ce texte prolonge, il m’est arrivé de visiter les mégalithes visibles en terres bretonnes, et j’y ai vu une des origines de la production artistique : la confection, l’édification de monuments funéraires, connexe avec le culte des morts et des dieux. On y voit ce qui reste d’édifices qui initialement sans doute avaient vocation de protéger la dépouille du défunt, et de conserver son souvenir en un endroit.
J’en suis reparti avec l’idée qu’il y avait un art à vocation monumentale, fabrique d’ouvrages immobiles dans le temps – c’est-à-dire au fond, soustraits à l’histoire, ressortissant davantage de l’empire des morts que du peuple des vivants; le caractère de ce qui est mort étant d’une part que plus aucune nouveauté ne peut en advenir, il est l’ordre du même sans altérité ni altération, d’autre part, il ne parle plus. Le vivant de son côté se distingue par la possibilité d’une parole, d’un changement, d’une transformation, d’une innovation et d’une transmission.
Abraham Joshua Heschel, dans Les Bâtisseurs du temps21, décrit un rapport juif aux objets, à l’espace et au temps indiquant combien il met en œuvre un art vivant, aux antipodes de l’art monumental :
«La plupart d’entre nous succombent au pouvoir magnétique des choses et n’évaluent les évènements qu’en fonction de leurs conséquences tangibles. Nous reconnaissons la valeur des objets qui se présentent à nous dans le royaume de l’Espace. Mais c’est dans le domaine du temps, et non dans celui de l’espace, que nous pouvons trouver ce qui est authentiquement précieux. Les monuments de bronze ne vivent que grâce à la mémoire de ceux qui contemplent leurs formes, alors que les “instants” de l’âme durent encore après avoir été relégués à l’arrière-plan de l’esprit. Nos sentiments, nos pensées, sont notre bien propre; les objets que nous possédons nous sont étrangers, souvent même trompeurs. Être est plus essentiel qu’avoir. Nous sommes confrontés avec les objets, mais nous ne vivons qu’en acte22.»
Ce livre cité d’Abraham Heschel peut être lu comme un tombeau à la mémoire du Juif d’Europe orientale, assassiné par l’entreprise hitlérienne : un tombeau vivant, bâti non de pierres, ou de caractères imprimés, mais en paroles, pour vivre, par-delà les douleurs, malgré l’horreur de la disparition des siens, et donner à penser, à imaginer, à désirer aux lecteurs des temps à venir, et rendre vivant à nouveau ce que l’on a pleuré. Raconter ce passé comme en attente que ce qu’il recueille de vie soit poursuivi, repris et continué plus loin.
En tout point ce souvenir pour vivre et se réjouir de vivre correspond au projet que décrit l’œuvre d’Alain Kleinmann : l’art d’écrire ou de peindre est une parole, qui permet de vivre, revivre, aller vivre les vies de ceux qui sont visés par l’effacement.
Il n’est qu’à lire les petits textes qui viennent, dans la suite de celui cité d’Abraham Heschel :
La peinture et le temps
«Le temps est naturellement inscrit dans de nombreux aspects de la peinture : le temps de fabrication d’un tableau, le temps dans lequel la toile est plongée et vieillit, le temps représenté dans la toile, le temps que met un spectateur à regarder la toile. Or curieusement, on oblitère souvent cette dimension en ne considérant une toile que dans son rapport à l’espace23. »
La trace
« La trace m’a toujours semblé plus parlante que l’écrit, le murmure plus dense que le cri, l’érosion plus émouvante que la pierre, la cicatrice plus violente que la plaie. Il manque simplement aux seconds le temps… J’aime qu’un texte soit une trace illisible plutôt qu’un slogan. J’aime qu’une lettre soit une intention plutôt qu’une narration, qu’une carte géographique soit une sensation de parcours plutôt qu’un relevé topographique. C’est avec cette sensibilité que je fabrique la matière de mes toiles24. »
Les fruits de la mémoire
«Travailler sur la mémoire est un acte de projection vers le futur et non une nostalgie passéiste […]25. » Un danger face à la disparition et les traumatismes qui s’y attachent, les angoisses qui s’en développent, n’est-il pas de se saisir de ce qui reste de l’autre qui n’est plus et de s’y accro- cher comme ce qui va remplacer la présence qui n’est plus perceptible, et de s’en saturer les sens – dans l’espoir de ne plus sentir l’absence ?
Pour ne pas sombrer, défait de sa propre subjectivité, dans le ravissement du néant, il faut d’abord écouter ce que les traces, les objets trouvés appellent en moi, ou de moi.
« Quelquefois notre chemin croise celui d’un objet abandonné aux hasards d’un marché aux puces, d’une brocante et on se sent soudain envahi d’une violente émotion comme s’il attendait désespérément une attention pour raconter son histoire ou la prolonger. Ne pas le recueillir, ne pas le soustraire à son destin de tragique déchéance semblerait une coupable indifférence, une lâcheté, comme vis-à-vis de ces animaux errants dont les regards accablés de douleur et d’espoir nous font trop souvent baisser les yeux. Ces objets de décharge paraissent précisément refuser de se «décharger» de leurs vies, de leurs affects, de leurs sens et on peut presque avoir le sentiment qu’ils nous désignent alors personnellement comme leur récipiendaire. Au rythme de mes promenades, mon atelier s’est empli depuis plusieurs années de landaus, de montres, de valises, de souliers, de clefs, de tampons, de photos, de livres, de lunettes, d’outils ou de machines à coudre. Chacun de ces éléments a été pour moi une véritable rencontre. En d’autres lieux, les amas triés d’objets personnels ont été une telle blessure qu’il me fallait impérativement tenter de leur redonner une place ou une fonction. C’est ainsi que ce travail a commencé26… »
Ce regard (il faut entendre ici un regard qui écoute et qui parle) porté vers l’objet, comme pour attraper le sien, et le regarder et se laisser regarder par lui, afin qu’une rencontre ait lieu, avec lui et toutes les histoires qu’il porte en lui, fait penser à la scène de la relation telle que Martin Buber la caractérise27 : entrer en présence, en interlocution avec chacun de ces objets.
Quand avec ces objets recueillis Alain Kleinmann fabrique ses images, il continue avec eux dans le mouvement qu’ils ont imprimé en lui : il ne les arrête pas dans le cadre, mais leur donne une forme d’histoire : voilà qu’ils deviennent matière de temps, se composent, se superposent, se portent les uns les autres, forment de nouvelles histoires, qui elles-mêmes, grâce à leur inachèvement, en susciteront à nouveau chez les visiteurs des tableaux. Le catalogue cité donne plusieurs exemples des variations-interprétations à l’infini de ces images : notamment leurs projections sur les murs, ou dans la scène de théâtre, avec les acteurs qui portent et interprètent les images.
Faire de ces objets témoins des puissances de souvenir, leur rendre un avenir, une force de rêve : voilà le travail psychique pour l’artiste, pour le visiteur, pour la société…
Car par cette transformation, riche du mouvement subjectif de l’artiste, ce n’est pas seule- ment lui qui transforme, se transforme, élabore et s’élabore, c’est encore à la société qu’il remet une histoire quand elle ne pouvait, ne savait plus y accéder, ou que certaines de ses composantes ont voulu s’en débarrasser.
Dans cette perspective, restituer une histoire, c’est rendre un avenir : ressusciter un passé perdu, désaffecté, c’est rendre une mort et une vie à ceux à qui on les a volées, mais aussi res- taurer pour qui saura y faire place, au rang des personnes, ou des sociétés, la capacité de rêver, se souvenir, s’inventer, oublier, se rappeler, revenir à soi, etc.
La mémoire des objets
«Tout a une mémoire. Il y a quelques années, je travaillais surtout sur des représentations humaines. Je me suis rendu compte que des objets ou des lieux pouvaient porter autant d’histoire, d’intensité émo- tionnelle, d’humanité que des regards. Ils ont leurs propres souvenirs. Une façade d’immeuble devient le témoin de toutes les histoires qui se sont déroulées devant elle, un fauteuil vide garde la trace de celui qui avait l’habitude de l’occuper, les valises gardent la mémoire de leurs contenus et de leurs errances. Les choses abandonnées conservent la persistance des présences antérieures comme un silence musical conserve la présence des dernières notes jouées28.»
Les livres, ouverts, en tas, de dos, de tranche, fermés, en pages volantes (au sens propre dans les installations), les livres sont partout dans les peintures d’Alain Kleinmann : je les vois ainsi présents pour leur valeur poétique, pour ce qu’ils évoquent, racontent, mais aussi parce qu’ils sont emblématiques du travail du temps replié dans l’espace – et des yeux qui les ont scrutés, des mains qui les ont feuilletés, des valises qui les ont portés; ils symbolisent ces milliers de créations que chacun d’eux contient pourvu qu’il se trouve un homme pour les rendre vivants à nouveau en lui ; trait essentiel de la civilisation juive, le livre ne vaut pas pour lui-même (il n’est pas un fétiche), il ne contient pas le vrai, mais il est trace de parole, à suivre pour en retrouver le chemin, et la poursuivre, c’est-à-dire aussi trace de parole à venir.
Les Tables des dix paroles furent brisées, les paroles dont on y lisait la trace n’en furent pas atteintes29 ; que le livre soit brûlé n’empêchera pas, au contraire, sa fin d’être recherchée : que les paroles vivent et que leur vie se transmette : que les paroles engendrent d’autres paroles30.
Volume
« Souvent un livre est appelé volume, comme s’il était prédestiné à la sculpture ou comme s’il accaparait l’espace, même l’espace sonore : bouquin s’entend comme boucan. Certaines langues confondent les lettres B et V, le libre et le livre; alors que ce dernier est relié. Même les petits livres contiennent des traces de sang : on les appelle plaquettes. L’écrit / Les cris31.»
Le parallèle entre la sculpture et le livre laisse entrevoir une interprétation d’un art qui res- pecterait l’interdit de l’idolâtrie : le volume qu’est le livre est bien une représentation en plu- sieurs dimensions (pas seulement les trois de l’espace, mais aussi intégrant le temps, la présence et la relation, et d’autres peut-être encore) qui résiste à l’idolâtrie ; il ne s’appartient pas ; il n’est pas l’œuvre en soi; et si la prohibition des représentations concerne les formes sculptées, et les images de ce qui est créé32, il y a là peut-être la perspective d’images inachevées, d’images vivantes, poursuivant la création, en appelant d’autres, pour se conjuguer, se multiplier, peupler le temps, des images qui gardent ouverts toujours leur dessein d’expression/impression, comme leur respiration (et non point un destin de surtout faire impression), des images parlantes – qui appellent celui qui les voit autant que celui qui les a dessinées33 ?
Ce ne sont pas les images dont il faut se garder, c’est de les adorer. C’est se faire des images pour arrêter le temps qui passe, nier la mort, qui est morbide.
Les images vivantes sont ce qu’elles deviendront; ou plutôt, faudrait-il dire : elles devien- dront : elles ne sont pas, mais seront et auront été? Elles nous attendent toujours un peu plus loin que ce que nous voyons d’elles ; d’où cet air d’inachevé, d’heureusement inachevé, laissant sa place au visiteur, à sa remembrance ou bien à sa divagation…
Pour ce faire, il faut du temps et de l’espace : et s’arrêter et se tourner vers l’image, l’écouter, parler avec elle, l’oublier, y revenir, à l’écart du vacarme (le boucan) que font la réalité et le criblage d’images (visuelles, acoustiques…) qui aisément nous sature, aveugle, stérilise : qui ne perçoit aujourd’hui combien le foisonnement assourdissant des images, porté par les technolo- gies du virtuel, nous fascine et nous fait croire, et nous coupe de la présence, de la présence à, de l’être en présence de l’autre, c’est-à-dire de toute la dimension relationnelle, affective34 ?
La mémoire visuelle
«Je me demande quelle peut être la plaque photographique dans le cerveau qui conserverait la trace d’un évènement et de tous les signes qui viendraient l’emprunter et l’empreindre. Quand on se souvient d’une personne ou d’un lieu, il ne nous vient que des bribes, des phrases, des lettres, un regard, une voix, un geste, une musique, une étoffe et puis des impressions floues, des vides, des connexions que nous ne savons plus établir… Je ne peins que des traces de présence. Je sais aussi qu’il y a un coin de ma mémoire où les toiles que je n’ai pas encore faites sont déjà effacées. Comme pour les toiles, l’étoile morte continue de nous envoyer sa lumière35. »
Lorsqu’il fabrique, façonne, sculpte, peint, imprime, modèle, combine les images à partir de matières très diverses (dont tous les instruments et matériaux du peintre, et des photographies, des dessins, des décorations, et tous les «objets de décharge»…), en strates, en agrégats, en mélanges… Alain Kleinmann forme une représentation du passage du temps – qui ôte aux images leur exactitude, leur immobilité, et les rapproche du souvenir et du rêve, de cette zone de la vie psychique où l’on rencontre des images en formation – c’est un travail du temps et de la présence qui s’opère sur l’image elle-même, mais aussi dans l’imagination du visiteur des images; du visiteur ou de leur interlocuteur pourrait-on dire.
Plages de mémoire
«Quand la marée se retire, elle laisse sur les plages des résidus d’éléments qu’elle a charriés, dans un ordre à la fois fixe et aléatoire. Elle crée alors un mystérieux paysage fait de traces allusives et com- plexes à déchiffrer. Dans la mémoire, le temps semble prendre le rôle de la mer. Il efface, balaye et recompose des bribes de souvenirs épars, à réorganiser entre réel et imaginaire36… »
Traduit dans l’apparence de l’image et dans son fond, puisque cette image est mue, comme appelée sans cesse à vivre, cet ouvrage du temps est aussi intimé dans l’âme de celui qui regarde, invité à se souvenir, à rêver lui aussi, à retrouver ou découvrir le chemin d’une réalité irreprésentable.
Dans son intérêt ou sa sensibilité pour les objets, Alain Kleinmann porte son attention vers chacun d’eux ; il s’y rend présent, regarde, écoute – ce que chacun montre, cèle, cache, raconte, fait sentir, imagine! – Le peintre s’entretient avec l’objet, mais plus que l’objet : avec cette existence individuelle unique, historique37 ; de même il tend vers la fabrication de toiles vivantes de leur propre individualité (chacune dotée de sa propre mémoire, de filiations, entrant en relation avec d’autres…) :
Les bonnes toiles
« Les “bonnes toiles” sont toujours des toiles dans lesquelles il s’est produit un accident inattendu, qu’on reconnaît puis qu’on laisse s’exprimer, et qui les mène en un lieu un peu plus haut que ce qu’on savait faire jusque-là. Après seulement, on peut analyser ce qui s’est passé pour tenter de le maîtriser pour les toiles suivantes. J’ai parfois l’impression que chaque toile a une vie propre et qu’il faut savoir la laisser un peu respirer seule38.»
Et puis il y a un autre axe : après l’ouvrage du temps dans chaque toile, dans chaque image qui la compose, il y a encore celui qui s’opère de toile en toile, et fait la vie de l’œuvre ; le travail de la toile sur le peintre; celui qu’elle lui permet d’effectuer, le transport qu’elle lui favorise ou pourvoit, et celui qu’il effectue de spirale en spirale, vivant cheminant.
De même qu’après tout une époque de rassemblement des objets qui l’appelaient, s’est imposé à lui de les transformer en images, de les imaginer avec ses mains39 (c’est vrai aussi dans l’autre sens : la peinture imagine lentement son peintre, elle le façonne), de même Alain Kleinmann franchit, plus loin dans sa vie une autre étape :
« Durant ces dernières années, je ne me suis presque exclusivement intéressé dans mon travail qu’aux teintes sépia, brunes, ocre, pain d’épice ou mordorées. Je n’ai jamais été un grand par- tisan des explications symboliques ou littéraires autour de la peinture (pour un peintre, un « marron terre de Sienne » est avant tout un « marron terre de Sienne »), mais il faut reconnaître que toutes ces patines aux couleurs des vieilles photos jaunies et du temps correspondaient assez bien à cet espoir que j’avais de faire ressurgir des images enfouies dans le passé et la mémoire.»
« Ce n’est que très récemment que j’ai curieusement ressenti un violent besoin de noyer toute cette démarche dans du blanc, jusqu’au désir de ne plus peindre que blanc sur blanc, d’en effacer radicalement toute trace. Le vrai paradoxe était que je souhaitais les en effacer, oui mais en conservant pourtant impérativement leur présence… Ces toiles sont les fruits (sûrement mûris d’incertitudes) de ces interrogations. Comme si inéluctablement l’oubli, un jour, devait effacer la mémoire… les traces sur les murs, sur les sols, dans les souvenirs, meurent toutes peu à peu… Elles libèrent de nouveaux espaces vierges pleins de promesses, mais elles portent en même temps toujours l’absence de tout ce qu’il a fallu oublier pour cela… 40 »
Ainsi est-il donné à sentir, voir, comme jamais je ne l’ai perçu, ce que l’oubli peut ici être un moment de la mémoire, une construction vivante, vitale : car il faut pouvoir oublier pour faire place à de nouvelles étapes de la vie ; mais c’est ici un oubli qui se sait, qui se fait ; un oubli avec le souvenir; non pas un oubli par défaut – qui s’apparenterait alors à un procès d’anéantissement.
La toile-grenier
« Comme ces petites boîtes des greniers qui contiennent pêle-mêle la photo d’une arrière-grand-mère, quelques-unes de ses lettres, un morceau de dentelle de sa robe de mariée, des cartes, des souvenirs, des passementeries qu’elle aurait gardées, autant de petits morceaux épars qui restent d’une vie et qui forment les dernières allusions auxquelles peut s’accrocher la mémoire, j’essaie que mes toiles portent déjà cette histoire avant même de commencer à peindre41.»
«Mémoire, transmission, création/art, psychanalyse, pensée juive»; nous arrivons au terme de ce tour avec et à la rencontre de l’œuvre d’Alain Kleinmann.
En amont de cette réflexion, je m’étais étonné de l’absence du judaïsme dans un musée français présentant une histoire de la création humaine (de l’Europe à l’Inde en passant par l’Égypte, de l’invention de l’écriture à la révolution industrielle), absence qui ignorait de fait la qualité et quantité des productions culturelles (arts, pensée, littérature, etc.) et contributions à la vie de l’humanité dues au judaïsme, et sa persistance, sa vitalité à travers les millénaires et jusqu’à aujourd’hui.
Partis de cette interrogation, nous avons considéré les facteurs qui éclaireraient cette absence. Notre réflexion en aura dégagé deux : l’hostilité à l’égard du peuple juif et de la civilisation appelée judaïsme, qui a conduit à des censures et des destructions de ses membres et de leurs œuvres; et les rapports que le judaïsme entretient avec l’art, rapport structuré par l’interdit de l’idolâtrie et par la défense qui lui est attachée de fabriquer des images de tout ce qui est sur terre et dans le ciel.
Nous avons vu que la prohibition de la fabrication de représentations d’éléments de la réalité ne suffisait pas à expliquer cette absence.
En revanche chacun peut observer que l’interdit de l’idolâtrie ne laisse pas indifférent et engendre fréquemment des réactions telle la volonté (ou l’impulsion) de l’écarter, de l’ignorer, ou de le faire taire – réactions gagnant parfois le registre de la violence, et même de la furie d’anéantissement. Notre siècle nous en a donné trop d’exemples.
La mise en œuvre de cet interdit a été une difficulté récurrente dans la construction du judaïsme (l’épisode du Veau d’or en étant la plus connue) ; elle est sans doute toujours d’actua- lité, puisqu’instaurer, tenir, respecter, transmettre cet interdit ne peut être acquis, et demande le même travail tout au long de la vie, pour chaque personne, pour chaque génération; par conséquent, il est certain que cette difficulté n’est pas le propre du judaïsme : toute personne ou société s’en aperçoit aisément, pour peu qu’elle décide de s’affranchir de la fascination des images (c’est-à-dire ce qui fait croire à la présence par-delà l’absence ou la disparition) et de la sensation de puissance voire l’ivresse que peuvent procurer leur création (ceux qui travaillent dans les organes médiatiques pourraient en savoir quelque chose, eux qui, en fabriquant les images composant les actualités, éditent des réalités, y font croire, et influencent le cours et la teneur des évènements, des pensées et des sentiments dans la société).
Accepter cet interdit, et, davantage, le choisir, suppose force renoncement et contrarie le besoin de croire et les satisfactions que procure la croyance; c’est choisir une voie ardue, mais aussi sans doute est-ce le seul accès à une vie libre et responsable. Ce choix relève d’une conquête, d’un combat inhérent à la vie humaine.
Notons l’existence, dans l’interdit de l’idolâtrie, d’un nœud entre le besoin de croire et celui de voir, sentir ; il faudrait même sans doute dire davantage que « besoin » ; poussée ? envie impé- rieuse ? Ce point sera très intéressant à développer – en une autre occasion.
Est-ce parce qu’il conduit à un affrontement de l’angoisse que l’interdit de l’idolâtrie soulève des agissements qui veulent l’annuler? N’est-ce pas lui aussi qui est un facteur d’élévation, un principe qui conduit l’homme à se dépasser pour vivre en société ?
Seule la puissance de l’idolâtrie (le culte d’une image solidifiée, édifiée à l’endroit de mani- festation de la finitude, de la mort, pour ne plus la voir, ne plus être blessé, limité ?) et du conflit qui se produit si on s’oppose à elle nous semble pouvoir expliquer la puissance, inépuisable, de l’entreprise d’effacement qui vise le judaïsme et s’exerce sur lui, ses œuvres et son peuple.
Nous voyons bien que ces propositions cherchent des appuis plus solides que l’impression de vraisemblance qu’elles nous produisent.
Il nous faudra remettre à plus tard cette tâche d’argumentation.
Puisses-tu lecteur avoir, malgré ces insuffisances, glané grain à moudre? Et peut-être trou- veras-tu les étayages que je n’ai pas établis, ou des objections intéressantes pour l’élucidation de ces questions?
Le temps passé à réfléchir ces forces d’effacement nous aura permis de dessiner le contexte de manifestation de l’art d’Alain Kleinmann devant elles et tenant bon l’interdit de l’idolâtrie – avec des images faites de mots, des images parlantes, équivoques, poétiques.
Nos développements ensuite dans la compagnie de ses œuvres picturales et écrits nous ont fait découvrir un artiste fabriquant des images pour vivre malgré ou avec la mort et la destruction (en composant avec elles mais en ne s’y soumettant pas), en refusant la facilité de l’idolâtrie mélancolique, en retrouvant et donnant trace des présences sauvées de l’effacement pour réparer et nourrir l’histoire traumatisée, défigurée des personnes et des peuples.
Le musée fait apparaître une certaine sélection d’œuvres témoignant des civilisations; notam- ment des civilisations qui ont rendu des cultes aux images.
La fabrique de l’image chez Alain Kleinmann se démarque de cela.
Elle est un travail de mémoire vivante qui ne voue pas de culte au passé, mais recherche les traces des présences.
C’est peut-être ce trait propre de l’art juif qui fait qu’on ne lui a pas trouvé de place dans un univers organisé par une démarche qui collectionne les objets depuis plus de deux siècles, et les sacralise, et qui s’intéresse moins au temps et à la vie qu’aux formes visibles, arrêtées hors de l’histoire vivante – au point de s’assujettir les œuvres comme des objets (voir ce que nous a appris la lecture d’Abraham Heschel).
Nous n’avons pas parlé explicitement de psychanalyse; pourtant celle-ci aura été présente – tant dans la façon de lire, rencontrer les œuvres, écouter les paroles de l’auteur, que dans l’ou- verture par laquelle nous terminons cette conclusion.
Après ce chemin parcouru, nous pourrions reprendre ce périple, sans doute avec un autre itinéraire, en étant attentifs aux analogies, éclairages, traductions que l’œuvre d’Alain Kleinmann permet à celui pour qui la psychanalyse fait infiniment partie de la vie (comme patient, ancien patient ou comme praticien) de penser et dire autrement et avec une force étonnante des phé- nomènes psychiques, des moments de la cure…
Nous citons quelques exemples que chacun développera à son gré, selon ses expériences et curiosités : une approche des choses qui guette leur regard, qui les perçoit en attente que nous venions à elles entendre ce qu’elles ont à raconter, ce que nous avons à raconter d’elles, avec elles, grâce à elles… ce dont nous pourrons nous souvenir avec elles… et sentir, et percevoir, pour les charger de présence par transfert affectif… apprendre, réapprendre à l’infini à imaginer en rêve, en souvenir malgré les images inanimées, qui se sont tues ou ont été étouffées. La cure est quelquefois, souvent (toujours ?) la réanimation de domaines de la vie psychique gelés, sinis- trés, dévitalisés, peuplés de légions de statues, que le rêve, le possible, l’avenir ont quittés… Fabriquer des séances comme des toiles trouvant chacune et ensemble leur vie propre et leur vie commune, et habitant un atelier/cabinet d’intériorité retrouvée… Sculpter, la matière du temps…
En guise d’envoi au final de cette ouverture, le blanc, le blanc selon Alain Kleinmann, tel qu’un jour de son parcours il l’a découvert : un blanc chargé d’histoire, l’histoire des histoires qu’il recouvre (relire son texte sans titre, cité plus haut et qui parle de cet épisode, mais aussi celui intitulé : « Le livre du blanc », non cité ici), celles que pendant des années il a reconstituées, rouvertes, ranimées, avant que ce blanc ne lui vienne; tout ce temps de se souvenir comme le temps d’une cure à se rappeler, recueillir les traces, sentir les présences perdues, les éprouver, éprouver leur perte, à les appeler de leur nom, et connaître les joies et les douleurs qui s’at- tachent à elles ; et puis rire aussi ou pleurer : les retrouver, et puis les oublier, non plus par défaut, mais par choix : pour écrire vivre dire raconter inventer la suite avec cette histoire intériorisée, vivante, métabolisée dans la toile de ma vie; le passage au blanc pourrait éclairer ce travail de l’analyse au moment où elle se termine et commence encore enfin à l’infini?
Peut-être aussi s’agit-il de tendre ce blanc si épais aux générations venantes ? Assez épais pour qu’il leur soit possible d’écrire dessiner peindre la suite ?
Mes remerciements à Michel Gad Wolkowicz, grâce à qui j’ai rencontré Alain Kleinmann et son œuvre, et ai pu poser ces questions et connaître ces images qui aident à penser, qui aident à vivre vraiment; je me souviens d’une conversation il y a des années sur l’usage, le sens des œuvres d’art comme, me dit-il, ce qui accompagne, de leur présence, la vie : «Elles font partie de ma vie, elles sont là, avec moi. J’ai besoin de sentir leur présence. » Aux antipodes d’un regard révérencieux qui sacre et dramatise l’art et l’artiste dans la fabrique des idoles.
Et puis je me souviens aussi d’une phrase écrite sur le mur d’une exposition de Robert Rauschenberg à Beaubourg à propos de l’art : «It’s a good job!»
Notes
1. Yosef Hayim Yerushalmi : Zakhor. Histoire juive et mémoire juive (traduction de Zakhor, Jewish History and Jewish Memory [1982], par Éric Vigne), Gallimard, Paris, 2008.
2. Alain Kleinmann, in Alain Kleinmann, Somogy, Éditions d’art, Paris, 2014, p. 336 ; les textes cités, manières de poèmes, sont acces- sibles sur le site de l’auteur à la page <https://alainkleinmann.com/ textes-d-alain-kleinmann/>.
3. Ibidem, p. 389.
4. Tout le Louvre-Lens, guide du musée, publication éditée par Beaux- Arts et Cie, 2017 ; p. 1 ; citation de l’« Éditorial » de Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens.
5. Idem, p. 28 ; citation de « Une galerie concept », texte d’Armelle Fémelat.
6. Idem, p. 39. Dans la fresque du temps courant au bas des pages de Tout le Louvre-Lens, aucun savant, penseur juif, aucun ouvrage écrit par un Juif : ce qui est aussi impressionnant que la liste des apports juifs à nos civilisations et langues occidentales…
7. De même, concernant Jérusalem, aucune mention dans ces chrono- logies d’évènements notables d’un temple, ou du lien de la ville avec le judaïsme, quand au contraire le Dôme du rocher, nombre d’édifices chrétiens, gréco-romain, et tant d’évènements y trouvent très naturel- lement place… N’aura-t-il pas existé?
8. Nous nous appuyons ici sur l’article « Art » du Dictionnaire encyclopé- dique du judaïsme (The Encyclopedia of Judaism, publié sous la direction de Geoffrey Wigoder, The Jerusalem Publishing House, Ltd, 1989; adaptation française sous la direction de Sylvie Anne Goldberg, coédi- tion Le Cerf-Robert Laffont, 2008, Paris), p. 89-91.
9. Nous en donnons la traduction d’Henri Meschonnic (in Les Noms. Traduction de l’Exode, Desclée de Brouwer, Paris, 2003, p. 111) :
«Tu ne feras pas pour toi d’idole / ni aucune image // de ce qui est dans le ciel / en haut // et de ce qui est sur la terre / en bas»
«Et de ce qui est dans l’eau / sous la terre». Avec la précision donnée en note pour ce verset : « “idole”, péssel, c’est une forme sculptée repré- sentant une divinité; “image”, temouna, désigne une reproduction.» (Ibidem, p. 280.)
10. Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, op. cit., p. 90.
11. Reprenant un terme apporté par Pierre Legendre, nous parlons ici d’une civilisation, d’une culture, dont la religion chrétienne est un aspect, une formation, et l’impérialisme romain un autre vecteur; ces deux-là s’étant rencontrés cependant que le christianisme se formait en se séparant du judaïsme.
12. Comme le faisait remarquer Gérard Garouste lors d’une confé- rence donnée au séminaire «Délires contemporains?» de Schibboleth
– Actualité de Freud (séance du 14 octobre 2021, accessible sur <schib- boleth.fr>) : régulièrement, sur les peintures religieuses, Jésus est représenté non circoncis.
13. Le Vrai Israël, nouveau peuple de Dieu est censé remplacer l’An- cien (vieux, caduc, périmé, dorénavant faux…); ce que l’on retrouve dans le lexique catholique : Ancien et Nouveau Testament ; et non par
exemple : Premier et Deuxième.
14. Cf. le titre de la séance du séminaire Schibboleth – Actualité de Freud (« Délires contemporains ? ») du 9 juin 2022 : « Juif ? Singulier pluriel ! ».
15. Pour reprendre les termes opposés par Emmanuel Levinas dans son titre : Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, La Haye, 1961. Deux points à développer :
Le catholicisme se veut l’universel (cf. l’étymologie du mot) lorsqu’il promeut une totalité qui exclut par expropriation/appropriation (ou expulsion/dévoration) le judaïsme. Raphaël Draï (dans une conférence publiée sur Akadem.org, passage non retrouvé) cite un propos de Benoît XVI qualifiant Jésus-Christ de véritable Israël : son vrai accomplissement… qui montre combien, jusqu’à aujourd’hui, l’ambition catholique garde une volonté d’annexion du judaïsme via la personne du Christ.
Et renvoyons aux travaux de Jean-Claude Milner qui, grâce à la dis- tinction intensité/extension pour qualifier l’universel, fait apercevoir comment la totalité est son expansion même, aussi essentielle qu’ir- répressible, c’est-à-dire aussi qu’elle est en soi le refus d’une limite, et davantage : elle consisterait dans la négation-destruction de cette dernière; une totalité qui se vit en danger (de disparaître) lorsqu’elle rencontre l’un distinct c’est-à-dire limité – qu’elle reconnaît dans ce nom de Juif qui appelle un choix de la limite (la décision de recevoir la Loi), voie d’accès à un infini propice à la vie d’homme libre et respon- sable, faisant place à chacun.
16. Les Juifs, une tache aveugle dans le récit national, Albin Michel, Paris, 2021; pour ce point, cf. le paragraphe «Judaïsme, tache aveugle, récit national », in « Introduction », p.15. Et, pour le thème que nous trai- tons, renvoyons dans cet ouvrage au texte de Claire Decomps, « La place du judaïsme dans les musées en France», p. 209-222.
On y trouvera d’autres hypothèses pour éclairer cette absence; notam- ment Philippe Joutard évoque le rapport du pouvoir centralisé avec les provinces, dans la catégorie desquelles se retrouverait le judaïsme; nous pourrions inverser la proposition : peut-être serait-ce aussi le rap- port du judaïsme au pouvoir qui gênerait ce dernier; non loin de cette hypothèse on trouve celle qui indique le rapport du pouvoir de l’État au protestantisme et au judaïsme comme particularités contrariant l’unité du récit national et inquiétant la souveraineté.
17. Avec quelques autres : notamment les membres du groupe Mémoires ; sur ce point, cf Alain Kleinmann, op. cit., p. 343 : L’HISTOIRE DE L’ART
« Contrairement aux mythologies présentant la peinture comme le fait d’individus exceptionnels dénués de tout contexte ou référence, j’ai toujours pensé qu’il existait une histoire objective et progressive des formes, au même titre qu’il existe une histoire des sciences. Comme cela se passe pour les laboratoires de physique ou de biologie, il n’est pas rare de voir au même moment à New York, Londres et Paris ger- mer dans des ateliers différents, et qui ne s’étaient pas nécessairement concertés, les mêmes inventions. Comme si des problématiques ou des formes précises étaient dans l’air du temps et que le travail contempo-
rain ne pouvait que s’en saisir (avec des degrés de bonheur évidemment différents). Ce constat ne sert sûrement pas les intérêts de ceux dont le métier est de convaincre de la valeur exceptionnelle de tel ou tel peintre. Quant à moi, j’ai tendance à penser qu’il est plus haut de se situer de façon pertinente dans une chaîne humaine, plutôt que de faire semblant d’être un héroïque cavalier seul.»
18. Ibidem p. 340.
19. Ibidem, p. 386.
20. Ibidem, p. 308.
21. Éditions de Minuit, 1957.
22. Ibidem, p. 7-8. À compléter avec la lecture du passage suivant :
« Nous n’avons pas l’impression de déprécier le monde de l’espace. […]. Le temps et l’espace sont entretissés. Dédaigner l’un c’est être borgne. Ce contre quoi nous nous élevons c’est la reddition inconditionnelle à l’espace, l’esclavage, la soumission totale aux objets. Nous ne devons pas oublier que ce n’est pas l’objet qui donne un sens au moment ; mais c’est le moment qui donne leur signification aux choses. […] «L’hébreu biblique n’a pas d’équivalent au mot “chose”, “objet”. Le mot davar qui, plus tard, servira à traduire “chose”, signifie en hébreu biblique : parole, mot, message, nouvelle, demande, promesses, décision, récit, dicton, affaire, occupation, actions, bonnes actions, évè- nement, façon, manière, raison, cause ; mais jamais “chose” ni “objet” […]». Ibidem, p. 103.
23. Alain Kleinmann, ouv. cit., p. 88.
24. Ibidem, p. 98.
25. Ibidem, p. 84. Cette vision de la mémoire regardant l’avenir, parlant vers lui, participe du même mouvement que l’on retrouve dans la façon dont se présente celui qui pour les Bnei Israël est le Dieu de ses pères : il se nomme : «Je suis que je serai» (cf. Les Noms Traduction de l’Exode, par Henri Meschonnic, ouv. cit., 3, 13 & 14).
26. Ibidem, texte sans titre ; accompagnant une peinture intitulée : « Le livre brûlé»; p. 198.
27. Dans Je et Tu, Aubier, Paris 2012, notamment la rencontre avec l’arbre, qui advient s’il cesse d’être mon objet, mais devient un Tu s’adressant à moi et à qui je m’adresse.
28. Alain Kleinmann, ouv. cit., p. 164.
29. Cf. Abraham Heschel, op. cit. p. 8.
30. Cf. Le livre brûlé, de Marc-Alain Ouaknin, aux éditions Lieu Commun et le Seuil, 1986, 1994, collection Points, Paris ; notamment : « La brisure des Tables n’est pas la destruction de la Loi ; elle est, au contraire, le don de la Loi sous la forme de sa brisure. […] La brisure de la Loi est éminemment positive ; elle signifie le refus de l’idole. Moïse
ne transmet pas d’abord la Loi mais sa cassure ; son impossibilité à être idole, lieu de perfection, “livre total”.» p. 410.
31. Alain Kleinmann, idem, p. 223.
32. Cf. note 9 du présent texte.
33. À l’opposé de ces images, installations et autres performances qui encombrent les temps et espaces réservés à l’art aujourd’hui, et dont la signification est contenue dans la notice les accompagnant; qui ne parlent guère, sauf à l’initié. Une image vivante ne me désigne pas ce que je dois voir; elle me permet de voir plus que ce que son auteur a imaginé… Il lui faut une certaine lisibilité : pour que cela me dise quelque chose.
34. Cf. « Les arrière-petits-neveux de Marcel Duchamp » et le per- sonnage de cette femme, conservatrice de musée, coupée des images, invalide et vide.
35. Alain Kleinmann, op. cit., p. 332.
36. Ibidem, p. 290.
37. Voisin en cela d’une attitude perceptible dans une des interpréta- tions du texte de la Thora, notamment dans le livre Berechit, la Genèse, quant à l’intentionnalité des éléments de la Création eu égard à leur par- ticipation à son projet ; ainsi par exemple lorsqu’il est question (Berechit/ Genèse, 7, 18) des eaux du déluge qui grossirent, «d’elles-mêmes» pré- cise Rachi, comme si, poursuit un commentateur (Ch. Benattar, cité par Élie Munk) elles participaient ardemment à «accomplir à la perfection l’ordre divin»?
Cf. Élie Munk, La voix de la Thora. Commentaire du Pentateuque. La Genèse, édition de l’Association Samuel et Odette Levy, 2007, Paris.
38. Ibidem, p. 343.
39. Note en lisant le commentaire de Rachi (tel que traduit sur le site <sefarim.fr> pour le verset Berechit/Genèse 1, 27 ici donné dans la traduction de Henri Meschonnic, op. cit., p. 30 :
« Et Dieu a créé/l’homme/à son image//à l’image de Dieu/il l’a créé Mâle et femelle il les a créés »
Si, dans la Thora, Dieu crée tout par la parole, «l’homme a été créé si l’on peut dire par Ses mains ». Ainsi selon ce qu’indique Rachi, l’homme porte-t-il la marque, le sceau divin. Cela n’est-il pas inspirant pour évo- quer ce geste du peintre-sculpteur qui lorsqu’il crée, fait exception aux gestes ordinaires, et fait porter à ce qui passe par ses mains, une marque, sa marque, héritage de la marque du Créateur?
40. Alain Kleinmann, op. cit., p. 260 ; texte sans titre accompagnant « Les déchirures de la mémoire I ».
41. Ibidem, p. 330.

Haïm Korsia
Grand rabbin de France, Membre de l’Institut
ALAIN KLEINMANN OU LE PROPHÈTE DU TEMPS.
Alain Kleinmann est un artiste complet car il crée par la peinture, les collages, les sculptures, la combinaison des objets et il raconte le cheminement intellectuel qui est le sien, il porte un regard poétique et lucide, tendre et merveilleux sur le temps jadis qu’il rend présent à chacune de ses œuvres. Il est un pont entre nos rêves de compréhension du monde d’aujourd’hui et ce qu’était l’univers de nos shtetls et de nos rebbés à longue barbe et regard de prophète, il tisse le présent et le passé, la mémoire et la nostalgie, et donc, ce que nous sommes de nos jours.
Le livre est son support, son totem et son fil rouge car c’est ce média qui nous porte vers le passé ou vers le futur puisqu’il est déjà le réceptacle de l’histoire du bois qui le compose avant d’être celui de nos mots. Comme des photos de Roman Vishniac ou de Fréderic Brenner et son Instant d’éternité si lumineux sur Jérusalem, Kleinmann entrelace la présence et l’absence et nous ouvre un espace-temps qui est à lui. A lui seul.
Son histoire épouse les drames de la guerre et de la destruction d’un monde qui ne perdure que dans notre mémoire. Le yiddish qu’il conserve dans certaines de ses œuvres est la langue qui raconte ce monde comme aucune autre, celle qui remonte le temps pour nous installer sur les bancs des yéchivot de Mir ou de Slobodka, des Hakhméï Lublin ou de Poniovitch. Ce sépia qui baigne toutes ses œuvres nous plonge dans une époque où les couleurs se défraichissent parce que nous ne faisons plus l’effort de mémoire qui rendrait à ces scènes la vive clarté de la lumière de la Thora. Et pourtant, nous luttons pour ne pas oublier et Alain Kleinmann nous y aide avec toute la douceur de son art et la force de son engagement à se souvenir pour nous, avec nous.
Toutes ces photos anciennes qui servent de trame à tant d’œuvres d’Alain Kleinmann deviennent un peu les nôtres, nous qui, dans les exils qui ont parcouru nos passés, n’avons pas pu hériter des photos d’antan, de ces marqueurs de l’enchainement des générations. Ces ancêtres deviennent nos patriarches et nos matriarches, nos piliers sur lesquels, collectivement, nous nous construisons. Et peu importe si nous venons de Varsovie ou de Kovno, de Cracovie ou d’Odessa, d’Oran ou de Tlemcen, de Tunis ou de Sfax, de Casa ou de Fès, nos exils nous spolient de nos mémoires et de leurs supports photographiques et, au fond, de notre capacité à revisiter nos souvenirs comme lorsque nous feuilletons nos albums en revivant chaque scène et chaque évènement que fait resurgir devant nous chaque instantané. Alain Kleinmann met en commun ces photos et nous les offre pour reconstruire les réminiscences de ce que nous voulons à toute force faire revivre. Il fonde ainsi notre mémoire collective et c’est sa mission sacrée, son sacerdoce.
Si Pierre Soulage a inventé l’outre-noir qui contient de la lumière au cœur de l’obscurité, Alain Kleinmann a conçu l’outre-mémoire qui parvient à ouvrir sur du bonheur dans la nostalgie de la détresse car c’est déjà une immense victoire d’être là, ici et maintenant, juste pour pouvoir nous souvenir. C’est cette prophétie du passé, comme le font les historiens dont c’est bien la vocation, qui donne son importance au temps qui passe et qui, pourtant, ne passe pas.
Le temps se dit zman en hébreu, comme la racine du mot léazmin, qui est également en lien avec le mot invitation, puisque Dieu nous « invite » à avoir un lien avec lui et le temps. Cette convocation du passé et du futur apparait souvent dans le texte biblique avec différentes tessitures de ce temps partagé entre les hommes et leur Créateur. Il y a le « Temps de notre liberté », (zman hérouténou) pour la fête de Pentecôte, le « Temps de notre joie » (zman simhatenou) pour la fête des Cabanes, et d’autres qui donnent toujours un temps d’avance sur le temps qui est fixé par l’homme avec un calendrier. Mais si nous définissons le temps et si l’homme détient le temps entre ses mains, comme il semble que la Thora en atteste : « les temps de Dieu que vous proclamerez seront des dates saintes… » (Lévitique XXIII, 12), alors nous sommes bien, comme le dit si justement Abraham Heschel, des bâtisseurs du temps.
Ce sont les commandements comme le chabbat, les fêtes, la prière qui ont pour but de fixer le temps dans notre vie car sans eux, les pensées, les raisons et les intentions, les espérances et les doutes de l’homme seraient invisibles et ne laisseraient pas de traces dans ce monde. C’est donc bien l’homme qui sanctifie le temps, mais parce que Dieu le fait avec nous, comme nous le proclamons dans la bénédiction du soir de fête sur le vin : « Tu sanctifies Israël et les temps » (Mekadesh Israel Veazmanim). Ce que Dieu nous propose, c’est que le temps soit au service du peuple d’Israël car il est indissociable du peuple. Ainsi, par exemple, le chabbat est le jour qui symbolise le cycle du temps car ce jour-là, l’homme est capable de faire une coupure avec le reste du monde, avec le reste de la semaine, avec sa propre vie et, plus largement, avec la vitesse habituelle de défilement du temps. Le temps du chabbat est unique car il est mien et je n’en suis plus prisonnier. C’est un moment pour se ressourcer et, en quelque sorte, pour recharger nos batteries ! Cette façon de faire un arrêt qui permet de se recentrer sur nos actions est le cœur de l’ordre divin de travailler six jours et de cesser le septième. Le peuple juif vit avec le temps et dépend du temps qui passe tout comme le temps dépend de nous.
Notre calendrier est lunaire, ou plus exactement, luno-solaire, et donc, nos mois durent entre 29 et 30 jours, c’est-à-dire que c’est ce délai qu’utilise la lune pour passer d’un état à un autre, de naissante à pleine, puis à discrète puis à renaissante. Ainsi, l’homme passe d’un état à un autre dans les moments de repentir et de prières, de l’angoisse de la faute à la renaissance de la téchouva, sans que le temps ne le rattrape et l’enferme dans son passé dépassé.
La prophétie qui se dit névoua en hébreu, vient de la racine niv qui signifie parole, langage or, la parole et le langage s’acquièrent avec le temps, qui, peu à peu, nous ancre dans notre capacité à comprendre et à nous faire comprendre, à entendre et à dire, à rêver et à inventer, à prophétiser et à penser avec les mots de l’esprit et du cœur.
Mais le prophète, le Navi, reçoit les paroles divines pour les transmettre au monde et se voit dicter ses actes par l’Éternel. Et même lorsqu’il refuse sa mission, tel Jonas le rebelle, tel Moïse le modeste qui se prétend « lourd de bouche et lourd de langue » ou Jérémie le découragé qui s’excuse par avance « Je ne sais pas parler et je suis trop jeune, un enfant », le prophète est rappelé, dans le temps, à sa mission car il est celui qui dit Hinéni.
Hinéni se traduit en hébreu par « me voici ». C’est Dieu qui le premier dans la Bible dit Hinéni, car Il est toujours présent pour nous. C’est le même mot qu’utilisent donc les prophètes pour répondent à Dieu lorsqu’Il les interpelle. Ces femmes et ces hommes qui doivent brusquement tout abandonner, tout quitter pour répondre à un appel, disent simplement à Dieu “Hinéni“. Ils signifient par là qu’ils sont présents pour Dieu, présents pour porter Sa parole, présents afin d’être au service des autres dans le temps que le Créateur leur offre.
Abraham, Jacob, Joseph, Isaïe, Samuel, David… ont tous affirmé Hinéni, mais chacun à sa façon car il y a autant de sens à cet engagement que de prophètes et de patriarches ou de matriarches. Comme aujourd’hui, il y a autant de façon de s’engager au service des autres que de personnes. Tous s’engagent pour leurs enfants, pour la jeunesse, pour le futur, pour donner vie à des moments de bonheur et de partage, pour donner du temps et de l’espérance au monde.
Dire Hinéni, c’est oser faire un pas en avant, non pas pour être sous les projecteurs mais pour être responsable des autres, ce que sont les prophètes. Hinéni, c’est ce que fait Nah’chon Ben Aminadav lorsqu’il avance dans la mer Rouge, la forçant à s’ouvrir. Porter en soi ce viatique, c’est trouver la juste réponse à la question que pose l’Éternel à Caïn : « Où est ton frère ? » Alors que le meurtrier s’exonère de toute responsabilité par son fameux : “Suis-je le gardien de mon frère ?“, Hinéni est une façon d’être un frère pour l’étranger, un gardien pour le faible, un pilier pour celui qui chancèle.
Affirmer Hinéni, c’est permettre aux autres de s’investir à leur tour, de suivre l’exemple des prophètes, ces vigies du futur, ces veilleurs de la nuit, dans un véritable geste d’amour. Lorsque Dieu scelle son alliance avec Aaron, le premier des Cohanim, les prêtres qui nous bénissent, Il utilise ce même mot: “Hinéni noten lo ète bériti chalom“, Me voici à lui donner mon alliance de paix. S’engager, c’est donc pacifier la société en la décloisonnant et en la rendant solidaire et donc juste. C’est ce temps pour la paix annoncé par l’Ecclésiaste (III, 8), qui arrive toujours après la guerre, car la paix l’emporte toujours.
Hinéni c’est être, non plus un consommateur de ce que d’autres produisent, mais un bâtisseur, un créateur de lien et de sens.
Hinéni, c’est s’investir pour les autres, et peut être, tout simplement, Hinéni c’est être juif.
Or les prophètes sont profondément juifs, c’est-à-dire qu’ils suivent toujours la Thora et portent une morale fidèle aux préceptes divins. Et c’est peut-être ce qu’est Alain Kleinmann, car je suis convaincu que les artistes sont les prophètes de notre époque, eux qui perçoivent et savent retranscrire les vibrations du temps, de l’époque et de notre monde. Et l’art est aussi un avertissement, tel un Guernica de chaque jour, où l’œuvre vient percuter nos indolences et nos lâchetés, nos oublies et nos couardises.
Et si le souffle de la prophétie s’est tarit avec les derniers Hagiographes, ce sont les maîtres, les fous et les artistes qui ont repris le flambeau pour nous rappeler à nos devoirs. C’est la conduite de toute la société que la prophétie vise à améliorer et c’est cette leçon de mémoire que nous administre Alain Kleinmann, car son œuvre est intemporelle or, pour la définition du Canon biblique, il n’y avait que deux critères : Miyad véladorot, maintenant et pour les générations suivantes. C’est-à-dire que les textes prophétiques doivent s’adresser à leur époque et à tous les temps de l’histoire du monde. C’est très précisément le cas pour ce que partage Alain Kleinmann dont personne ne peut dater l’œuvre, comme si elle était un fac-similé de la vie d’avant, d’avant le cataclysme, d’avant que l’homme ne soit plus humain.
Je reviens sur Jonas et j’ai trouvé incroyable qu’il puisse annoncer que Ninive serait détruite, ce qu’elle n’a pas été. Jusqu’au tournant de l’an 2015 ou Mossoul, la Ninive biblique, fut détruite par les ennemis de l’humanité. Le temps n’a pas prise sur la prophétie et rien n’empêche l’Éternel de faire ce qu’Il dit, à Son échelle temporelle.
Et puisque la prophétie est intemporelle, car elle s’applique dans le présent, dans le passé ou dans le futur, et qu’elle s’étend à toutes les générations et toutes les époques, nous en sommes les acteurs. Tout comme pour l’œuvre d’Alain Kleinmann où en partageant sa pensée et son espérance, nous agissons pour faire reculer l’oubli et l’absence.
Au fond, dans la cavalcade de l’histoire du monde, la prophétie apaise et donne l’espoir suffisant pour ne jamais abandonner, pour persévérer dans le temps, pour inventer cette résilience qui marque le monde comme le symbole du judaïsme.
Le temps est la force du peuple, ce temps qu’Alain Kleinmann nous propose de condenser pour le replier comme un origami et passer d’aujourd’hui à hier et malgré tout, continuer à espérer en Dieu et en l’Homme.

Sandrine Szwarc
ALAIN KLEINMANN, AMI ET ARTISTE DE L’ ÉMOTION
Une fois n’est pas coutume, les politesses d’usage et la troisième personne de courtoisie seront délaissées pour rendre hommage à mon ami cher, Alain Kleinmann. Son amitié depuis notre première rencontre, lors d’un colloque organisé à la Sorbonne dont il ne se rappelle pas, s’avère précieuse. Notamment parce qu’elle repose sur des liens indéfectibles qui s’inscrivent dans nos histoires partagées. Ce soir-là alors qu’il me donnait son nom, je lui répondais : « Alain Kleinmann, comme le peintre de la mémoire ?». Et lui de me répondre : « Mais c’est moi… »
Dès lors, entre ce point commun d’avoir eu un père et un oncle fourreurs résidant rue d’Hauteville à Paris et mon intérêt actuel porté à la philosophe et traductrice Olga Kagan-Katunal qui se trouve être sa « grande tante » (en réalité la cousine de sa grand-mère maternelle), modèle et inspiratrice de ses engagements, nos parcours ont souvent été amenés à coïncider.
Plusieurs articles rédigés ou des interviews données à la radio pour faire connaître son travail ont scellé notre amitié, fondée sur la simplicité et une sensibilité partagée à la beauté de la civilisation d’Israël.
Il est difficile de réduire cet artiste majeur et son art à des mots. Pourtant, considéré comme un artiste de la mémoire, celle de la Shoah et d’une identité juive ashkénaze que la Catastrophe a échoué à faire disparaître, ses réalisations redonnent vie à un monde disparu, celui du shtetl, la bourgade juive d’Europe centrale. Ses œuvres sont toujours habitées par des lettres, par des âmes, par un « je-ne-sais-quoi » d’humanité qui touchent celui qui la contemple.
Témoignage vivant, les sujets de ses réalisations n’ont jamais cessé d’évoluer par la diversité des supports employés et des techniques développées. Des ponts de différentes natures sont ainsi édifiés entre le sujet et la technique qui mixte l’emploi de matériaux nobles à l’état neuf et la récupération de supports usagés chargés d’histoire.
Tradition et mémoire, histoire et actualité, sont convoquées simultanément pour ouvrir un univers des possibles. D’ailleurs, Elie Wiesel disait : « Je trouve les images d’Alain Kleinmann émouvantes et même bouleversantes… » Ce que corroborait l’écrivain israélien Amos Oz en s’adressant à l’artiste : « Vos œuvres sont une puissante commémoration d’un monde qui a été assassiné. Votre travail est calme, murmuré, mais accablé de nostalgie, de compassion et de chaleur. Merci. »
Ces liens noués entre le passé pas si lointain et le présent qui le prolonge ont conquis un public de privilégiés à travers le monde. Des milliers d’expositions en témoignent sur tous les continents. Ce qui fait d’Alain Kleinmann un des artistes contemporains majeurs et son œuvre, la plus remarquable du monde de l’art (juif). Se jouant des oppositions communément admises, ses réalisations sont un trait d’union entre un monde exigeant — celui de l’art — et le grand public.
S’il est l’un des plus grands peintres contemporains, sa gentillesse et sa modestie cohabitent avec le talent d’un artiste peintre aux techniques multiples dans lesquels il ne s’enferme pas, mais s’ouvre plutôt. Si Alain a été qualifié de peintre de la mémoire (même par moi dans mes écrits le concernant), il récuse l’apposition des mots sur son inspiration artistique et les réalisations qui l’expriment. Si les phrases figent des vérités, l’art ne s’enferme dans aucun carcan. Bien plus, il correspond à un niveau d’expression différent : l’art ne se pense pas, il se crée et s’invente. Alain est un artiste, un vrai, qui s’exprime par l’art. L’accueil du monde artistique ne s’est d’ailleurs pas trompé car son œuvre est internationalement appréciée et reconnue.
Dans une étude que je signais et dont le titre était destiné non seulement à alerter, mais également à secouer les consciences – « La culture (juive) a-t-elle un avenir en France ? » -, Alain avait accepté d’écrire une perspective dans laquelle il précisait: «Tant qu’il y a des Juifs dans un pays, la culture juive existe!».
La couverture de mon premier livre reproduit une œuvre d’Alain : une machine à écrire marquée par les signes du temps laisse s’envoler des pages que l’on devine griffonnées en yiddish. Dans un entretien pour la presse juive, Alain me confiait : « Comme vous l’avez vu dans mes installations, le temps semble se figer et les papiers volants se retrouvent fixés dans leur état d’instabilité. Il y a comme une patine, une impression de moisissure et de poussière qui enveloppe tous ces objets, comme si tout un monde se retrouvait d’un seul coup fossilisé. » A l’instar de la yiddishkeyt, et c’est peut-être cela le message que nous aide à entrevoir Alain, la trace ne s’évanouit pas, effacée par ce qui ressemblerait à l’oubli, elle s’actualise dans nos mémoires pour renaître sans cesse…

Florence Ben Sadoun
L’EMPREINTE DE LA VIE
Je n’ai jamais rencontré Alain Kleinmann en vrai, et une seule fois en peinture, sur un mur au milieu de tableaux qui n’étaient pas les siens. J’ai surtout voyagé à travers ses œuvres que j’ai visitées via la toile. De cases en écrans. J’ai découvert ses accumulations de reliures de livres où je n’ai vu que le souvenir des mains qui les ont touchés, de ses sculptures de pinceaux figés comme autant de couleurs à l’arrêt, de ses valises lourdes posées comme les pierres d’un mur.
Je ne connais pas son visage, il est peut-être chauve ou si maigre que j’imagine qu’il doit avancer comme un oiseau sautille. Léger comme une plume pour enserrer autant de passé dans une petite surface. Il doit marcher sans faire de bruit dans son atelier, pour ne pas réveiller les fantômes. Les siens. Les nôtres aussi qui n’ont vraiment pas le moral en ce moment. Mais ne se prennent pas pour autant au sérieux.
On sait quelques mots de cette langue qu’il enchâsse par couches successives dans une trame de lin blanchi ou de carton bouilli mais qui se prononcent à voix basse. Il écoute l’écho d’un monde fini et engage dans le regard de ceux qui veulent bien écouter son travail, une conversation intime. Sans sauvagerie. Il est question ici de murmure, de pudeur, de regard perdu. A tout jamais.
Enfin tout cela n’est qu’une sensation qui peut être démontée par les érudits ou défendue par ceux qui, comme moi, ressentent sans comprendre. On traverse avec lui les époques, les pays, les frontières, celles du bien et du mal.
Comment fait-il pour être traversé dans le plus grand calme par toutes ces morts, tous ces crimes, tous ses désirs arrêtés en plein élan et toute cette violence ?
Je crois même qu’il écoute parler le grain d’une feuille de papier avant de la toucher. Et ce geste m’émeut.
Immédiatement quand j’ai déroulé d’une façon irrationnelle des pages d’images de son travail, j’ai pensé à Phantom Thread, un film de Paul Thomas Anderson. Quel est ce grand écart, me direz-vous entre ce film d’un américain dans l’Angleterre de l’après-guerre et Kleinmann ? Le titre mystérieux et inquiétant, est celui de l’empreinte de la vie qui reste sertie d’une façon invisible dans le revers d’un vêtement. Un fil ou parfois même un cheveu d’une personne aimée est cousu à l’intérieur d’une robe ou d’une veste à l’insu de celui ou celle qui la porte. C’est Daniel Day Lewis dans le rôle de Reynolds Woodcock, ce grand couturier inspiré de Cristobal Balenciaga, qui recoud avec ce fil fantôme les déchirures de la mémoire du passé. L’empreinte du passage d’un être humain.
N’est-ce pas ce que murmure l’œuvre de Kleinmann ?

Alexandre Arcady
Il a des tableaux qui vous subjuguent dès le premier regard…
Il y a des tableaux qui vous transportent et vous emmènent sur les rives de votre propre histoire.
Il y a des tableaux que vous conservez d’un seul coup d’œil au fond de votre cœur.
Il y a des tableaux que vous gardez pour qu’ils vous accompagnent chaque jour de votre vie.
Il y a des tableaux….
Alain est un artiste qui comme un frère vous tend la main et vous fait voyager au pays de la mémoire.
Alain, est un magicien de l’âme.
Depuis très longtemps, son univers m’accompagne et me fait du bien.
Depuis très longtemps je regarde son travail avec passion et respect.
Alain est plus qu’un artiste, c’est un homme de cœur.
Qu’il poursuive longtemps son chemin et qu’il nous accompagne toujours. »

Steve Suissa
ALAIN KLEINMANN, L’IMMENSITE DE L’AUTRE
J’ai rencontré Alain Kleinmann à l’occasion d’un enregistrement des émissions A l’Origine que je produis et réalise sur France 2.
Une rencontre qui s’est faite pas à pas, une distance qui s’est peu à peu réduite entre nous.
J’ai d’abord rencontré ses œuvres.
Des œuvres aux couleurs automnales, qui mélangent des photos, des matières de toutes sortes. Des œuvres riches à découvrir au fur et à mesure que le regard se déplace sur elles.
On y trouve des machines à coudre, des livres, des morceaux de dentelle et des valises.
Ces valises me font tout de suite penser à celles qui ont toujours accompagné l’exode du peuple juif tout au long de l’histoire. Un peuple toujours prêt à partir, ou à fuir, un peuple dont la vie doit être contenue dans ce petit bagage.
C’est cette histoire du peuple juif que Alain Kleinmann semble vouloir nous raconter. Ce passé parfois douloureux, ces photos d’enfants, de familles entières. Des œuvres empreintes d’une douce nostalgie. Ce sont comme des souvenirs que l’on ne doit pas oublier, des sourires et des moments heureux à préserver comme un trésor. Il faut les entourer de ces tissus, de ces dentelles, tel un doux nid.
Des livres aussi, des piles de livres. Ces livres qui sont la richesse du peuple juif, car ils sont la source de l’étude et de la transmission.
Toute son œuvre est une ode au passé qui construit l’avenir.
C’est ce message qui me touche particulièrement. Cette volonté de transmettre, sans cesse, de se battre contre l’oubli, si facile. Et cette tendresse particulière pour notre peuple qu’il évoque pudiquement.
Comme pour la plupart des artistes, mettre des mots sur les sentiments les plus intimes, les émotions les plus profondes, parfois même sur notre identité, semble impossible.
C’est à travers notre expression artistique, nos œuvres, nos projets que les mots prennent forme.
Je comprends alors ce qui nous reliait tant dès notre première rencontre artistique.
L’art est un puissant vecteur. Il nous permet de partager, de donner sans cesse, et de laisser l’autre recevoir en toute liberté ce message.
Chacun peut trouver dans les œuvres d’Alain Kleinmann une parcelle de sa propre histoire. Les lectures peuvent en être différentes. Certains y verront un peuple englouti par la Shoah, d’autres percevront la nostalgie d’un passé enfoui, d’autres y verront la douceur des matières.
Une offre universelle de regards, c’est cela qui fait un grand artiste. Car ce qui compte c’est de donner.
Lorsque nous nous sommes vus, cette complicité artistique s’est trouvée renforcée. Alain Kleinmann est un homme doux, humble, chaque mot qu’il prononce est réfléchi. Il choisit délicatement ce qu’il donne à entendre ou à voir, car il le fait avec amour et générosité.
Je découvre que son œuvre a inspiré la création d’une pièce de théâtre à Cuba. Il me montre ses réalisations somptueuses. Nos deux mondes se rencontrent, comme une évidence.
Je découvre également ses dernières œuvres dont la blancheur est éclatante.
Dans l’évolution de son chemin, les objets du passé sont encore là, mais cette fois en pleine lumière. Ils s’affirment, ils existent dans le présent à part entière. Comme si la page était tournée, que ce passé s’était ancré et avait enfin rempli son rôle de transmission.
Alain Kleinmann est aussi grand et riche que ses œuvres.
Un homme pétri d’une grande humanité qui laisse la place à l’autre et à son immensité.

Diane Kurys
Les tableaux d’Alain Kleinmann sont autant de chemins qui nous transportent dans le temps, dans la mémoire de nos ancêtres. Ils sont des évocations non pas d’un peuple disparu mais d’un monde vivant au contraire. Car ce qu’il cherche à montrer c’est la vie, la pensée, les regards de gens que nous n’avons pas connus. Il nous donne à voir comment ils étaient, ce qu’ils traversaient, comment ils jouaient de la musique, comment ils lisaient, dans quels décors ils évoluaient. Ces escaliers qui montent vers des étages interdits, ces bibliothèques surchargées, visages qui se superposent, portails entrouverts sur des jardins secrets, autant d’énigmes autant de strates qui nous perdent et nous parlent. Il y a toujours de la lumière au centre de ses tableaux, comme s’ils étaient éclairés de l’intérieur peut-être par l’âme du peuple juif et ce qui me touche chez Kleinmann ce sont les regards que ses personnages ont l’air de porter sur nous qui les observons aujourd’hui. Ses tableaux, ses dessins sont en quelque sorte des miroirs dans lesquels nous nous reconnaissons. Ce que j’aime au fond le plus dans ce travail c’est cette constante recherche de la vie. Sa démarche est proche de celle de l’écrivain Daniel Mendelssohn quand, avec Les Disparus, il n’essaie pas de savoir comment ses ancêtres sont morts mais plutôt comment ils ont vécu. J’ai l’impression qu’en faisant des films j’ai souvent essayé à ma manière de faire la même chose. Comprendre le quotidien des gens de ma famille, les faire évoluer, souffrir, aimer, vivre ou mourir en les installant dans une époque que je n’ai pas connue, ou à peine. Pour moi, faire cela, c’est essayer de comprendre d’où je viens. Ce que fait Alain Kleinmann c’est comprendre d’où nous venons tous. De la même façon que dans « L’esprit pur » Alfred de Vigny parlant de ses ancêtres déclarait : « Si j’écris leur histoire ils descendront de moi ».

Rivon Krygier
LE DIVIN SE DONNE-T-IL A VOIR ?
HOMMAGE À ALAIN KLEINMANN
Lorsque notre ami Mischa me sollicite pour contribuer à ce beau-livre consacré à « la mémoire, la transmission, et l’art », en lien avec l’œuvre d’Alain Kleinmann, je lui avoue ma perplexité.
Je connais insuffisamment son œuvre et mon champ de réflexion porte plutôt sur les questions de théologie et de modernité… Qu’à cela ne tienne, me voilà aussitôt convié par Alain – via Mischa qui a tout concocté – à visiter son atelier et à l’interroger de vive voix sur la question qui rencontre ma curiosité : « Avez-vous un moment voulu représenter quelque chose de l’ordre de la transcendance, du divin ou de l’absence du divin? Ou vous êtes-vous, au contraire, soi- gneusement gardé d’aborder cette dimension?»
Arrivé à l’adresse de l’atelier, je décide spontanément de gravir à pied les cinq étages qui y conduisent. La porte s’entrouvre sur le sourire chaleureux d’Alain, sur tout un univers… et sur d’autres escaliers. Dans le genre atelier, c’est plutôt un grenier. Les tableaux se mêlent aux objets, ou forment des tableaux-objets, des «installations». Valises anciennes, machines à coudre, landaus rouillés, montres à gousset, papiers d’archives surgissent enchevêtrés du siècle passé comme venus témoigner de leur traversée du temps et de ses tourments. Les visages peints qui tous vous regardent fixement ont une position quasi hiératique : graves et emprunts, en toute humilité, d’une forme de majesté. Je remarque une sculpture imposante de livres disposés en escalier; et, encore, l’un et l’autre tableau d’escalier, sans que l’on ne sache sur quoi tous ils débouchent… Moi qui suis venu interroger un artiste sur la trace de la transcendance dans son art, je me dis qu’avant toute parole échangée, la direction est déjà donnée. Cerné de toute part par des marches mouvantes et émouvantes, je ne puis m’empêcher de songer à l’épigraphe que Charles Mopsik (qu’Alain et moi avons bien connu) s’était choisi lorsqu’il entreprit la traduction du Zohar. Ce texte de Kafka m’apparaît comme une parfaite métaphore de l’œuvre d’Alain et de sa tentative éperdue de retenir le temps :
Comment dans cette vie brève, hâtive, qu’accompagne sans cesse un bourdonnement impatient, descendre un escalier? C’est impossible! Le temps qui t’est mesuré est si court qu’en perdant une seule seconde, tu as déjà perdu la vie entière, car elle n’est pas plus longue, elle ne dure justement que le temps que tu perds ! T’es-tu ainsi engagé dans un chemin, persévère à tout prix, tu ne peux qu’y gagner, tu ne cours aucun risque; peut-être qu’au bout t’attend la catastrophe, mais si dès les premiers pas tu avais fait demi-tour et si tu avais redescendu l’escalier, tu aurais failli dès le début, c’est plus que probable, c’est même certain. Ainsi ne trouves-tu rien derrière ces portes, rien n’est perdu, élance-toi vers d’autres escaliers ! Tant que tu ne cesseras de monter, les marches ne cesseront pas ; sous les pieds qui montent, elles se multiplieront à l’infini ! (Le retour).
Nous entamons le fond de notre discussion. Il ne lui serait pas venu à l’idée, me dit-il, de représenter le divin, tout en étant parfaitement conscient que son univers pictural est imprégné d’une dimension qui tire le profane hors de l’ordinaire. De fait, chez Alain Kleinmann, la trans- cendance se fait immanence; elle se donne à voir à travers la mise en abîme des personnages habités par une tradition qui, remontant du fond des âges, façonne leur visage. Pas de présence de Dieu, mais des personnages pieux omniprésents. Une Haggada de Pessah illustrée, mais pas la moindre scène biblique tandis que se donnent à voir ceux qui font acte de mémoire. Il y a, de toute évidence, dans ce positionnement, une réserve que l’on reconnaît bien chez bon nombre d’artistes juifs, tant parce que l’absence de Dieu est devenue, après la Shoah, un sujet sidérant qui impose le silence, que parce qu’il y a toujours eu, dit-on, dans la tradition juive, un refus viscéral de vouloir représenter la chose divine.
C’est cette dernière assertion sur laquelle je voudrais brièvement cogiter, en hommage à l’œuvre d’Alain et au questionnement qu’elle éveille. Il ne fait aucun doute qu’en comparaison de l’art chrétien, la culture juive à travers les âges ne s’est pas illustrée par l’art pictural et sculp- tural. Comme on le sait, la production artistique est restée jusqu’aux temps modernes largement liée au sacré. Or le judaïsme normatif, depuis la Bible, s’est opposé avec virulence à la fabrication de toute représentation iconique du divin, en particulier des statues car souvent objets de culte. On a tous en tête l’injonction figurant en tête du décalogue : «Tu n’auras pas d’autres dieux face à Moi. Tu ne feras pas pour toi d’image sculptée (pessel) ainsi que toute forme (temouna) qui est dans le ciel en haut et sur la terre en bas […]. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas car Je suis l’Éternel ton Dieu» (Exode 20,2-4). Certes, les découvertes archéologiques du xxe siècle ont quelque peu tempéré l’aniconisme radical prêté au judaïsme. On songe aux mosaïques des synagogues de Beit Alpha ou de Beit Shean que l’on date du vie siècle ou plus encore des fresques de la synagogue de Doura-Europos (Syrie frontière irakienne, iiie siècle). La scène de la ligature d’Isaac ou celle du buisson ardent figurent ici et là. À Doura- Europos, le répertoire des scènes bibliques est plus large et on y aperçoit même la main de Dieu depuis les cieux! Et sur une mosaïque de Beit Alpha, comme motif décoratif, le Dieu Hélios figure au centre du dispositif zodiacal… En scrutant les textes anciens, on se rend compte que le positionnement des Sages n’était pas toujours aussi radical qu’on se le figure. Selon le Talmud lui-même, une statue à l’effigie du roi était dressée dans la synagogue de Nahardéa en Babylonie, et les rabbins y priaient néanmoins1. Il y aurait vraiment beaucoup à repréciser quant à la place ménagée à la figuration dans l’art juif antique et aux œuvres plastiques décoratives. Mais il faut admettre qu’en règle générale, la collusion de l’art figuratif avec le paganisme ou le christianisme a, par réaction, fortement inhibé tout essor de son pendant juif, au risque de «l’idolâtrie».
Au cœur de cette hantise, on trouve l’interdit de représenter les autres dieux mais aussi tout ce qui peut figurer Dieu Lui-même notamment sous des linéaments anthropomorphes2.
À l’époque des Lumières, ce trait du judaïsme – et du protestantisme, très iconoclaste depuis Calvin – est même devenu un titre de gloire. Selon une formule du célèbre historien Heinrich Graetz (1817-1891), « tandis que le paganisme regarde son dieu, le judaïsme écoute le sien3 ». Autrement dit «Écoute, Israël,» mais ne regarde pas ton Dieu, car Il est pure transcendance, imperceptible et inaccessible, si ce n’est par le canal de la prophétie ou de l’esprit saint, seul susceptible de retraduire en langage humain l’abstraction du verbe divin. De tous les penseurs juifs, Maïmonide (1138-1204) est celui qui a le plus contribué à écarter du judaïsme rabbinique toute idée de corporéité ou d’anthropomorphisme de Dieu :
La Tora et les Prophètes affirment clairement que le Saint, béni soit-il n’a pas de corps, puisque le verset dit : « Le Seigneur est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas » (Deutéronome 4,39), et qu’un corps ne saurait se trouver en deux lieux simultanément. Il est dit encore : «Puisque vous n’avez vu aucune image » (Deutéronome 4,15), et un autre texte porte « à qui Me comparerez-vous pour que Je lui ressemble ? » (Isaïe 40,25). Or s’il était corps, il ressemblerait au reste des corps (Michné Tora, Lois concernant les fondements de la Tora 1 :7-8).
En somme, selon Maïmonide, les choses sont claires : on ne représente pas Dieu parce qu’il n’y a rien à voir. Dieu est pure spiritualité, invisible par définition. Le reste n’est que langage métaphorique : dans le meilleur des cas, vision symbolique (réservée aux prophètes ou aux maîtres visionnaires en expérience extatique) ou alors délire imaginaire pour ne pas dire pervers. Ce que l’on oublie trop souvent de dire, c’est que si Maïmonide s’est échiné à combattre les anthropomorphismes divins, c’est parce qu’il était embarrassé du fait que la Bible en recèle un très grand nombre. Qui plus est, ils y paraissent, non pas comme des fantasmagories – des constructions de l’esprit – mais comme des théophanies ! Je n’en citerai que quelques exemples. Ils méritent d’être rappelés fut-ce parce qu’une sorte d’auto-censure les refoule le plus souvent de la mémoire collective :
Moïse monta avec Aaron, Nadav et Avihou, et soixante-dix anciens d’Israël (sur le Sinaï). Ils virent le Dieu d’Israël ; sous Ses pieds, c’était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n’étendit point Sa main sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent (Exode 24,9-11).
Israël vit la grande main que l’Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l’Éternel, et il accorda confiance en l’Éternel et en Moïse, Son serviteur (Exode 14,31).
Je parle avec lui (Moïse) de bouche-à-bouche, en Me montrant clairement, et non en énigmes ; et il contemple l’image de l’Éternel» (Nombres 12,8).
Ils ont [les Égyptiens] entendu que Toi, Éternel, Tu es au milieu de ce peuple, à qui Tu te laisses voir les yeux dans les yeux, Toi, Éternel, que Ton nuage se tient au-dessus d’eux et que Tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuage et la nuit dans une colonne de feu (Nombres 14,14).
Certes, et c’est loin d’être anodin, ces moments de contemplation sont rares et ce qui est entrevu de Dieu n’est le plus souvent que furtif et partiel. Ici la nuée fait écran; là le feu éblouit ou consume qui outrepasse les limites. Même Moïse, le plus intime avec Dieu, qui demande à contempler la «gloire divine» se voit répondre par Dieu que Son visage ne peut être observé par un humain sans en mourir. Mais Il lui permet néanmoins d’en contempler mystérieusement «l’arrière»4 !Laplupartdutemps,etpourlecommundesmortels,Dieuestinvisible.Toutefois, il en est ainsi non point parce que Dieu le serait par essence mais parce que l’éclat divin ne peut être supporté sans filtres et moult précautions, et parce que le contact visuel avec Dieu, quand il est rendu possible, doit rester un moment privilégié, réservé à qui mérite de pénétrer, à un degré ou l’autre, dans la sphère de Son intimité. Pour le dire de manière quelque peu provoca- trice, loin d’être pure abstraction, Dieu S’incarne de multiples façons. Il investit de Sa présence certains autels ou stèles5, Il s’incarne même sous forme humaine, comme en le seigneur qui compte au rang des trois visiteurs d’Abraham, et que l’on a ultérieurement assimilé à des anges6. Il laisse entrevoir «Sa gloire» à ceux qui assistent à Sa révélation ou à Son installation dans le Sanctuaire. Plus encore, selon les termes utilisés dans la Tora, les Psaumes, le Targum et la lit- térature tannaïtique, le pèlerinage trois fois l’an au Temple de Jérusalem consistait en une «entrevue» avec Dieu, «à voir et à être vu», à un degré ou l’autre7. Un midrach raconte que lorsque Dieu voulut Se révéler à Israël, depuis le Sinaï, le peuple demanda explicitement à ne pas seulement pouvoir écouter son Roi (Dieu) mais aussi à Le voir, car «qui contemple n’est pas comme qui simplement entend »8 ! On est aux antipodes de ce qu’en entendait H. Graetz… En fait, l’incarnation – il faudrait dire «l’incorporation», car ce n’est pas le plus souvent en « chair » – de Dieu n’a en soi rien de choquant pour la tradition juive9. Encore faut-il appréhen- der correctement cette notion qui renvoie à une présence dont la concrétude reste très fluide et non étroitement localisée (cela fait penser, pour s’en donner une très vague idée en physique, à un champ de forces, dont émergent de temps en temps, à notre observation, des manifesta- tions corpusculaires ou flamboiements photiques). Dieu Se manifeste sous diverses formes et à divers échelons, sous des « enveloppes » plus ou moins épaisses ou opaques. En particulier, cette incorporation prend souvent la qualification d’ange, non pas en simple «créature» mais bien comme épiphanie, une extension de Dieu, ou un relai de Sa volonté qui Le présentifie. Comme l’explique Charles Mopsik :
Le mot « ange » ne désigne pas seulement un envoyé ou un émissaire de Dieu chargé de porter des messages aux hommes, mais le texte biblique lui a donné une signification riche de possibilités et suffisamment énigmatique et intrigante pour susciter réflexion. L’Ange au singulier peut être vu par l’homme sous la forme d’une flamme, et cette apparition n’est pas celle d’une entité séparée mais elle est la forme spécifique à travers laquelle le Dieu céleste et invisible Se fait connaître et se mani- feste. La tradition rabbinique, à l’occasion d’un commentaire sur la vision par Moïse du buisson ardent, a consigné cette idée en une formule devenue classique : «Partout où l’Ange apparaît, la Chekhina apparaît» (Exode Rabba 32:9), exprimée encore sous d’autres formes : «Je suis le prince de l’armée céleste, et partout où j’apparais, le Saint béni soit-il apparaît» (Genèse Rabba 97:3); «Partout où Michaël [ou Gabriel] apparaît, là est la Gloire de la Chekhina» (Exode Rabba 2:5). (Introduction au Livre Hébreu d’Hénoch ou Livre des Palais, Verdier, 1989, p. 29-30.)
Invisible, Dieu l’est quand Il Se tient au sommet du monde sur Son « trône exalté », dans Sa résidence transcendante. Mais Il ne S’en tient pas là. Les incursions divines dans notre monde sont comme autant de phénomènes circonscrits d’une entité globale qui est, au demeurant, trop vaste, ubique ou ancrée dans une « autre dimension » (pour les cabalistes, hors de l’espace-temps) pour être définitivement contenue en un lieu singulier ou arrêtée en un temps donné. En général, ce qui s’engage est toujours une émanation diminuée, épiphénoménale, « hypostatique » de la divinité qui demeure en même temps au-delà de toute naturalisation. C’est pourquoi la Bible peut dire, sans se contredire, que «le Seigneur est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre ici-bas » (Deutéronome 4,39) ou que « les cieux sont Son trône et la terre Son marchepied » (Isaïe 66,1). C’est ce que tente d’expliquer un midrach :
Un Samaritain demanda à Rabbi Méir : Est-il concevable que Celui qui a dit : « Ne remplis-Je pas les cieux et la terre?» (Jérémie 23,24) Se soit adressé à Moïse d’entre les deux barres por- teuses de l’arche sainte? Rabbi Méir lui répondit : Apporte-moi des miroirs concaves! Rabbi Méir lui dit alors : Observe ton reflet! Il le vit agrandi. — Apporte-moi des miroirs convexes! Rabbi Méir, de lui dire : Observe ton reflet! Il se vit en miniature. Rabbi Méir lui dit alors : Si toi qui n’es qu’un être de chair et de sang, tu peux voir se modifier ton apparence comme bon te semble, n’est-ce pas plus encore à la portée de Celui qui «par Sa parole, le monde fut» (Ps 33,9) ? Lorsque Dieu en décide, Il peut dire : « Ne remplis-Je pas les cieux et la terre ? » (Jérémie 23,24), et lorsqu’Il en convient autrement, Il s’adresse à Moïse d’entre les deux barres de l’arche sainte (Exode 25,22) (Genèse Rabba 4:4).
Tout cela, bien entendu, reste fort étrange pour nous, les modernes. En réalité, cela le fut déjà pour les Anciens mais pour une autre raison que l’aversion rationaliste à l’idée que Dieu puisse Se donner à voir. La littérature talmudique témoigne notamment de la conception selon laquelle, au fil du temps, les apparitions divines et manifestations dérivées qui étaient éparses puis concentrées dans le Saint des saints Se sont raréfiées jusqu’à s’estomper avec la destruction du Temple10. Désormais Dieu « dérobe Sa face »11, Il reste résolument caché12. Certains rabbins mystiques seraient parvenus encore à franchir, à leurs risques et périls, le col des hauteurs célestes, au moyen d’ascensions extatiques. Et, selon ce qu’en rapporte la littérature dite des Palais (rédaction entre le ive et viiie siècle), c’est une vision béatifique de Dieu qui s’offre alors à leurs yeux ébahis : «Face adorable, face ornée, face de beauté, face de flammes, telle est la face du Seigneur, le Dieu d’Israël quand Il siège sur le trône de gloire » (Heikhalot Rabbati § 159).
Mais, pour le commun des mortels, pouvoir un jour, à un niveau ou l’autre, « accueillir » ou jouir de la «contemplation de la face de Dieu»13, à la fin des jours ou par-delà le trépas, est devenu une aspiration nostalgique. Non un vœu purement rhétorique. Du moins, jusqu’à ce que la philosophie platonicienne et surtout aristotélicienne gagne les esprits et que de grandes figures rabbiniques relisent les textes classiques au second degré en déniant toute incorporation divine.
Ceci nous conduit à risquer quelques méditations périlleuses sur la figuration anthropomor- phique de Dieu tant décriée. Comme nous avons pu le souligner par les quelques exemples cités, c’est souvent (quoique non nécessairement) sous apparence humanoïde que Dieu Se laisse entrevoir et Se présentifie. Mais avant de crier au sacrilège, de recourir au déni en interprétant les textes comme pure métaphore ou comme langage imagé réservé aux visionnaires ou aux faibles d’esprit, ou encore de n’y déceler qu’une sublimation infantile de la figure du père, il conviendrait de prendre conscience que le rapprochement entre le divin et l’humain est émi- nemment assumé dans la Bible et ce, depuis l’instant révélateur de la création de l’homme :
«Dieu créa l’homme à Son image; c’est à l’image de Dieu qu’il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois» (Genèse 1,27). La littérature talmudique, loin de réduire cette ressemblance à une affinité purement spirituelle (la raison) ou morale (la dignité, le libre arbitre), comme le feront les philosophes occidentaux, n’hésite pas à creuser le mystère. Ainsi, selon Rabbi Hochaya, lorsque les anges célestes ont aperçu pour la première fois Adam, ils l’ont pris pour une mani- festation de Dieu, au point de proclamer Sa gloire par le titre «Saint!»14.
C’est que la référence à l’humanité n’a rien d’indécent en soi. Examinons notre propre lexique. Il est vrai que lorsque l’on veut pointer les turpitudes des humains ou reconnaître avec commisération leurs faiblesses, il nous vient à dire « c’est une réaction bien humaine ». Le sens est péjoratif. Humaniser Dieu revient alors à le rabaisser. Mais lorsque nous disons d’un individu qu’il est «très humain», c’est au contraire laudatif. Humaniser Dieu consiste alors à L’exalter. N’y a-t-il d’ailleurs rien de meilleur à en dire ? Ou est-ce réducteur, vulgairement mythologique, quand il s’agit de caractériser l’Être suprême? Il conviendrait de se demander s’il n’est pas davantage réducteur de penser Dieu comme pur intellect, surpuissance impassible et impavide, comme ont pu le concevoir Aristote et les déistes modernes. Pour les maîtres du Talmud, Dieu n’est pas cette «chose», esprit si impersonnel et indifférent qu’il relève plus de la cybernétique que de la relation. Il ne peut davantage être ramené uniquement à «l’ineffable» qui, puisqu’on ne peut rien en dire, se réduit à rien, ou à rien qui puisse nous concerner, nous, humains. On objectera qu’appréhender Dieu sous l’angle de la physiognomie humaine n’est qu’une vulgaire et étroite projection de soi. « Si les bœufs, les chevaux avaient des mains pour dessiner et créer des œuvres comme le font les hommes, les chevaux représenteraient les dieux à la ressemblance du cheval, les bœufs à celle du bœuf, et ils leur fabriqueraient un corps tel que chacun d’eux en possède lui-même» proclamait déjà le philosophe présocratique Xénophane15. Peut-être. Mais ne peut-on pas tout aussi bien inverser les choses et, au lieu de considérer le corps divin comme un anthropomorphisme, tenir plutôt le corps humain comme un théomorphisme16 ? Tel serait le mystère de l’homme, le sens biblique et talmudique du Tselem Elohim, Imago Dei. Pour les maîtres du Talmud, le corps humain, loin d’être le « tombeau de l’âme » comme l’ont conçu les platoniciens, est le noble médium par lequel la personne qui l’habite de haut en bas entre en relation au monde à divers échelons, comme Dieu Lui-même le fait. Répugner l’idée que Dieu puisse apparaître en corps humanoïde trahit, du reste, un mépris certain envers le corps humain. Le revêtement anthropomorphe par le Dieu infini ne signifie rien d’autre qu’Il Se réduit (Se « rétracte » pour utiliser le vocabulaire cabalistique du tsimtsoum) de telle sorte qu’Il puisse entrer en relation avec le monde sous la forme la plus à même de communiquer avec l’humanité, à interagir avec elle, certes non à égalité, mais dans une effective réciprocité. Dieu, en révélant la Tora, parle l’humain. Mais en Se rendant jadis visible, par isomorphisme avec le corps humain, Il se faisait plus encore langage de proximité, de l’intimité. Il Se rendait présent, accessible et disponible.
Si telle est la conception antique, demandera-t-on, pourquoi alors la Bible et ensuite toute la tradition juive s’est-elle si tenacement opposée à toute représentation iconique du divin ? Ce qui semble avoir été visé par les interdits de représentation matérielle de Dieu, à travers l’idole, c’est la prétention de vouloir contenir, retenir la divinité, la tenir à disposition, voire la domes- tiquer en l’assignant à résidence. La divinité est censée habiter la statue. Avoir un œil sur elle, c’est prétendre avoir sur elle une certaine emprise. Tandis que si la divinité est insaisissable, ou ne se donne à voir que rarement et incidemment selon ses propres conditions, elle conditionne la relation, requiert de l’adorateur une retenue et une discipline, en bref une responsabilité. Un dieu qui ne se laisse pas voir intempestivement est un dieu qui ne se laisse pas dompter, qui n’est pas fixé et manipulable à souhait par la puissance magique ou cultuelle. C’est un dieu insaisis- sable qui ne nous appartient pas. L’idole est aussi souvent la représentation d’un aspect singulier du divin, d’un dieu ou déesse, à qui l’on voue un culte aux dépens d’un autre, et donc fait entrer dans la logique instrumentale du polythéisme, trahissant le désir d’imposer un influx au prix d’un autre.
Est-ce à dire que toute représentation artistique de la transcendance soit inconcevable pour un art juif digne de ce nom? Les quelques éléments de réflexion que nous avons pu ébaucher au cours de la présente étude, nous conduisent à conclure par la négative. Force est de constater – et on n’y prête étonnamment le plus souvent aucune sérieuse attention – que, si les réalisations plastiques ou picturales du divin ont été généralement bannies, on ne compte plus le nombre de textes de la tradition juive classique qui, de façon littéraire, décrivent les apparitions et mani- festations divines sous leurs multiples formes, y compris, comme nous l’avons souligné, anthro- pomorphiques. Ce n’est pas le pinceau ou le burin mais la plume, à travers l’ekphrasis, le discours descriptif qui occupe la fonction de restituer, de manière vivante pour la conscience, la vision de Dieu. Certes, et c’est essentiel, même les descriptions les plus audacieuses et, dans certains cas, les plus érotiques, sont toujours teintées d’une certaine retenue, de l’aveu que, dans tout ce qui est aperçu, quelque chose toujours nous échappe, précisément pour que jamais l’expé- rience d’appréhension ne se transforme en préhension, en voyeurisme. Même dans les rares représentations picturales existantes, il ne s’agit jamais d’une icône au sens d’une image investie par la présence divine chargée ou dotée d’un pouvoir sacramental domesticable. Mais rien ne devrait interdire, au moyen de la peinture ou de la sculpture, que l’on mette en valeur l’expé- rience du sacré, la rencontre de la transcendance, le rendu de visions évoquant la présence divine. Le pouvoir suggestif de l’art, qui fait de l’art ce qu’il est vraiment, peut rendre compte de la conception inouïe selon laquelle l’invisible divin se donne à voir, à quelque hauteur de l’escalier, à qui veut se rapprocher de lui sans chercher à le posséder.
Notes
1. TB, Roch ha-chana 24b.
2. Cf. Talmud, op. cit.
3. Structure of Jewish History, 68, 1846.
4. Cf. Exode 33,18-23. Quelques versets plus haut, il est néanmoins affirmé que «Moïse s’entretenait avec Dieu en face à face (panim èl panim) comme un individu s’adresse à son compagnon » (Ex 33,11). Le Deutéronome soutient que Dieu S’est fait connaître à Moïse en face à face (Dt 34,10) et qu’Il a parlé au peuple « face à face, depuis la montagne, du milieu du feu » (Dt 5,4). Il semble y avoir divers degrés d’« entrevue ».
5. Cf. Genèse 33,20. Voir Benjamin D. Sommer, The Bodies of God and the World of Ancient Israel, Cambridge, 2009.
6. Cf. Genèse 18. Le suffixe de Adonaï (seigneur) est ponctué avec un kamats, ce qui indique qu’Abraham s’adresse au Seigneur, entouré de deux anges écuyers, et non à trois seigneurs (ce qui eût impliqué la ponctuation d’un patah). Cf. Sommer, op. cit., p. 40-42. Rachi (ad loc.) le mentionne mais en limite la portée, tenant le seigneur comme l’ange supérieur.
7. Voir par ex. Exode 23,17 ; 34,23 et Deutéronome 16,16, Ps 42,3, Sifré Devarim, Ree 243, Targum neofeti sur Dt 31.
8. Mekhilta de-Rabbi Yichmaël, Yetro, Be-hodèch, 2.
9. Ce qui est inconcevable pour la mentalité juive, c’est la réduction de la divinité à l’humanité ou l’ambivalence d’un être hybride qui serait à la fois Dieu et homme (tension qui est un « mystère » pour les chrétiens), mais non que ses émanations puissent se manifester occasionnellement de manière concrète, corporelle et humanoïde.
10. Cf. Ezéchiel 10,18-19.
11. Cf. Deutéronome 31,17-18.
12. Voir par ex. TB, Haguiga 5ab.
13. Cf. par ex. op. cit. ou LvR 30 : 2. Voir l’étude de Rachel Neis, The Sense of Sight in Rabbinic Culture, Cambridge University Press, 2013. 14. Genèse Rabba 8:10.
15. Rapporté par Clément d’Alexandrie, Stromates V, 109,3.
16. Cf. Yaïr Lorberbaum, In God’s Image, Cambridge University Press, 2015.
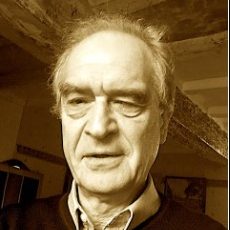
Claude Birman
L’ART D’ALAIN KLEINMANN
– L’œuvre singulière du plasticien Alain Kleinmann se développe en filiation avec l’universelle activité artistique d’humanisation. C’est un authentique affluent de ce grand fleuve. Mais son propre est de mettre les savants procédés des beaux-arts principalement au service de la mémoire juive. Il assume ainsi la restitution sublimée, patiente et émouvante, par des images élaborées, du cadre de vie et des objets qui accompagnaient la vie juive avant sa dévastation par la Shoah.
Le grand photographe Roman Vishniak, et d’autres, ont saisi, peut-être avec prémonition, bien des images fortes de ce vaste Atlantide, juste avant sa disparition. Nous avons aussi par ailleurs des représentations poignantes des persécutions elles-mêmes, parfois œuvres de grands artistes, comme Zoran Music. Mais la perspective d’Alain Kleinmann est autre. D’abord la peinture n’est pas la photographie, trop factuelle, si délicate soit-elle. Et montrer les persécutions ne nous rend pas la douceur de vivre, même modeste, qui les a précédées ; et avec laquelle nous aspirons à rétablir le lien.
– La nécessité de l’œuvre d’Alain Kleinmann est donc un précieux travail de mémoire. Il est lié au sens profond du verset de Qohélet, L’Ecclésiaste : « Ce qui a été, c’est cela qui sera », qui, sous des apparences fatalistes, selon sa tournure biblique de pensée interrogative, indique que les possibilités d’avenir ont leurs racines dans les acquis du passé. Or ces acquis menacés d’oubli sont avant tout ceux d’une sensibilité juive longuement cultivée, au cours des bonheurs et des vicissitudes d’une immense histoire cosmopolite, une saga unifiée par sa fidélité à la Bible hébraïque, et, par elle, à l’Israël antique. Et préserver ces acquis importe non seulement au présent et à l’avenir de l’intériorité de l’existence juive, mais aussi à ceux de son rayonnement auprès des autres cultures, sœurs en humanité, proches et lointaines.
– Mas si les mots y peuvent quelque chose, ils n’y suffisent pas. Car ce qu’on parvient à dire pour le penser clairement, il faut d’abord l’avoir senti, moins clairement, mais plus profondément. Quand un enfant commence à parler, ce qu’il aura à dire n’est-il pas déjà préparé par ce qu’il a préalablement senti, dans le silence de sa vie fœtale et de sa petite enfance, au sein de son premier entourage ? C’est pourquoi le Talmud compare l’enfant à un livre fermé. Et c’est pourquoi Alain Kleinmann peint des livres fermés en abondance, jusqu’à déborder de la toile dans l’installation austère mais réjouissante d’une cascade figée de piles de livres écroulées, de récits et d’étude. C’est comme si, en un sens, l’image ou la sculpture muettes de livres fermés étaient paradoxalement plus suggestives que leur contenu. Le plasticien Serge Lask, dans le même esprit, à côté de ses fameuses poupées de chiffon évoquant les enfants perdus, peignait de grandes toiles couvertes de graphies yiddiches, tout en assumant ignorer cette langue, pour porter le deuil de tant de ses locuteurs, qui n’avaient pas pu la lui transmettre.
– En outre, un livre, pour qui le lit et l’interprète, se présente d’abord comme un texte, un tissage de significations. On sait que la culture juive a fort développé sa tradition écrite, peut-être à l’origine pour des raisons liturgiques, puis pour se conserver et persévérer dans son être, longtemps sans État ni territoire. Aussi, un antisémite conséquent, si cette expression avait un sens, devrait avoir lu au moins les six mille pages du Talmud, entre autres écrits, avant d’assumer son préjugé. Mais la haine des Juifs est souvent d’abord une haine des livres. Or un texte est un vêtement de l’âme, que les vêtements du corps accompagnent. C’est d’abord pourquoi la machine à coudre, peinte ou sculptée, seule ou en nombre, est un thème récurrent d’Alain Kleinmann. Elle est la compagne du livre, celle qui habille le corps, – et le nourrit, chez bien des immigrés pauvres travailleurs, pendant que le livre élève et nourrit l’esprit.
– Et l’image de cette machine à coudre, objet inévitable de la plupart des foyers juifs d’antan, et qui règne aujourd’hui dans ceux de bien d’autres immigrés, est un symbole qui signifie bien au-delà de la couture des vêtements. Car coudre, c’est relier, non pas seulement des habits et des significations, mais aussi des êtres humains et des générations. La couture est un symbole d’Alliance. Et l’Alliance, berith, que le vieux mot Testament rend mal, implique de tracer un chemin de vie le dor va dor, de génération en génération. Alain Kleinmann réalise avec soin et savoir-faire, matériellement, ces symboles, peints et sculptés, pour nous guider vers nous-mêmes, comme des cailloux du Petit Poucet : les artistes ne sont pas des rêveurs, mais des artisans sublimes, qui œuvrent non pour l’utilité, mais pour l’esprit de sujets libres, auxquels est utile l’utile.
– Avec le livre et la machine à coudre, on peut citer notamment l’escalier, qui rappelle aussi bien l’entresol où logeaient bien des Juifs pauvres avant-guerre, aussi bien à Paris qu’à Varsovie ; mais aussi les degrés du Temple, et l’Échelle de Jacob. Les savantes constructions labyrinthiques du peintre évoquent justement les fameuses « pérégrinations » exiliques de ce prophète (Genèse 47,9), et de ses descendants. Enfin la teinte sépia, que l’artiste affectionne, est aussi polysémique. Sa douceur évoque évidemment les photos anciennes, et la suavité des souvenirs, mais aussi la manie que les SS avaient de brûler les photos des familles juives raflées, pour effacer leurs traces. Cette teinte donne donc aux œuvres d’Alain Kleinmann une allure discrètement pathétique de rescapées. Ses personnages sont ainsi des aïeux bienveillants, des revenants angéliques, qui nous réconfortent comme une berceuse juive. Ils nous rappellent qu’en dépit des méchants et des fous, le Dieu d’Israël « étend sa bonté jusqu’à la millième génération, pour ceux qui l’aiment » (Exode 20,6).

Patrick Bantman
MÉMOIRE, TRAUMATISMES, CRÉATION.
EN PARCOURANT L’EXPOSITION D’ALAIN KLEINMANN…
Je voudrais tout d’abord remercier Michel Gad Wolkowicz, président de Schibboleth, qui a eu l’initiative de cette rencontre, et bien sûr notre ami Alain Kleinmann.
La peinture d’Alain Kleinmann résonne en nous depuis aussi longtemps que remonte notre rencontre… Pour nous, Alain Kleinmann est un peintre de la transmission et de la mémoire. Il est aussi un peintre de la catastrophe de la shoah, très moderne par l’usage qu’il fait d’une mul- titude de matériaux et d’objets (livres, photos, landaus, lunettes, chaussures, tampons, portes, fronteaux) qui tous racontent une histoire…
Élisabeth de Fontenay dit que ce qu’il donne à voir, c’est la douloureuse proximité de la yiddishkeit, la présence-absence de ces étudiants de yeshivot, de ces schules. Ce qu’il évoque, ce n’est pas la cruauté absolue de l’extermination… Comme l’écrivain Aharon Appelfeld, que j’ai eu la chance de rencontrer, c’est tout ce qu’il y avait de vivant en Europe de l’Est, avant la guerre, tout ce qui existait… La vie d’avant…
Ni passéisme, ni nostalgie pourtant chez Alain Kleinmann. Il refait vivre cette vie qui a disparu. Cette vie sépia du Yiddishland. La mémoire chez Alain Kleinmann est portée par les objets et les images. À propos de son œuvre, ce sont d’abord des tons et des couleurs qu’il faut parler. Ils sont bruns et sépia dans ces premières œuvres, brun gris et plus récemment blancs, comme des tonalités du passé…
Dans l’exposition, on découvre un monumental escalier baroque d’une demeure qu’on imagine juive pragoise ou berlinoise, des empiètements de vieux ouvrages secrets, rangés et alignés en tout sens, des accumulations de clés sans serrures et de vielles boîtes aux lettres. On trouve aussi des valises d’avant-guerre, entassées, abandonnées, des machines à coudre, des portraits photographiques anciens, parfois flous, anonymes, traces d’insistantes réminiscences du passé. L’évocation des shtetls, ces villages juifs d’Ukraine et de Pologne à travers ces maté- riaux surgis du passé, sont les motifs insistants de son œuvre.
Alain Kleinmann nous raconte, avec sa peinture, et avec beaucoup de simplicité et de modes- tie, la vie inquiète à l’ombre des synagogues.
Toute la mémoire d’un peuple, toutes ses souffrances mais aussi sa culture, son âme passent dans ses compositions picturales très personnelles.
Son œuvre est l’héritage d’une destinée par des fenêtres ouvertes sur les émois d’une mémoire… Elle vient aussi nous évoquer un monde qui n’existe plus…
La créativité des œuvres d’Alain Kleinmann participe de ce travail de mémoire auquel nous sommes sensibles dans notre travail clinique sur la transmission intergénérationnelle du trauma- tisme de la shoah. Elle a des résonnances au plus profond de notre être.
Il y a deux catégories de mémoire d’après Laurence Lauger1 :
La première catégorie est la mémoire quotidienne, c’est une mémoire cognitive, chronolo- gique, une mémoire qui « vient » de la tête. La seconde est une mémoire profonde dans laquelle sont enfouis les traumatismes réels : c’est une mémoire sensorielle, une mémoire des sentiments, une mémoire du corps. Cette mémoire n’est pas souvent « ouverte » au cours de la vie. N’est-ce pas cette mémoire que travaillent les artistes ? Ils passent leur vie à exprimer leurs émotions, leurs affects à travers le vecteur artistique qu’ils ont choisi, ou vers lequel ils ont été poussés, parfois de façon inconsciente.
Pour Philip Roth, « Être vivant c’est être fait de mémoire ». Cette strate de mémoire demeure fermée et protégée par des couches épaisses. Le risque étant que le barrage s’ouvre, que la tempête émotionnelle éclate et menace l’équilibre de la personne…
L’artiste ne garde-t-il pas entrouverte cette strate de mémoire qui serait moins protégée, moins canalisée, balisée par sa création incessante ? Le prix à payer serait-il de ne jamais s’arrêter de créer? Shlomo Sélinger, grand sculpteur, qui a survécu à la shoah, à la question «Pourquoi créez-vous? », répondait : «Est-ce que je vous demande, pourquoi vous respirez?».
Aharon Appelfeld, qui est venu parler au colloque de Tel Aviv en mai 20132, a raconté qu’avant de connaître cette période d’enfer qu’a été pour lui la deuxième guerre mondiale où il a perdu toute sa famille, il était un enfant (jusqu’à l’âge de huit ans) dans une maison chaleu- reuse où ses parents passaient de longues heures avec lui, l’aimaient, le gâtaient, se souciaient de son développement3. Il était dans un «nid douillet».
Toute cette période est restée gravée dans sa mémoire et c’est avec cette petite enfance-là, et l’horreur de ce qu’il a vécu et qui a été démoli en 1941, tout ce début de vie paisible, qu’il est devenu artiste, écrivain : «les années de guerre ont leur part non négligeable dans ce qui a déterminé ma voie, ma manière de penser, mes réactions spontanées».
La seule chose qu’il y avait pour lui pendant la guerre, c’était d’être resté encore enfant par certains côtés, et comme il avait une base d’amour solide, il a pu, malgré tout ce qu’il a traversé, «s’émerveiller devant des petites choses de la nature et cet émerveillement l’a progressivement envahi d’abord sans pensées et sans affects, puis des images de sa maison, de son père, de sa mère et une douleur l’ont submergé».
Je vous rapporte les paroles d’Aharon Appelfeld concernant son émerveillement ; ne peut-on rapprocher cela de la capacité de création? «L’émerveillement n’est pas un état dans lequel on pose une question en attendant une réponse; nous nous oublions nous-même; cet émerveille- ment, je ne l‘ai pas connu tous les jours. … Il m’a extirpé de mon malheur et de l’abjection humaine dans laquelle je vivais4 » (il s’est retrouvé dans une forêt à vivre avec une bande de brigands dangereux qui l’ont pris pour un petit polonais car il était blond). «Cet émerveillement m’a ramené pour un instant à mes parents, mes oncles et mes grands-parents, au monde de la lumière d’avant. Pendant ces moments d’émerveillement, je sentais et peut-être je savais que ce que j’avais connu jusqu’à l’âge de huit ans et demi était mon vrai monde5. »
À travers l’écriture, Aharon Appelfeld a-t-il réussi à retrouver cet émerveillement qui l’a aidé à revenir sans cesse vers ses parents et ce monde heureux de l’enfance ? Il nous a précisé qu’il a continué à écrire et qu’il continue pour rester près d’eux, pour ne jamais les oublier et toujours les aimer. Il est mort en 2020.
L’art peut-il ainsi contribuer à faire voir et entendre ce qui ne doit pas s’oublier? Est-ce que l’œuvre travaille là où les mots font défaut ? L’art a la capacité de sortir les souffrances de l’abîme. Les artistes comme Sélinger ou Alain Kleinmann ont peut-être cette capacité de canaliser leurs angoisses à travers leur création et de les transmettre à la génération suivante au travers d’un filtre, celui de l’art.
Leurs messages inconscients sont déplacés sur le geste créateur artistique souvent à la place de mots qui ne se trouvent pas (sauf peut-être pour les écrivains).
Quelle est la place de la création dans la transmission filiale pour les artistes qui ont eu des enfants? Certains n’ont pas voulu en avoir, d’autres n’ont pas pu en avoir et pour cela l’inquié- tude est la transmission de cette œuvre de toute une vie qui risque de tomber dans l’oubli total ou bien de finir « aux puces6 ». Le fils d’Aharon Appelfeld est peintre. Il a peut-être utilisé son art pour exprimer et extérioriser ce qu’il a reçu du vécu de ses parents de façon consciente et inconsciente…
Ces enfants et petits-enfants peuvent être enfermés dans cette histoire transgénérationnelle7, ou bien ils peuvent eux aussi utiliser un support aidant comme l’art pour s’exprimer et extério- riser ce qu’ils ont reçu du vécu de leurs parents de façon consciente ou inconsciente. Ils sont écrivains, cinéastes, sculpteurs, peintres, vidéastes. D’autres peuvent devenir historiens, psycha- nalystes, philosophes et travailler sur l’entremêlement entre la grande histoire et l’histoire per- sonnelle de chaque individu.
L’art peut-il être ainsi un moyen de transmission pour les générations suivantes en les épargnant grâce au filtre de la création? Les atteindre au-delà des mots souvent indicibles ou inau- dibles et les en imprégner même à leur insu ?
Qu’en est-il de la mémoire dans la pensée juive ?
On peut dire que la mémoire est partout.
Dans la Bible, le verbe zakhor (se souvenir) apparaît plus de deux cents fois. Il s’agit d’une mémoire vivante. Lors de la fête de Pessah dans le calendrier juif, on nous demande de nous souvenir que nous étions esclaves en Égypte. Nous nous souvenons aussi de nos disparus à Yskor au moment du grand pardon (Kippour). En Israël lors du Yom Hazikaron qui précède le jour de l’Indépendance, nous commémorons des évènements historiques comme la destruction du deuxième temple.
Se souvenir n’est pas simplement un rapport obsessionnel au passé. Se souvenir a un but, celui d’affecter et d’influencer nos actes présents et futurs.
On nous enjoint aussi d’oublier les épisodes qui font «trou», qui font trauma, dans la conscience juive, comme Amalek8. Après la destruction du temple, le judaïsme se construit sur le manque et l’absence. La transmission ne dépend pas de l’immuable, de l’inchangé, d’une mémoire ancestrale qui se transmet de façon monolithique de génération en génération. Une fidélité à l’origine passe toujours par une forme d’oblitération de la mémoire, et de recomposi- tion d’un souvenir, qui permet que quelque chose passe en creux. Comme le dit Michael Bar Zvi9, le judaïsme n’est pas une identité mais la liberté de répondre à l’injonction de transmettre. L’apport de Michael Bar Zvi m’a permis de prolonger mes réflexions cliniques, à partir de la manière dont il aborde la question de la transmission dans le judaïsme.
Elle est plus l’affaire de contenant que de contenu. Il y a la fameuse métaphore que Michael Bar Zvi évoque dans son livre10. Ce qui est important ce n’est pas ce qu’il y a dans la brouette, mais c’est la brouette, dit-il dans le film11 qui lui est consacré.
Je pensais jusqu’alors que la transmission concernait ce que dit une génération, à celle qui la suit. La transmission contrairement à ce que j’affirmais, il y a quelques années, n’est pas le résultat d’un héritage et nous ne sommes pas le dépositaire de quelque chose. Souvent ce qui se transmet passe à l’insu, dans le silence, comme on le voit dans notre pratique clinique avec des survivants de la shoah.
Le silence qu’évoque Appelfeld à propos de la difficulté de transmettre des parents survivants, quand il dit « Les gens de ma génération ont très peu parlé à leur enfant, de leur maison, et de ce qui leur était advenu pendant la guerre», cela s’explique par une volonté de ne pas trans- mettre, pour ne pas transmettre la mort. Le traumatisme qu’a constitué la shoah n’a pu que difficilement être transmis aux enfants comme l’évoque aussi Aharon Appelfeld12 : «L’histoire de leur vie leur a été arrachée sans cicatriser. Ils n’ont pas su ouvrir la porte qui menait à la part obscure de leur vie, et c’est ainsi que la barrière entre eux et leurs descendants s’est érigée».
Je voudrais rapidement pour conclure évoquer comment les processus de transmission peuvent être mis à mal dans des situations de traumatisme, et comment l’injonction de « rester vivant malgré la douleur » fonctionne dans ces situations traumatiques, permettant de surmonter le drame.
Notre expérience dans ce domaine concerne les traumatismes liés à la shoah, et leurs réper- cussions à l’écoute de survivants, mais également l’écoute clinique des victimes d’attentats.
Cette problématique, nous la rencontrons dans notre pratique clinique de thérapie familiale où s’exerce le poids des délégations et des loyautés inter et transgénérationnelles13.
Dans ces familles en thérapie s’exerce le poids des traumatismes, de l’ombre portée des secrets familiaux, des mythes, sur les parents présents et sur les générations à venir. Nous mesurons le poids des silences, des «trous» dans la mémoire.
Les traumatismes graves ne se transmettent pas seulement à la même génération, mais éga- lement à la deuxième génération voire à la troisième génération, comme l’évoque Yolanda Gampel14 à propos de la shoah.
Cette psychanalyste, avec d’autres, a montré comment les effets de la shoah se manifestent à long terme, éparpillés dans l’espace à travers le temps sous forme de «restes radioactifs» (Y. Gampal), à l’intersection du présent et du passé, entre la présence et l’absence.
La shoah a souvent blessé ou tranché net bien des fils de la transmission. Comment auront-ils été repris ou abandonnés, et qu’ont-ils laissé dans le psychisme15 ?
« Transmettre c’est donner du sens, mais comment fait-on pour donner un sens à ce qui n’en a pas?», disait Michael Bar Zvi16, ce que nous reprenons à notre compte dans notre approche clinique.
Comment déceler ou reconnaître ce qui est à transmettre et ce qui ne l’est pas, car même si le sens est caché ou absent, l’acte du passage possède en lui une force. Il ne s’agit pas d’être des passeurs, mais d’avoir la puissance de bâtir un pont sur de solides pilotis. Sans ce pouvoir, les passerelles s’effondrent avec ceux qui les empruntent.
Notes
1. Propos recueillis par Dinah Wardi lors du colloque à Tel Aviv en mai 2013 « l’Intergénérationnel en psychiatrie et en psychopathologie aujourd’hui ».
2. Intergénérationnel en psychopathologie et en psychanalyse aujourd’hui, colloque 5-7 Mai 2013, Tel Aviv, publié aux éditions In Press, 2014.
3. Ces entretiens avec l’écrivain Aaron Appelfeld ont eu lieu en mai 2012 et en mai 2013 à Mevasseret Zion près de Jérusalem. Ils ont été publiés dans l’ouvrage collectif de Michel Gad Wolkowicz : Le sujet face au réel, et dans la transmission, In Press, 30 août 2017.
4. Entretien op. cit.
5. Idem.
6. Paroles de Mme Testiler, artiste peintre et sculpteur qui n’a pas de descendants et qui s’interroge sur le devenir de sa production si riche et abondante.
7. Voir le film Footnote.
8. Dans la Bible hébraïque, le nom d’Amalec désigne par métonymie le peuple des Amalécites, l’ennemi constant, voire héréditaire d’Israël. Dans la tradition juive et l’ensemble de la littérature rabbinique, ce nom a ainsi une consonance sinistre.
9. Michael Bar Zvi, Si c’était Jérusalem, sous la direction de Michel Gad Wolkowicz et de Michael Bar Zvi, In Press, p. 111.
10. Michael Bar Zvi, Pour une politique de la transmission, Réflexions sur la question sioniste, Éditions Les Provinciales, 2016.
11. Interview de Michael Bar Zvi sur Fréquence Tel Aviv par Michael Grynszpan, 2018.
12. Aharon Appelfeld, L’héritage nu, Paris, Éditions de L’Olivier, 2006. 13. L’intergénérationnel contient « l’idée de passage entre » les géné- rations, le transgénérationnel, l’«idée de passage au travers». Tout est transmis, tant ce qui est explicité que ce qui est caché.
14. Gampal Yolanda, Ces parents qui vivent à travers moi. Les enfants des guerres, Fayard, 2005.
15. Article Haliouha Bruno et Collab., «Que nous apprennent les enfants de survivants sur la transmission intergénérationnelle du trau- matisme » publié dans l’European Journal of Trauma and Dissociation, 6 (2022) 100249.
16. Bar Zvi Michael op. cit. Citation que j’ai reprise lors du Colloque international Schibboleth Beautiful Center, la transmission en ques- tion(s), Tel Aviv 5-6-7 Mai 2019.

Jean-Pierre Winter
KLEINMANN ENTRE MÉMOIRE ET CRÉATION
«L’homme n’est que le mandataire provisoire du passé et l’avenir» (MaurIce MaeterlInck).
«À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère? À des tablettes d’écritures rabattues l’une sur l’autre » (le Talmud).
T oute l’œuvre d’Alain Kleinmann pourrait s’intituler : À la recherche du temps perdu. Mais ici il ne s’agit pas du sentiment de perdre son temps ; il s’agit d’un temps que ni lui ni moi,
nés après la shoah, n’avons connu. Dès lors la question se pose de rendre sensible ce qui n’a pas eu lieu pour lui mais dont en tant qu’artiste il doit témoigner pourtant.
À la fin de la fameuse scène dite de la « Petite Madeleine », Proust écrit : « Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même; quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher ? Pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière.» Tel serait le principe, le plan mis en œuvre par Kleinmann, au mot près.
Car ce serait une erreur de penser que sa peinture ne s’attarde qu’à l’irreprésentable de ce qui a eu lieu, quand manifestement il fait entrer dans son étrange lumière sépia le pays qui lui est inconnu et qu’il s’efforce de créer pour nous le transmettre.
Kleinmann ne cherche pas : il trouve. Quoi ? Des objets, des photos, des dessins, des livres, des landaus, des bagages justement, des cages vides… Des objets tressés avec des écritures et souvent des numéros comme tatoués sur des sujets disparus. 35204, peut-être 59842, 706, 6110 (qui est, qui sait, le numéro du tailleur de l’« atelier », et ces bibliothèques dont le désordre dit bien qu’elles ne sont pas un décor de salon mais les corps d’un travail infini qui a traversé le temps.
Certes, il s’agit bien de mémoire mais d’une mémoire construite à partir de traces déposées dans l’esprit du créateur étranger et exilé d’un temps, pour nous, aboli, mais néanmoins présent. Nulle stèle ici ! Nul souvenir destiné à tuer la mémoire. Nulle satisfaction déculpabilisante d’avoir accompli son « devoir de mémoire ». Juste des lambeaux de réminiscences agencés à la 6,4,2 pour évoquer en un geste exprès l’Absence définitive. Et de là vient notre émotion. La peinture de Kleinmann est une radicale allusion qui nous saisit au vif de nos questionnements. Elle ne démontre rien : elle montre. À nous de voir, au-delà de nos larmes, ce qui nous regarde depuis ces tableaux qui disent le lucide désespoir de l’artiste.

Marek Halter
PEINTRE DE LA MÉMOIRE
J’ignore si Alain Kleinmann appréciera l’appellation que je lui attribue, mais il est pour moi, et c’est un compliment, un «peintre de la mémoire». Du fond d’une matière ocre doré propre à lui, tel un rêve, surgissent de ses toiles les figures et les visages du passé. Parfois subs- titués par des livres ou des sépultures. Habité par l’Histoire, il nous projette dans l’Histoire. Celle que nous connaissons tous, mais qui s’estompe déjà dans nos souvenirs et qu’Alain Kleinmann a su capter et préserver.
Quand Picasso peint Guernica, c’est un événement particulier qu’il dénonce et nous trans- met. Quand Goya représente, par la gravure, les horreurs de la guerre, c’est la situation qui a permis l’avènement de Guernica qu’il dénonce et transmet. Kleinmann, lui, d’un tableau à l’autre, d’une installation à l’autre, inlassablement, dénonce l’oubli.

Éliette Abécassis
TRANSMISSION VERTICALE, TRANSMISSION HORIZONTALE
« Vous ne pouvez transmettre que parce que vous avez reçu, mais comment transmettre, comment recevoir ? » (Armand AbécassIs)
Les œuvres d’Alain Kleinmann témoignent du passé ineffable, invisible et immémorial. Elles sont l’image de la mémoire qui choisit et qui efface, du temps qui passe, et de tout ce qu’il nous reste de nos ancêtres lointains ou proches, de ce que nous voulons en retenir, de ce qu’ils veulent nous en dire. Les sculptures de ses livres me bouleversent aujourd’hui : ce sont des vestiges. Bientôt nous n’aurons plus de livres sous la forme de codex. Bientôt on évoquera le temps des livres. Ils seront comme des objets dans les musées.
Selon le récit de la Haggadah, il y aurait quatre types d’enfants. Le premier enfant, « le sage », interroge : « Quels sont les témoignages, les lois et les préceptes que l’Éternel notre Dieu vous a prescrits?» C’est un questionnement qui vient de l’intérieur. Le deuxième, «le méchant», demande : «Quelles sont ces lois que vous observez?» : il se place en dehors de la communauté. Le troisième, «le simple», s’étonne : «Qu’est-ce que ceci?», car il est ignorant de tout. Enfin, vient le dernier, le quatrième, « celui qui ne sait pas poser la question ». En dehors de la chaîne de la transmission, il ne comprend pas sa pertinence, insensible à ce qui se passe autour de lui. Que faire et comment agir avec ce dernier enfant? La réponse de la Haggadah est la suivante :
«Toi, prends les devants, en racontant : “C’est dans ce dessein que Dieu a agi en ma faveur quand je sortis d’Égypte.” » La Haggadah ordonne aux parents d’éduquer leur enfant de façon active, en lui racontant une histoire. Haggadah signifie « récit », sa racine radicale signifie « racon- ter». Par l’art, Alain Kleinmann raconte l’intransmissible. Quelque chose de profondément humain s’y joue, qui possède une âme : une représentation spirituelle de la mémoire. En cela, j’y vois le souffle d’un projet essentiellement juif, celui des rabbins transmetteurs issus de la tradition, qui enseignaient dans tous les pays, à toutes les époques. Ces maîtres se sont attachés à leurs élèves et ils ont noué avec eux un lien unique. Par leur enseignement, ils ont transmis la flamme de la Torah aux générations futures, ils ont porté la parole loin de chez eux. Telle fut leur existence, happée par la transmission. Parfois au péril de leur vie, ils s’en allaient sur les routes, avec la Torah pour seul viatique, et ils enseignaient. Le centre de leur vie, son sens, c’était l’enseignement. Ils poursuivaient en secret un but messianique : celui de réparer le monde, à travers les paroles des sages, de génération en génération, selon l’expression consacrée.
Aujourd’hui, cette transmission verticale a été remplacée, ou du moins concurrencée, par une transmission horizontale, que l’on appelle aussi «virale». Nos enfants ne sont pas nos enfants, comme disait Khalil Gibran, sans prévoir qu’ils deviendraient ceux des Smartphones. Ils ont le cou qui s’incline vers leurs téléphones remplis à ras bord d’applications, de messageries, jeux, chaînes, réseaux sociaux, vidéos, films, notifications, imprécations, injonctions, appels et rappels : la nuit, le jour, ils sont penchés sur leur écran, presque courbés. Ils se réveillent avec Instagram, poursuivent la journée avec Tik Tok, des vidéos et d’autres réseaux, et s’endorment devant une série. Ils déjeunent, marchent, mangent, le portable en main, et même en classe, ils regardent, consultent, scrollent, ils se virtualisent dans le monde parfait des beaux hôtels ins- tagrammables où l’on sert d’admirables mets. Les «Petites poucettes» comme le disait tendre- ment le philosophe Michel Serres dans son célèbre éloge de la modernité publié en 2012, ont laissé place à des Petits Poucets, dévorés par l’ogre technologique. C’est ainsi qu’ils apprennent une foule de choses, qu’ils se cultivent, se politisent, se dépolitisent, rêvent, réfléchissent, et aiment ou plutôt «likent». Sur Twitter les abonnements étalent une avalanche de nouvelles concernant le monde. Sur Instagram, des recettes, des tutoriels de maquillage, des ambiances de salon, des soldes, des réels de stars, d’influenceuses, des stories sur leurs bébés, sur leurs chats, sur leurs sacs, Sur You Tube les tubes et les palabres des influenceurs, sur Netflix, Amazon Prime, Apple Tv, les nouvelles séries, etc., etc.
Cette transmission s’effectue de manière horizontale, dans le sens où les gens captent un flux transversal, de tout ce qui arrive à l’instant t. Mais aussi, son symbole est le lit, où ils sont allon- gés : ils s’endorment avec leur écran, ils se réveillent en le consultant, pour voir ce qui s’est passé dans le flux pendant leur sommeil, pour ne rien rater de tout ce qui se dit, se filme, se révèle en « stories », aussitôt effacées après avoir été consultées : elles ne durent qu’une journée. Qu’est-ce qui reste de cette transmission ? Pas grand-chose, elle est aussitôt remplacée par une autre salve. Quel homme, quel artiste aura assez de force pour «prendre les devants», chercher les enfants de façon active, les garder dans la maison humaine, et quel Petit Poucet, quelle Petite Poucette, aura l’idée de semer des pierres sur son passage pour retrouver seul le chemin de cette maison ? À moins qu’il ne soit happé par la viralité d’une idée, d’un message, ou d’un dogme. La trans- mission horizontale ne peut se passer de la transmission verticale, celle de la représentation du passé à travers l’art et à travers la parole vivante. Ainsi la peinture d’Alain Kleinmann transcende l’art pour viser l’invisible dans le monde de la visibilité immédiate, l’éternité dans le flux du temps.

Élie Korchia
ALAIN KLEINMANN OU LA MÉMOIRE EN TRANSMISSION
Avouons-le d’emblée, je ne suis pas des plus objectifs lorsque je m’exprime sur le travail artistique d’Alain Kleinmann, et pour cause : il est non seulement un ami depuis 25 ans, mais aussi un peintre pour lequel j’ai toujours éprouvé un attachement qui ne s’est jamais démenti. Notre histoire commune a commencé il y a un quart de siècle, vers la fin des années 1990, alors que j’étais le jeune président de la Communauté juive de Puteaux dans les Hauts- de-Seine et qu’avec mon épouse Adassa, nous avions publié un calendrier hébraïque dont il manquait l’image de couverture.
Après plusieurs propositions de dessins et de photographies qui ne nous enchantaient guère, nous avions eu l’idée d’aller demander à Alain Kleinmann s’il accepterait qu’une reproduction d’une de ses toiles illustre notre couverture. Après une première rencontre dans son atelier parisien, il nous donna immédiatement son accord pour la reproduction d’un de ses tableaux consacré à Jérusalem, heureux de soutenir à la fois un jeune couple de responsables commu- nautaires et un président âgé de moins de 30 ans…
Un an plus tard, alors que je travaillais à un projet de livre sur les grands avocats et les grands procès du xxe siècle sous le prisme de l’incroyable parcours de mon mentor René Hayot, doyen des avocats français, sur une période de sept décennies, je décidai de retourner rencontrer Alain dans son atelier pour lui exposer une requête bien particulière. En effet, après lui avoir expliqué que mon ouvrage avait pour thème la transmission et le partage d’expérience entre un avocat illustre et son jeune collaborateur à l’orée du xxie siècle – dans le but de retracer à la fois le parcours unique de René Hayot tout au long du siècle, et plusieurs grands thèmes judiciaires –, je lui demandai de réaliser une toile qui reprendrait un portrait de mon maître en train de plaider une affaire célèbre et intégrerait plusieurs petits «tableaux dans le tableau», symboles d’un destin individuel hors norme comme d’une profession tout entière! C’est ainsi qu’est né à la veille de l’an 2000 le tableau d’Alain Kleinmann qui a servi de couverture à mon ouvrage Un siècle d’avocats. René Hayot ou 70 ans de Palais.
Depuis lors, je crois avoir suivi chacune des étapes artistiques d’Alain au cours des vingt dernières années, que ce soit au travers des œuvres qu’il a consacrées à la thématique de la fête juive de Pessa’h ou aux Maximes des pères, de ses tableaux aux tons ocres et sépias, de ses œuvres autour du «Blanc», qui représentent à la fois une césure et un prolongement remar- quable de son travail, de ses expositions en France et de celles qu’il a faites à l’étranger… Pour tout dire, l’univers artistique d’Alain fait partie intégrante de mon propre univers, à l’image de mon cabinet d’avocat où l’on retrouve nombre de ses travaux.
On présente régulièrement sa démarche artistique comme étant liée à la Mémoire et c’est bien évidemment juste, mais plus encore selon moi, c’est le thème de la «transmission de la Mémoire » qui est réellement au cœur de son œuvre et en constitue la clef qui ouvre toutes les serrures, pour reprendre une image qui lui est chère et m’a toujours passionné dans ses toiles.
Il était donc évident, pour lui comme pour moi, après mon élection à la présidence du Consistoire de France à la fin de l’année 2021, que nous pourrions collaborer sur un projet commun. Ce fut le cas l’an dernier avec l’édition d’une belle Haggadah que nous avons diffusée largement aux quatre coins de la France, de Paris à Marseille ou de Lyon à Nice… Dans la postface que j’ai signée à cette occasion, j’ai rappelé qu’au cours de l’histoire du peuple juif, le vecteur essentiel de la transmission de la sortie d’Égypte a toujours été symbolisé par la Haggadah de Pessa’h. Ce récit transgénérationnel permet donc chaque année aux Juifs du monde entier de revivre ce temps d’accession à la liberté, valeur consubstantielle à l’esprit du judaïsme, dans le cadre d’une transmission mémorielle bien vivante. Le terme même de Pessa’h peut d’ailleurs se décomposer en Pé, « bouche » et Sa’h, qui signifie « parle », sachant que l’Histoire se structure toujours sous la forme de questions et de réponses et que la Haggadah nous invite à engager autour de la table familiale du Séder un dialogue fécond sur la naissance du peuple juif et son affranchissement du joug de l’esclavage.
Ce système de questions et de réponses n’est pas sans nous rappeler le subtil jeu visuel que l’on trouve dans nombre d’œuvres d’Alain Kleinmann où figurent des serrures et des clefs, nous laissant penser que les clefs de la connaissance et du savoir permettent d’ouvrir certaines serrures qui nous entourent et nous enferment trop souvent, tant sur le plan individuel que collectif.
Cette Haggadah que nous avons éditée ensemble nous a aussi permis de mieux saisir la pro- fondeur du travail réalisé par mon ami Alain, dont les tableaux représentent si bien toutes les étapes de l’avènement et de la libération du peuple juif, et je suis heureux que sa diffusion ait pu rencontrer un vif succès.
En conclusion de mon propos, je citerai une phrase d’Alain qui le résume parfaitement et qu’il avait écrite dans le catalogue d’une exposition qui lui était consacrée en 2010 au musée de Perpignan : «Travailler sur la mémoire est un acte de projection vers le futur et non une nostalgie passéiste. C’est dans un rapport construit à la mémoire que se définit l’identité avec laquelle on peut fonder son présent et son avenir. » Je pense enfin à cette phrase de Louis Aragon, qui estimait que « la peinture d’Alain Kleinmann appartient à ce qui fonde l’art : un sentier pétri d’humanité chaude et douloureuse qui bouleverse par sa vérité plastique et poétique». Que la peinture d’Alain puisse continuer longtemps à se réinventer pour nous permettre de vivre des expériences artistiques renouvelées, dans cet esprit de transmission et de partage qui lui est si cher et que nous partageons ardemment.